Mémoires d'un pilote de chasse
Mon premier contact avec l'aviation, s'est produit à Grenoble, avant la guerre, alors que j'étais tout gamin. Chaque semaine, un petit monomoteur bleu survolait la maison à basse altitude. C'était un Caudron Simoun qui apportait le courrier et qui allait se poser sur le terrain tout proche d’Eybens. Le dimanche, j'allais en vélo sur ce terrain pour l'admirer. J'en ai revu un exemplaire l'an dernier, en 2012, au Musée de l'air et de l'espace du Bourget.
Caudron 635 "Simoun" aux couleurs d'Air Bleu (MAE)
La guerre
Et puis la guerre est arrivée. Pendant la drôle de guerre de ce printemps 1940, mon père, qui était dans l'armée des Alpes et qui voulait nous protéger des Italiens nous a envoyés, pour nous éloigner, à Rochefort-sur-Mer. Et c'est là qu’en juin 1940 nous avons vu arriver, après la débandade des réfugiés et celle de l’armée en déroute, les soldats allemands. Ma grand-mère m'a interdit d'aller les voir et surtout m’a-t-elle dit :
- « Ne prend rien de ce qu'ils te donneront à manger ».
Ils étaient propres et souriants (le sourire des vainqueurs). Ils m'ont donné des bonbons et je les ai mangés.
Quel rapport avec l'aviation me direz-vous ? J'avais a peine 11 ans et cependant un souvenir de cette époque est resté gravé dans ma mémoire. Il y avait sur le terrain de Rochefort, une escadrille de Dewoitine 520. Et il n'y avait pas de radar.

Système d'écoute en 1939
Je me souviens que le système de guet utilisait un ensemble de quatre pavillons gigantesques, posé sur un camion, et que l'opérateur, un écouteur sur les oreilles, essayait de repérer les arrivants en faisant pivoter l’ensemble. Ce système était très peu efficace car quelques bimoteurs allemands sont arrivés (peut-être des Junker 88) et ils ont bombardé le terrain avant que nos avions puissent décoller. Les seuls qui avaient réussi à mettre en route, ont capoté dans des trous de bombe de la piste en herbe. Le lendemain j'ai été me promener sur le terrain et je n'ai trouvé que des carcasses fumantes. Un Dewoitine 520 qui a brûlé, c'est tout petit.
Il y avait aussi des grappes de prisonniers derrière des grilles. Ils étaient dépenaillés et affamés. Les Allemands nous laissaient approcher de ces grilles pour leur donner un peu de nourriture alors que nous en manquions déjà.
Après l'armistice, retour à Grenoble. Un an plus tard, j'entre au lycée Champollion et j'ai un nouveau contact avec l'aviation par le biais de la construction de modèles réduits. Quels que soient les reproches que l'on puisse adresser au régime de Vichy, il y a eu quelques initiatives remarquables. À l'intérieur du lycée, on pouvait percevoir tous les matériaux et les plans pour construire des modèles réduits de planeurs et on payait. Mais ce n'était qu'une caution, et une fois le modèle terminé, si on le montrait, on récupérait son argent. Et nous étions fiers de voir chaque lundi matin le drapeau français s'élever dans la cour du lycée.
En 1941 le maréchal Pétain est venu à Grenoble qui était encore en zone libre. La place située devant le parc Paul Mistral était noire de monde. Une foule en délire acclamait ses paroles. Trois ans plus tard, au même endroit, une foule aussi nombreuse et enthousiaste buvait les paroles du Général de Gaulle. Les français ont la mémoire bien courte. Et pourtant les deux devaient certainement leur distiller grosso modo le même « Je vous ai compris... ».
Nous avons également été bombardés par les Américains. À chaque alerte je descendais avec ma mère et mes frères dans des abris qui avaient été aménagés sur la même place. C'était de petites galeries bétonnées et en zigzag dans lesquelles nous attendions la sirène de fin d'alerte. Je portais à chaque fois le sac à dos dans lequel nous avions nos papiers importants. J'échappais de temps en temps à ma mère pour aller pointer le bout du nez à l'entrée de l'abri qui n'avait pas de porte. Un jour alors que j'entendais les avions, je les ai vus. Ils étaient au sud de Grenoble, pas très hauts, et se dirigeaient vers l'ouest. Comme je n'étais pas sur leur trajectoire, je suis resté dehors malgré les cris de ma mère. Et j'ai vu tomber le chapelet de bombes. Ils visaient sans aucun doute le pont de chemin de fer situé à la sortie de la ville. Hélas il l'ont raté et tout est tombé à flanc de colline sur Saint-Martin le Vinoux : il y a eu plusieurs centaines de morts.
Nous habitions dans un immeuble qui appartenait à la ville. Nous avions un F5. Un matin alors que nous prenions notre petit déjeuner, les résistants ont fait sauter le dépôt de munitions qui était dans une caserne (caserne de Bonne) située à 1 km à l’ouest de chez nous. Le souffle a été terrible. Bizarrement, ce sont surtout les fenêtres des pièces situées à l’est qui ont été arrachées. Heureusement nous déjeunions dans la cuisine située à l’ouest. Mais les cloisons sont tombées et le F5 s'était transformé en studio. Mon plus jeune frère dans son berceau était couvert de débris de verre que nous avons dégagés avec précaution : il n'était pas blessé. Nous avons vécu plusieurs mois avec des rideaux en guise de cloisons et du carton aux fenêtres. La rue était jonchée de débris de diverses munitions. Il y avait notamment des pains de plastic qu'avec des camarades je m'amusais à faire brûler. Hélas un jeune du quartier en voulant démonter un objet récupéré a perdu une main. Nous étions choqués et interloqués d'autant plus qu'aucune sirène n’avait sonné le début de l'alerte. Ce n'était donc pas les avions. Ce n'est que quelques heures plus tard que nous avons appris la vérité.
Et puis il y a eu l'épisode des lycées. Je devais être en 3ème au lycée de garçons (le lycée Champollion). Les Allemands ont décidé de l'occuper et nous avons passé une semaine à débarrasser les locaux. Les cours ont alors repris dans le lycée de filles. Le matin c'étaient les garçons et l'après-midi les filles. Le mobilier de l'époque comportait encore un encrier vide devant chaque élève. Nous les avons utilisés comme des boîtes aux lettres et nous y glissions des mots doux que les filles pouvaient lire pendant l'après-midi. Et elles nous répondaient.

Il était très difficile de se nourrir et pour compenser un peu cela, mon père avait loué un petit terrain où nous cultivions des légumes. Et il y avait notamment des pommes de terre dont les feuilles étaient dévorées par un insecte connu sous le nom de doryphore. Pour y remédier j'allais y pulvériser une poudre insecticide. J'utilisai une pompe constituée par un gros cylindre avec une poignée et terminé par un petit tube que l'on pouvait prendre pour un canon de fusil. J'étais en vélo et l'extrémité de cet appareil dépassait de l'ouverture de mon sac à dos. J'ai été arrêté par une patrouille allemande extrêmement menaçante. L'un m’a saisi à bras-le-corps tandis qu'un autre braquait son arme. Mais lorsqu'ils ont constaté qu'elle était la nature de l'objet du délit, ils ont éclaté de rire. J'avais répété plusieurs fois « doryphore, doryphore ». Savaient-il que nous les appelions ainsi par dérision ?
Nous cultivions aussi du soja et ma mère en faisait d’excellents gâteaux. Ces plants ressemblant à des petits pois poussaient très bien dans notre jardin. Quand j’écris ces lignes, tout le soja est importé des USA et il m’est impossible de trouver des semences. Comprenne qui pourra ?
De la fenêtre de ma chambre, après avoir remplacé les carreaux, je pouvais facilement observer la place dont j'ai parlé tout à l'heure et tout au sud le plateau du Vercors. Et je vais évoquer quelques souvenirs :
- Lorsque les troupes de l'occupant ont donné l'assaut au maquis du Vercors, ils ont commis de nombreuses atrocités. De ma chambre j'ai vu, de nuit, brûler les villages. Ils ont également volé du bétail et ils l'ont rassemblé sur un terrain situé dans le polygone d'artillerie au confluent du Drac et de l'Isère. Il y avait plusieurs centaines de bêtes et comme personne ne se souciait de les traire, elles hurlaient de douleur. Les sentinelles m'ont permis de m'approcher et de ramener un peu de lait à la maison.
- Le 11 novembre 1943, des mots d'ordre avaient circulé pour qu'une manifestation se rassemble sur cette place devant le monument des Diables Bleus. Cette manifestation avait bien sûr été interdite. Elle a cependant eu lieu. À plat ventre sur un balcon, j'ai vu arriver un camion. Des soldats en sont descendus et ils étaient une quinzaine tout au plus. Aucun coup de feu n'a été tiré mais les manifestants ont été parqués comme du bétail lorsque les renforts sont arrivés. Ils sont restés derrière des barbelés pendant 3 jours avant de partir en camp de concentration. Mon épicier qui ne manifestait pas est parti avec eux. Nous avons retrouvé son vélo avec une petite remorque chargée de légumes et il n'est jamais revenu. J'ai compris ce jour-là quelle était l'efficacité de la détermination qui entraîne celle de la peur. J'y repense lorsque de nos jours de nombreux CRS ont de la peine à maintenir quelques voyous.
- J'évoque ensuite une péripétie plutôt comique. Lorsqu'en Italie le maréchal Badoglio a capitulé, les Allemands sont venus mettre le siège en installant des mitrailleuses devant la maison des étudiants. Ce grand bâtiment situé à l'opposé du monument des Diables Bleus était occupé par l'état-major italien. Et j'ai vu les officiers et les colonels italiens sortir en levant les bras et être fait prisonniers.
- Toute une nuit, nous entendons le grondement sourd de véhicules qui transitent sur la place. Lorsque l'un d'eux tombe en panne : pas de pitié, il est grenadé. Les Allemands évacuent Grenoble. Le lendemain, un de leurs avions mitraille je-ne-sais-quoi à basse altitude. C'est la fin. Les Américains entrent dans Grenoble. Ils sont là aussi accueillis par la foule et je n'avais jamais vu autant d'hommes portant sur leur bras gauche le brassard "FFI". Il y en avait beaucoup plus que dans les vrais maquis. De mon côté, je préfère monter sur les chars américains pour offrir les légumes frais de mon jardin en échange de leurs rations.
C’est donc la Libération. Et pendant plusieurs jours il y a des scènes de joie et des spectacles de haine. Il y a l'exhibition des femmes tondues. Et pourtant certaines d'entre elles avaient seulement essayé de procurer du chocolat à leurs enfants. Tous les soirs il y a des feux d'artifice qui sont tirés depuis le fort de la Bastille. Et nous sommes dans la rue jusqu'à l'aube sans le contrôle des parents. Je n'ai que 14 ans mais je découvre combien dans ces circonstances il est facile d'embrasser les filles.
Retour à l'aviation
Et toujours sur le petit terrain d’Eybens qui n'est plus aujourd'hui qu'un ensemble d'immeubles, nouveau contact avec l'aviation :
- Un Junker 52 de passage, offre des baptêmes de l'air pour les jeunes lycéens. J'en profite et comme c'était l'été et qu'il y avait beaucoup de turbulences dans les basses couches, les sacs en papier distribués avant le décollage ont été fort utiles.
- Alors que je m'étais inscrit, à un club de vol à voile qui avait été interdit pendant la guerre, je me rendais souvent sur ce petit terrain d’Eybens. Un jour nous apprenons que des pilotes du "Normandie-Niemen" viennent s'y poser pour faire une démonstration. Je me précipite et il y avait là plusieurs Yak 3. Un des pilotes demanda à notre moniteur de faire un tour de planeur. Il s'agissait d'un modeste 15A sur lequel (et je ne dis pas "dans lequel" puisque que le pilote était assis à l'air libre sur la poutre avant) il allait être treuillé. Il était dans un bel uniforme, accompagné d'une personne jeune et jolie. Et je me souviens de lui avoir entendu dire avant ce vol :
« Je ne te confie pas mon portefeuille car dans ce planeur on ne risque pas de brûler comme dans mon Yak ».
Le voilà parti et, en approche, en tirant sur le manche au lieu d'essayer de passer dessous, il accroche une ligne électrique qui alimentait je crois une bétonnière : gerbes d'étincelles, pilote indemne mais planeur bien amoché.

Avia XV-A
Le même jour (jour de chance) à l'issue d'une présentation en patrouille, un des Yak oublie de sortir le train et se crashe.
Me voici donc à 14 ans, membre de ce club de vol à voile avec la ferme espérance de pouvoir voler un peu. Il s'agissait de vols de quelques minutes seulement sur XV-A après un treuillage. Il y avait un autre planeur pour faire de la double avant le lâcher mais je ne me souviens plus du modèle. De toute façon cela n'avait rien à voir avec les magnifiques planeurs allemands qui ont une finesse de plus de 40.
Le moniteur bénévole, qui, en dehors du club était un marchand de limonade, amenait son camion. On soulevait le camion avec un cric, on enlevait une roue arrière et on la remplaçait par le tambour contenant le câble du treuil. Et alors commençait la corvée. Le câble était enroulé sur le tambour et il fallait le dérouler. On s'attelait à plusieurs jeunes et, en halant comme des boeufs, on déroulait le câble pour un nouveau treuillage.
Le lâcher était prévu pour plus tard car il y avait beaucoup de candidats. Et la seule récompense était la permission de s'asseoir dans le XV-A après l'avoir mis face au vent, et à lui maintenir les ailes horizontales à l'aide des ailerons. J'ai passé de nombreuses journées à tirer ce câble et à attendre la récompense finale. Elle n'est pas venue, car mon père a été affecté en Allemagne et j'ai dû quitter le club.
Trois ans passés dans le lycée français de Baden-Baden (lycée Charles-de-Gaulle) jusqu’en terminale. Toujours pas de vol mais toujours l'envie. La rentrée suivante arrive. Je commence par m'inscrire au lycée de Strasbourg dans une classe de mathématiques supérieures où je suis accepté après un examen d'entrée. Je passe également un examen d'entrée pour la classe préparatoire de l'Institut polytechnique de Grenoble. Je suis reçu. Pilote ou ingénieur ? Pourquoi pas. Mais la vie d'étudiant coûte cher et derrière moi il y a 3 frères. Mon père réussit alors à me faire inscrire au Prytanée militaire de la Flèche dans une classe de préparation au concours d'entrée à l'École de l'air de Salon. Les études y seront presque gratuites. Je rejoins la Flèche après un peu plus de 15 jours passés à Strasbourg.
Ce Prytanée est installé dans un vieux couvent et les immenses dortoirs sont un peu tristounets. Nous sommes en uniforme d'enfants de troupe. Il y a d'excellents professeurs et surtout un parc immense dans lequel il est beaucoup plus agréable d'aller réviser que dans une salle d'études.
Pendant les premières semaines, je découvre le bizutage. En effet il y a ceux qui n'ont pas réussi le concours une ou deux fois. On les appelle les "carrés" et les "cubes". Ce bizutage est dur à vivre, il est souvent humiliant. Il est totalement ignoré par la hiérarchie et je devrai en subir d'autres par la suite.
Après une année scolaire rythmée par 17 h de cours de maths par semaine, j'ai la chance d'être reçu au premier essai. Le programme de cette préparation était pratiquement le même que celui d'entrée à l'École Navale et la plupart de mes camarades passaient les deux concours. Pour rien au monde je n'aurais voulu être marin et je n'ai passé qu’un concours.
Salon, École de l’air
Me voici donc en octobre 1949 comme jeune "poussin" à l'École de l'air.
En cette première année, l'activité principale était des cours au sol et de l'instruction militaire. Nous sommes installés six par six dans des blocs situés au premier étage du BDE (ce Bâtiment Des Elèves était à l’époque le seul en dur. Le mess était encore une baraque en bois). Chaque bloc comporte une chambre, une pièce avec six tables pour les études et des sanitaires. Cette cohabitation créera des liens très forts.
Pendant le premier mois nous subissons à nouveau un dur bizutage qui me fera perdre plusieurs kilos. Nous avons dû effectuer de nombreuses marches de nuit tout en reprenant normalement les cours le lendemain matin. Celui qui m'a le plus marqué, fut celui des boutons. Toute la promotion, après le repas du soir, doit tourner en rond dans le grand hall du BDE. Et puis les anciens, nous obligent à effeuiller la marguerite. Nous devons progressivement nous dévêtir et jeter nos vêtements au centre du cercle. Ceux-ci forment bientôt un immense tas d'uniformes. Les anciens coupent tous les boutons qu'ils jettent dans une caisse. Lorsqu'ils ont fini, ils vont se coucher et nous nous précipitons pour récupérer les dits uniformes qui sont heureusement identifiés par un numéro matricule cousu. Mais quid des boutons dorés. C'est le rush. Et pas question d'aller dormir : nous allons passer toute la nuit à les recoudre car nous savons que le lendemain matin au réveil, il y aura une revue de détail, passée par les officiers d'encadrement. Nos tenues devront être impeccablement étalées sur nos lits avec leurs boutons cousus. J'ai battu des records en attachant des boutons avec un seul tour de fil.
Au cours de notre instruction militaire, il y avait des exercices de combat. Certains avaient lieu de nuit. Mais nos principaux ennemis, n'étaient pas ceux du groupe d'en face : c'étaient les moustiques. Lorsque, tapis dans un fossé, nous devions rester silencieux à l'approche de l'ennemi, l'impérieuse nécessité de se donner une claque sonore sur le visage était provoquée par ces agresseurs indélicats. Nous avons bien sûr du utiliser de l'essence de citronnelle dont je n'avais jamais entendu parler auparavant.
Pourquoi tous ces moustiques ? Tout simplement par ce que le ministre de l'air à l'époque de la création de l'École de l'air (c'était le socialo-communiste Pierre Cot) avait décidé d'utiliser au sud de Salon un terrain marécageux qu'il a fallu drainer à grands frais. Il y avait également au centre un rocher qu'il a fallu détruire pour faire la piste. Pourquoi ce choix ? Il existe pourtant à quelques kilomètres à l'ouest de salon l'immense plaine aride de la Crau qui eût permis cette construction à moindre frais. Son choix n'était peut être pas désintéressé ?
Et puis en cette première année, alors que nos alliés sont déjà équipés d'avions à réaction, nous pouvons commencer à voler et à être lâchés sur de vieux Morane Saulnier 315. Le premier vol solo, a eu lieu en ce printemps 1950 à partir du petit terrain de la Jasse à mi-chemin entre Arles et Salon (je ne dis pas en herbe car il n’y en avait point ) dans la plaine de la Crau.

Morane 315 (J-F Glo)
Ces vieux avions entoilés, n'avaient pas de roulette de queue mais simplement une béquille métallique qui, tout à la fois, labourait, maintenait la direction et freinait.
Comme la toile et le bois n'aiment pas particulièrement les intempéries, il fallait les rentrer tous les soirs dans les hangars et les ressortir le lendemain matin. Il n’y avait pas de tracteurs non plus : seulement les bras. La mise en route était également tout un folklore. Ce moteur en étoile, à tiges et culbuteurs apparents, était équipé d'un système de démarrage appelé "Viet". De l'air comprimé contenu dans une bouteille, était distribué dans les cylindres dans un ordre ad-hoc par des fenêtres percées dans deux plaques qui coulissaient l'une par rapport à l'autre. Il fallait bien sûr avoir injecté auparavant de l'essence dans certains cylindres. Et on se promenait avec un seau d'essence et une grosse seringue.
Tout ceci eut été parfait, si le compresseur d'air qui était censé remplir la bouteille lors du vol précédent avait fonctionné. Mais ce n'était pas le cas et il fallait agiter vigoureusement le manche d'une pompe à main pour emplir la bouteille avant toute tentative de démarrage. Tellement vigoureusement, que je me suis retrouvé un jour en ayant dans la main droite : le manche de la pompe, la pompe, un morceau de bois du fuselage et un carré de toile.
Après le lâcher, nous avons effectué quelques vols de navigation et vu la vitesse réduite de ces appareils ils se limitaient grosso modo à faire le tour des Alpilles. Nous avons pu également effectuer quelques vols en double sur un avion un peu plus puissant : le Morane 230.

Morane 230 (Alain Picollet)
Nous avons pu être initiés au vol sans visibilité sur Morane 315. Le tableau de bord bien que sommaire, comportait, en plus de l’éternel "bille et aiguille", un horizon artificiel à entraînement par de l'air comprimé. Sur un des haubans, il y avait une petite hélice d'environ 40 cm de diamètre qui entraînait une pompe à air. Lors des vols normaux, cette hélice était attachée à l'aide d'une courroie et ne pouvait tourner. Lors des vols sous capote, il fallait prolonger le point fixe en bout de piste pour que la petite hélice envoie suffisamment d'air dans l'horizon artificiel, et le stabilise avant le décollage.
Autres détails techniques : l'interphone. Il ne tombait jamais en panne, et pour cause : il était constitué par des tuyaux de type gaz butane. Il y avait, pour chaque pilote, un cornet à l'émission et un Y, avec écouteurs, à la réception. Et c'était donc un vrai duplex. Enfin comme l'habitacle était à l'air libre, pendant les mois d'hiver il fallait porter des bottes fourrées et de chauds sous-vêtements en laine surtout les jours de mistral.
Nous avons également effectué quelques vols en passagers sur un vieux bimoteur Anson. Nous pouvions alors en mettant la tête dans une demi-sphère transparente utiliser un sextant. Il s'agissait de mettre en pratique les cours théoriques que nous avions suivis concernant la navigation astronomique et l'utilisation de cet appareil. Par la suite en tant que pilote de chasse je n'aurais jamais à utiliser ce type de navigation et à manipuler cet appareil.
Pour les cours au sol, nous pouvions faire des travaux pratiques sur quelques appareils. Il y avait notamment un Spitfire fixé au sol par des câbles et sur lequel nous pouvions effectuer des démarrages moteur. Et je me souviens que, sur cet appareil, à refroidissement par liquide, on pouvait lorsque l'on remuait la manette des gaz voir l'aiguille du thermomètre de liquide de refroidissement se déplacer avec ladite manette comme si elle lui avait été reliée mécaniquement.
J’ai retrouvé le même phénomène, 2 ans plus tard, sur P-51 en Alabama. Il fallait taxier dès la mise en route et décoller très vite. Si par hasard des avions en finale nous forçaient à attendre avant de nous aligner, c’était la "baleine". Le glycol jaillissait comme venant de l’un de ces cétacés. Il fallait couper immédiatement le moteur et le retour au parking se faisait derrière un tracteur.
Il y avait un P-47 en état de vol et l'un de nos officiers d'encadrement qui le pilotait effectuait des passages au ras du sol, à grande vitesse, et à grand bruit, qui me remplissaient d'émerveillement.
Il y avait également des appareils allemands récupérés : un Messerschmitt-262 et un Henschel He-162. Cet avion entièrement en contreplaqué était propulsé par un réacteur unique situé au-dessus du fuselage derrière la tête du pilote. Ce dernier avait un canon de 30 mm qui lui passait entre les cuisses et n'avait pas de siège éjectable.
La promotion qui nous précédait (promotion 1948), et dont les membres étaient déjà aspirants, volaient sur SIPA. Il devaient avoir une formation au VSV (Vol Sans Visibilité) assez sommaire car je me souviens qu'un jour d'orage alors que nous étions debout sur le porche du bâtiment, nous en avons entendu un passer plusieurs fois à la verticale. Au bout d'une dizaine de minutes, plus rien, il s'était planté. Et ce fut la première fois, et hélas, pas la dernière, que j'enfilais mes gants blancs, et ceignais mon poignard, pour les obsèques d'un camarade. Ce fut la dernière promotion à être entièrement formée en France.

Le SIPA S-11 (Patrick Gaubert)
Nous apprenons au cours de l'été que dans le cadre des accords de l'OTAN, nous allions en fin d'année partir aux États-Unis pour y poursuivre notre formation.
En effet les deux tiers de la promotion (dont je faisais partie) part aux États-Unis au mois de décembre. Le reste (les mauvaises langues prétendent que c'étaient les moins bons en pilotage) sera formé à Marrakech. Ils seront tous brevetés alors qu’aux US, il y a eu 40% d’éliminés ou envoyés pour une formation de navigateur au Canada.
Après un voyage en train de Salon jusque au Havre, nous voici embarqués à bord du paquebot "de Grasse". La traversée dure plus d’une semaine avec pas mal de très mauvais temps mais aussi d’agréables rencontres car nous étions une minorité parmi des passagers civils. Par une matinée ensoleillée, le 18 décembre 1950, nous découvrons la statue de la Liberté.
Séjour aux USA
Formalités d'immigration toujours complexes dans ce pays et puis départ pour le Texas à bord d'un Curtiss Commando C-46. Direction la base aérienne James Connally près de la ville de Waco. Nous y serons incorporés dans la promotion (ils disent "class") 52A.
Nous découvrons un camp qui ressemble à beaucoup d'autres de sinistre mémoire. Nous sommes installés dans de grandes baraques en bois dans lesquelles nos lits s'alignent côte à côte. Pour tout mobilier une malle métallique au pied du lit nommée "foot locker". Cette cantine dont la peinture brille est un véritable détecteur de poussière. Lorsqu'un officier d'encadrement y promène un doigt abrité par un gant blanc, et qu'il laisse une trace, nous sommes bons pour des heures de marche le week-end.
Nous sommes mélangés avec les élèves pilotes américains et quelques représentants des nations de l'OTAN (quelques anglais, des belges, des hollandais et même des turcs). Avec les sous-officiers, nous sommes 134 français (dont 59 aspirants), et donc majoritaires.
Plusieurs surprises de taille nous attendent :
- La nourriture : nous découvrons au petit déjeuner, la jelly. Une sorte de gélatine presque transparente et qui se trémousse à la moindre vibration de la table qui la supporte. Elle a un goût indéfinissable. Ce n’est ni de la confiture, ni de la marmelade. Et puis les haricots avec une sauce sucrée et j'en passe. Par contre il y avait les œufs au bacon. Un cuisinier noir, installé devant une grande plaque chauffante, nous demande :
« How do you want your eggs Sir ?
Et il y a 3 réponses possibles : « side up , overlie ou scramble » (« Comment voulez-vous vos œufs Monsieur ? » et les réponses : side up pour « sunny side up » soit le côté du soleil en haut et les œufs sont servis avec le jaune apparent ou « overlie » soit retournés d’un coup de pelle ou « scramble » et la pelle les hache 4 ou 5 fois après retournement).

Sunny Side Up
- Le PT (Physical Training) : au saut du lit, à 6 h 00 du matin je crois, nous partions pour une demi-heure de footing et gymnastique avant le petit déjeuner.
- Le bizutage : les upperclassmen (cadets d’une "class" plus ancienne, parfois seulement de 3 mois) nous en faisaient voir de toutes les couleurs. Il y avait parmi eux une majorité d'Américains mais également des élèves pilote de l'OTAN dont des français qui étaient tous sous-officiers ou soldats. Or nous étions aspirants et par une décision aberrante (ou plutôt par un manque de décision) de l'État-major de l'Armée de l'air nous avons été considérés la première année comme de simples cadets. Résultat les aspirants étaient obligés de faire des pompes ou de subir des brimades de la part de ces "anciens". Nous avons notamment été obligés de pratiquer le square meal et le chin in. Nous avons été accusés de "ne pas savoir nous tenir à table" car la main gauche doit rester posée sur les genoux sous la table. C’était d’autant plus désagréable qu’un an auparavant, nous avions subi à Salon, une semaine de bizutage et de marches de nuit de la part de la promotion 48.
- Les toilettes : à l’extrémité de chaque baraque, il y avait, en dehors de la zone des douches et des lavabos, une pièce comportant deux rangées de six sièges se faisant face. Pas la moindre cloison ou séparation. Les américains trouvaient cela tout à fait normal, ils lisaient leur journal tranquillement et lorsque certains bruits se faisaient entendre, ils disaient simplement « Morning Sir ». Trouvant cette situation insupportable, je n'utilisais ce lieu qu'au milieu de la nuit pour y être seul.
Pendant les trois premiers mois nous avons suivi des cours au sol et subi un entraînement intensif à l'usage de la langue anglaise. J'avais pris l'allemand comme première langue au lycée et l'anglais seulement en seconde. Les cours ne furent pas superflus. Comme les documents qui nous étaient remis étaient écrits en anglais, j'ai vite acquis une rare maîtrise dans le maniement du dictionnaire pendant des soirées studieuses. Cette période s’appelait le "preflight".
Mais revenons au début de notre séjour au Texas. La population de cette petite ville de Waco, située à environ 100 km au sud de Dallas, était majoritairement de religion baptiste. Cela donne un comportement très vertueux et extrêmement puritain : pas d'alcool mais du Coca-Cola et pas de boogie-boogie avant le mariage. Ils sont par contre très généreux et très accueillants. Comme nous étions arrivés quelques jours avant Noël, tous les cadets français ont été invités dans des familles qui venaient les chercher et les ramenaient sur la base. Nous étions en uniforme de l'Armée de l'air avec un écusson tricolore, portant la mention "France", sur le bras gauche.
Ma famille d'accueil m'a reçu à plusieurs reprises et notamment lors de la veillée de Noël. Ils avaient trois jeunes enfants qui me parlaient sans arrêt, notamment du Père Noël (pour eux c’était "Santa Claus") qui arrivait avec son traîneau tiré par des rennes. En essayant de comprendre et de répondre aux questions des enfants et de leurs parents, ma connaissance rudimentaire de l'anglais fut mise à rude épreuve. Malgré leur gentillesse, je rentrais à la base avec la migraine.
Comme ils allaient à l'Office baptiste, je les ai accompagnés par politesse. Pour me remercier ils m'ont proposé de m'accompagner à la messe de minuit, car pour eux, un français est forcément catholique. Et moi qui suis athée, j'ai accepté. Cette messe a eu lieu sur la base aérienne dans une baraque multicultuelle.
Sur la base et même en ville on entendait sans arrêt des chants de Noël de Bing Grosby et cela nous donnait le mal du pays.
Pendant les quelques jours qui ont précédé le début des cours au sol, nous avons également été invités à découvrir certains aspects de la vie texane. Il faut bien voir que la France de l'époque, qui sortait à peine de la guerre n'avait rien de commun avec la civilisation de ce pays. Il y avait déjà la télévision noir et blanc, le téléphone que même les enfants très jeunes utilisaient pour communiquer avec leurs copains. Il y avait des grandes surfaces avec des caddies que des serviteurs noirs (apartheid oblige) poussaient jusqu'au coffre des grosses voitures. Les maisons étaient presque toutes équipées de frigo, lave-linge, lave-vaisselle, et surtout d’un évier à broyeur qui pouvait avaler toutes les épluchures et les déchets ménagers. Même les bouteilles de coke disait la pub.
Nous avons été invités à visiter une usine de poulets. Cette entreprise qui débitait quotidiennement 17.000 poulets possédait toute la chaîne de production. Cela commençait par des champs de maïs, par des couveuses gigantesques dans lesquelles on voyait des milliers de poussins qui glissaient dans des rigoles inclinées comme s'il s'agissait de balles de golf. Il y avait ensuite de longs baraquements dans lesquels les volailles, aile contre aile, étaient nourries automatiquement. Puis la chaîne d'abattage et de découpage. Cela se terminait par la mise en boîte et le départ des camions de livraison. Cette description, devenue courante aujourd'hui, nous a sidérés en 1950.
Et puis il y avait le folklore :
- Nous avons assisté à un rodéo. Je ne savais pas que c'est une fête qui peut durer plusieurs jours d'affilée et dans laquelle les spectateurs qui occupent les tribunes mangent et boivent en regardant les épreuves. Certaines demandent beaucoup d’adresse comme le calf ropping. On lâche dans l’arène un cowboy monté sur un mustang et un jeune veau. Le compétiteur doit l’attraper au lasso. Le cheval, bien dressé se raidit sur ses pattes et fait tomber l’animal. L’homme saute à terre et doit réunir les 4 pattes du veau, les lier avec une corde, puis lever le bras. Chrono pour le vainqueur : 7 secondes ! D’autres épreuves demandent d’avoir le cœur bien accroché : chevauchage d’un mustang non dressé ou d’un bœuf musqué en tenant le pommeau de la selle d’une seule main, etc.

- Nous avons assisté à des bals en découvrant le Square dance (sorte de quadrille) ainsi que la Country Music. Et puis dans les cinémas, nous avons découvert l'horrible odeur du pop-corn.

- Les autorités locales nous ont même fait le grand honneur de nous délivrer un certificat de citoyen d'honneur du Texas. Je l'ai gardé précieusement. Il me donne le droit de franchir la frontière de l'État Lone star à étoile unique, par opposition au drapeau fédéral qui en comporte 50. Car les Texans sont très fiers. J'ai également le droit de porter des bottes de cow-boy et un chapeau de 10 gallons.
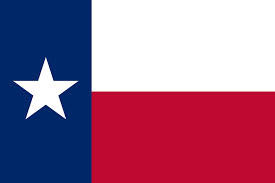
Le drapeau du Texas
Le "basic" sur T-6
La formation des cadets comportait trois phases :
- Le "Basic" : il durait environ six mois et l'avion était le T-6.
- L’"Advance" : pour ceux qui avaient terminé avec succès le Basic et qui étaient destinés à une formation de pilote de chasse une autre phase d'environ six mois utilisait le P-51 ou le T-33.
- La "Gunnery" : avec des tirs réels.
À la fin du Preflight nous sommes répartis par groupes de trois avec nos moniteurs américains. Nous allons donc commencer l'entraînement en vol et je me retrouve, avec deux camarades, confié au Lt Lapointe. Malgré la consonance très française de son patronyme, il ne parle pas un mot de français (ces 2 camarades étaient Crenn et Chapalain. Le premier aura une belle carrière à Air France et le second se tuera sur P-51 dès son retour en France).
Avant d'aborder notre entraînement sur T-6, je vais relater une expérience au sol qui m'a rendu service par la suite comme je le mentionnerai plus tard. Il s'agit de l'entraînement à la décompression explosive.
L'installation comporte deux caissons étanches reliés par une porte, étanche elle aussi. À sa partie inférieure, se trouve une ouverture circulaire, d'environ 50 cm de diamètre, obturée par une membrane transparente. Nous sommes 2 rangées d'élèves-pilotes, assis de part et d'autre avec un masque à oxygène sur les genoux. Un instructeur américain est debout au milieu avec un masque à oxygène déjà en place sur le visage. La pression de cette chambre correspond à une altitude assez faible. L'autre chambre par contre, reliée à une pompe à vide, se trouve à une pression qui correspond à environ 7 ou 8.000 m. Et puis l'instructeur donne un coup de marteau dans la membrane qui éclate.

Exemple d'une chambre de décompression de l'USAF
L'équilibre des pressions est presque instantané et nous nous retrouvons aux environs de 6.000 m. Aussitôt nous ne nous voyons plus car la baisse brutale de la pression entraîne un refroidissement et une condensation qui ne disparaîtra qu'au bout de quelques minutes. La première impression ressentie et celle d'un gonflement immédiat de la cage thoracique puisque la pression dans les poumons est toujours égale à celle qui y régnait avant la décompression. Comme prévu, nous appliquons immédiatement nos masques à oxygène sur nos visages et l'expérience est terminée.
Un autre passage en caisson, nous permet de tester notre résistance à l’anoxémie. Dès 6.000 m, certains camarades deviennent pratiquement inconscients et on peut leur enlever leurs chaussures sans ils s'en rendent compte. L'essai s'arrête à 7.000 m et je ne suis pas du tout incommodé. Cette expérience me servira presque 30 ans plus tard lorsque sur un Broussard avec le moteur réduit à fond je faisais du vol d'onde sur les pentes nord du mont Ventoux un jour de fort mistral. Ce jour là sans la moindre turbulence j'étais pris dans un gigantesque ascenseur qui devait sans doute monter à plus de 10.000 m. Mais sans oxygène et conscient du risque, je m'arrêtais à 7.000. L'instructeur nous a également appris que ce manque d'oxygène nous prive progressivement de tous nos sens avant la syncope. Mais le dernier sens qui subsiste est celui de l’ouïe. Cet enseignement me permettra quelques années plus tard de sauver la vie de mon chef de patrouille alors qu'il piquait à mort sur son F-84.
Après environ trois mois de cours au sol, nous pouvons enfin nous approcher de la "flight line". Devant une série de baraques où nous trouvons des vestiaires et des salles de cours, nous apercevons un immense parking où sont alignés, sans doute, plus de 100 T-6. Un petit train sur pneus, qui fait lentement des allers-retours sur le parking nous permet de rejoindre avec notre moniteur le numéro d'avion qui nous a été assigné. Et nous commençons les premiers vols en double commande avec pour tous le rêve d’être enfin lâchés sur T-6.
Avant de passer au déroulement de ces vols, encore un petit mot sur les baraques. Nous y trouvons enfin des toilettes individuelles avec une porte sans verrou. Mais cette porte ne va pas jusqu'au sol : elle laisse apparaître les pieds et les mollets de l'occupant. C'est quand même de mon point de vue un énorme progrès par rapport aux installations de nos baraques dortoir.
Alors que notre dernier vol à Salon, sur Morane 315, avait eu lieu début novembre 1950, nous commençons les séances de double commande sur T-6 le 16 février 1951. Notre groupe de trois effectue les premiers vols avec le premier lieutenant Wakefield avant d'être confié à notre instructeur définitif le Ltt Lapointe.

Le North American T-6
Après les premiers vols consacrés à l'effet des commandes et à l'exécution du vol en palier et des virages, nous passons à des choses plus sérieuses. Il s'agit des différents décrochages et de leur contrôle ainsi que des sorties de vrille. Il y a aussi l'apprentissage des réactions lors d'une panne au décollage. Il n'est en effet pas question de laisser partir un élève pilote seul à bord sans qu'il sache maîtriser ces situations difficiles. Ce n'est que par la suite que nous attaquons les tours de piste et les atterrissages.
On nous enseigne des moyens mémo-techniques pour mécaniser les procédures. L'un d'eux s'appelle le GUMP check (pour Gear Up Mixture Pitch soit : train rentré, mélange et pas de l’hélice réglés). Il s'effectue après le décollage. Une histoire circulait disant qu'un élève-pilote français avait confondu GUMP et jump, et qu'il avait sauté en parachute. J'espère que c'est un canular.

Tableau de bord du T-6
En moyenne, nous sommes lâchés entre 30 et 40 h de vol. Lorsqu'on voit les premiers camarades lâchés et que l'on continue à essayer d'effectuer un atterrissage trois points, plus difficile à maîtriser qu'avec un train tricycle, on commence à se poser des questions. Et puis un jour on voit arriver un moniteur plus haut gradé et nous décollons pour le Presolo check. Dans les jours qui suivent, nous reprenons les tours de piste en double commande puis soudain notre moniteur nous demande de rentrer au parking et il descend de l'avion. J'ai été lâché le 25 avril avec un peu plus de 33 h de T-6. Lorsque je m'aligne sur la piste en attendant l'autorisation de décollage, il n'y a pas beaucoup d'émotion car nous venons de faire en double commande, trois ou quatre tours de piste et les conditions extérieures à savoir le vent, la piste utilisée sont inchangés. La mécanique est bien rôdée. Par contre le lendemain lors du second vol en solo, on se sent beaucoup moins confiant car les conditions extérieures ne sont plus les mêmes. On réalise beaucoup mieux que le siège arrière est vide.
La politique de formation des pilotes dans ce pays, est extrêmement rigide. Et si au bout d'un certain nombre d'heures l'élève n'est pas capable d'atteindre le niveau prévu par le programme, il est tout simplement éliminé. Il peut éventuellement, en rattrapage, être orienté vers une formation de navigateur. Dans notre class il y a eu 40 % d'éliminés. En comparaison la partie de notre promotion formée à Marrakech a été entièrement brevetée. Lorsque deux ans plus tard, j'ai été affecté comme moniteur sur cette base de Marrakech, j'ai compris pourquoi. Je rencontrai en effet beaucoup de résistance de la part de notre hiérarchie lorsque je proposais d'éliminer un élève qui n'était pas au niveau. On estimait en effet que contrairement à la politique de l'US Air Force, si on avait déjà accordé un certain nombre d'heures de vol à un élève et donc que l'on avait dépensé pour lui une certaine somme, il était plus rentable de lui accorder de nouvelles heures de formation que d'en prendre un autre ab-initio.

Et les exercices deviennent plus variés : il faut apprendre à naviguer et à voler en patrouille. Le moniteur doit avoir le cœur bien accroché car nous sommes à quelques mètres de son appareil et notre hélice est un terrible hachoir. Il est plus rassurant d'être le leader d'une patrouille serrée composée de jets.
La navigation, bien sûr, se fait à l'estime. Les américains nomment cela le Dead reckoning et ils nous fournissent une sorte de grosse règle à calcul qu’ils baptisent pompeusement Computer. Elle permet de calculer la vitesse vraie à partir de la vitesse indiquée par le tableau de bord. Puis à l’aide d'un crayon, on dessine sur un plexiglas, situé dans un cercle pivotant, le vent météo. On fait coulisser la règle pour amener au centre du cercle la graduation correspondant à la vitesse vraie et on peut ainsi déterminer graphiquement la dérive et la vitesse sol. Ensuite tout dépend de la montre. Évidemment nous sommes bien loin de l'ère du GPS et des centrales à inertie.
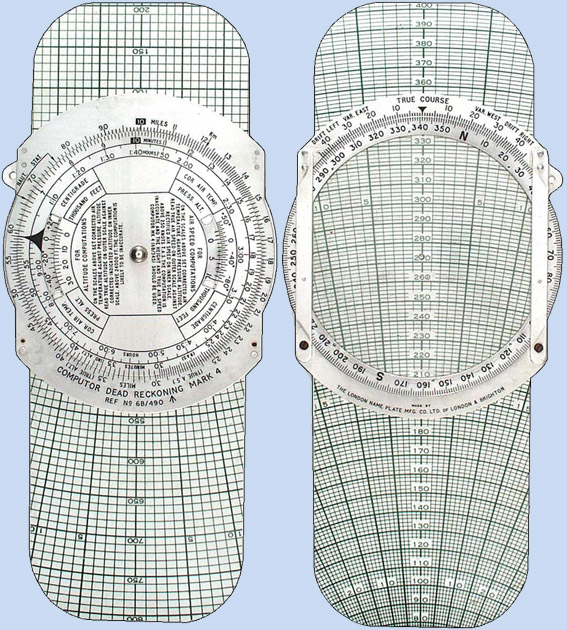
Le computer Mk 4
Il y a d'autres étapes importantes à franchir comme le lâcher de nuit, la navigation de nuit, le vol aux instruments (sous une capote en ayant uniquement la vue du tableau de bord). Les différents apprentissages sont sanctionnés par un check, toujours effectué avec en place arrière un officier différent de notre moniteur. Et puis il y a le check final.
Avant d'en arriver à notre départ de Waco, il faut mentionner quelques particularités :
- Des fins de vol qu'il sera difficile de retrouver en France. En effet comme il y a sur cette base au moins une centaine de T-6, le retour au terrain en fin de mission nécessite une grande discipline. Il faut s'aligner sur l’Entry leg. C'est une branche fictive qui est à 45° de la branche vent arrière, à la même altitude. Les avions se suivent sur cette branche à environ 500 m les uns des autres et il faut aller prendre son tour à la fin de la queue. Et cette queue fait parfois des kilomètres de long.
- En ce qui concerne le vol aux instruments, les moyens de radionavigation à cette époque, sont plus que rudimentaires. En dehors des balises dont on peut déterminer la direction à l'aide du radio-compas, le seul moyen de suivre un faisceau (Radio range) consiste à essayer d'obtenir un son continu. Et de chaque côté si il y a erreur on obtient du code morse qui est, selon que l'on est à gauche ou à droite du faisceau, soit des points soit des traits. Avec de tels moyens il est impossible de rentrer au terrain, si le plafond est inférieur à 500 pieds.
Fin juillet nous passons le Final check et quelques heures plus tard, nous terminons le "Basic" en ayant accumulé un peu plus de 130 heures sur T-6.
Nous allons maintenant passer à la seconde partie de notre formation de pilote de chasse : l'Advance.
Et là, il faut faire un choix cornélien. Nous allons être partagés en deux groupes d’égale importance, le premier ira à Phoenix en Arizona pour être entraîné sur T-33 et le second ira à Selma en Alabama sur P-51. Bien sûr à l’époque cette nouveauté que constitue le "jet", a une telle aura que nous voulons tous aller à Phoenix.
Mais notre moniteur ne l’entend pas de cette oreille. Et il nous donne judicieusement les conseils suivants :
- « Le jet, vous aurez toute votre vie pour en faire. La seule vraie formation de pilote de chasse c’est sur "Mustang" que vous l’obtiendrez. Et vous serez certainement les derniers en profiter. Ne manquez pas cette chance ».
C’est ainsi que je me retrouve, début août 1951, dans un train pour un long voyage vers l’Alabama. Je me souviens d’un pont métallique d’une longueur impressionnante qui enjambait le Mississippi. Je me souviens aussi que lors d'un arrêt dans une gare de Louisiane, un vieil employé noir voyant notre écusson France sur le bras gauche, m'a dit avec un accent traînant et inimitable :
- « Je m'appelle Jean-François ».
Nous sommes accueillis sur la base de Craig Field à quelques kilomètres de la petite ville de Selma non loin des profonds méandres de l'Alabama river. Dans cette ville du sud, peuplée par une grande majorité de noirs, règne le plus strict apartheid. Dans ce climat chaud et humide, tous les lieux publics sont équipés de fontaines d’eau réfrigérée. Mais ces fontaines sont toujours dédoublées : il y en a une pour les blancs et l’autre pour les "colored people". Dans les autobus, les blancs sont devant, les noirs derrière. Et on peut voir une foule de noirs serrés et debout derrière alors que les sièges avant sont pratiquement vides.
En 2012, me rendant au Musée de l’air et de l’espace, je prenais un bus pour rejoindre ce musée depuis la gare RER du Bourget. Dans ce bus, j’étais le seul blanc et debout, tandis que tous les sièges étaient occupés par des noirs y compris des gamins ! Autres temps, autres mœurs.
Par contre dans l’armée on ne retrouve pas cette discrimination : nous avons quelques moniteurs noirs et il y a même un major.
L’Advance sur P-51 Mustang
Nous voici sur cette base de Craig. Nous sommes sous-lieutenants et nous avons un nouveau statut. Nous ne sommes plus d’humbles cadets mais des "student officers". Fini les immenses dortoirs, nous sommes en chambres de deux avec un mobilier en bois.
Nous sommes à nouveau répartis par groupes de trois. Avec Cannac et Camper, nous découvrons notre nouveau moniteur. Le Cne Wyatt : c'est un petit homme au visage buriné. Il rentre de la guerre de Corée, il a réussi l'exploit peu banal, d'abattre un Mig-15 avec son P-51. Et lors de certaines fêtes aériennes sur la base nous admirons avec effroi sa spécialité : il effectue avec son Mustang des loopings carrés.
Nous commençons à voler avec lui dès le 14 août mais c'est toujours sur T-6. Nous alternons tantôt en double tantôt en solo l'apprentissage du vol en patrouille serrée, de la navigation de jour et de nuit ainsi que des approches GCA (Ground Control Approach, guidées par radar).
Ce n'est que fin octobre que nous pouvons enfin monter dans un Mustang. Il s'appelait encore à l'époque le F-51. C'est après 2 vols en double que je serais lâché.

North American P-51 "Mustang"
Il n'y avait pas encore à cette époque de F-51 modifiés en vrais biplaces avec une nouvelle verrière est un vrai siège arrière doté de toutes les commandes. C'est donc sur un appareil étrange, surnommé le Pig que j'ai effectué ces 2 premiers vols. On avait conservé la verrière d'origine et à la place du réservoir de carburant situé derrière le pilote, on avait aménagé sommairement un siège, un manche et des palettes fixées aux câbles du palonnier. Par bonheur le capitaine Wyatt était plus petit que moi qui ne mesure que 1 m 70. Le moniteur américain standard devait certainement voler avec l'arrière du casque appuyé sur la fin de la verrière ou avec la tête baissée en avant.
Je suis lâché le 5 novembre et au lieu d'entreprendre tout de suite des tours de piste, je dois effectuer quelques figures de voltige. J'avais constaté lors des premiers vols que pour décoller en restant dans l'axe de la piste il faut effectuer sur le palonnier des pressions de plusieurs dizaines de kilos. On avait bien ce problème sur T-6, ainsi d'ailleurs que sur tout monomoteur à hélice, mais pas du tout avec la même ampleur. Rien à voir avec les jets sur lesquels on peut pratiquement décoller en gardant les pieds sur le plancher.
J'essaye donc un premier looping et à peine ai-je le nez dans le ciel que l'avion déclenche et amorce un début de vrille. J'essaie une seconde fois et le même phénomène se produit. Au troisième essai j'observe la bille et je la vois qui part en butée dans son petit tube en verre. J'ai enfin réalisé que dans la première partie de la figure lorsque la vitesse décroît, il faut mettre des kilos à gauche sur le palonnier et que après avoir passé le sommet de la boucle et que la vitesse augmente il faut mettre des kilos à droite. Ayant compris cela, j'arrive à effectuer un looping complet avec la bille milieu. Quelques vols plus tard, je pourrais réussir mon Check out voltige dans un Pig avec en place arrière le Lt Franchi. Il était l'officier de liaison français sur cette base et les Américains, conscients de son niveau, l'utilisaient comme un instructeur F-51 à part entière.
Le moteur du Mustang était équipé d’un supercharger (turbo compresseur). Au sol il ne fonctionnait pas car la pression d’admission eut été trop élevée. Mais à 18.000 pieds, il s’enclenchait d’un coup et ne se coupait en descente qu’à 16.000 pieds. J’adorait faire des tonneaux barriqués ou des Lazy 8 vers ces altitudes. En effet alors qu’en haut de ces figures, l’avion devenait poussif, l’enclenchement du turbo fournissait au moteur un surplus d’air entraînant un sursaut rageur de la bête. Nous pouvions alors terminer la figure en grande souplesse.
Lors des premières séances de solo sur cet appareil, j'adorais aller pendant quelques minutes, et en catimini bien sûr, m'enfoncer dans les profonds méandres de la rivière Alabama. En virage serré entre 2 falaises on sentait monter l'adrénaline.
Deux apartés :
- Le congé de Noël 1951. Alors qu'en France il est impensable de monter dans un avion du COTAM sans un ordre de mission, nous avons ici une organisation fort différente. Au bureau des opérations de la base de Craig, un service s'occupe de collectionner les demandes de transport aérien. Pour chaque destination les ordres de mission ont priorité sur les permissions. Une fois inscrit dans ce service, on est libre d'aller attendre à l'Officer’s club. Dès qu'un avion a des places libres pour la destination demandée, un haut-parleur nous le signale. C'est un véritable avion-stop organisé. Il pouvait s'agir d'un avion de transport et cela ne posait aucun problème mais il pouvait aussi s'agir d'un avion d'armes. Et nous devions aller prendre en compte un parachute avant d'être accepté à bord. Il m'est arrivé de monter à bord d'un B-29 et un autre jour d'un B-25.
Et c'est ainsi que j'ai pu, avec deux camarades, aller gratuitement et rapidement de l'Alabama à Los Angeles. Il s’agissait de Cannac et de Gervaise qui avait dans cette ville une cousine française mariée à un architecte. C'est cette dernière qui avait invité notre trio pour une semaine dans la cité des anges. Pendant cette semaine nous n'avons pas beaucoup dormi. Une nuit, nous sommes entrés dans une boîte où jouait un orchestre. Et, oh surprise, comme nous étions en uniforme, lors du morceau suivant, l'orchestre a entamé la Marseillaise que nous avons bien sûr écoutée debout. Le retour vers Craig s'est effectué en car. Nous avons utilisé la fameuse compagnie de bus nommés Grey Hounds. Ce voyage retour fut long et fatigant à tel point que de retour sur la base j'ai dormi presque 24 h.

Un bus "Greyhound'
- Les Free beer party. Il y avait une fois par mois sur cette base de Craig, une soirée pendant laquelle la bière était servie à volonté à partir de petits tonnelets en aluminium. L'ambiance montait assez vite et nous chantions ensemble :
« There are no fighter pilots down in hell, down in hell » (bis)
« There are only a lot of queers, navigators, bombardiers »
(Il n’y a pas de pilotes de chasse en bas en enfer. Il y a seulement des tas de pédés, navigateurs, bombardiers)
Nous avons reçu peu après, les premiers P-51 modifiés en véritable biplaces. Ils avaient une grande verrière comme celle des T-33. La place arrière du cockpit disposait de toutes les commandes et de tous les instruments nécessaires. Elle disposait d'une capote sous laquelle l'élève pouvait s'entraîner au VSV. Le check final fut un voyage en condition IFR (Instrument Flight Rules) dans la circulation aérienne générale des États-Unis.
Comme le Mustang avait été conçu pour escorter les bombardiers au-dessus de l'Allemagne, lorsqu'il était muni de 2 réservoirs pendulaires sous les ailes, il avait une autonomie de 6 h. Ceci nous a permis d'effectuer des navigations de longue durée. Notamment lors de l'une d'elles, nous étions en patrouille de 4, censés nous poser sur un terrain éloigné du Texas. Une très mauvaise météo nous a obligé à faire demi-tour. Nous sommes revenus en vol rasant, et en zigzaguant, nous poser à Craig après un vol de 3 h 45 dont 2 h de nuit. Les flammes bleues des échappements de mes équipiers étaient magnifiques
Pour l'atterrissage de nuit, il y avait deux méthodes avec l'utilisation ou non du phare d'atterrissage. Je préférais de loin la méthode sans phare en utilisant simplement comme repère le défilement du balisage latéral de la piste. Avec le phare, ce n'est pas la piste qu'on éclairait c'était l’hélice de l'avion et notamment le grand cercle jaune formé par la peinture de l'extrémité des pales. Avec les jets, bien sur, nous n’aurons plus ce problème et malgré cela j'ai toujours préféré me poser de nuit sans phare, car avec ce dernier éclairé, on se ramenait tout simplement à un atterrissage de jour.
Et c'est après une navigation nocturne de plus de 2 h, et un total de 65 h, que j'ai effectué le 31 janvier 1952 mon dernier vol sur P-51. En descendant de l'avion, j'ai été caresser l'aile de la bête et j'étais très triste car je savais que je ne piloterai plus jamais cette merveilleuse machine. La seule escadre de France qui en était encore dotée était une escadre de reconnaissance et plus pour très longtemps.
Il y eut une cérémonie au cours de laquelle on nous remit à la fois, les ailes américaines et le macaron de pilote français. Nous étions reconnus comme pilotes de chasse mais notre formation devait être complétée par la phase de Gunnery effectuée je crois à Phoenix. Cependant, une vingtaine de sous-officiers ont été désignés pour rester à Craig afin d’y suivre la formation du PIS (Pilot Instructor School) afin de devenir moniteurs de Basic sur T-6 et rejoindre ensuite la base école de Marrakech.

À l'époque, je savais que dans nos escadres en France, on manquait cruellement de pièces de rechange et notamment de pneumatiques. Les heures de vol mensuelles étaient donc très limitées. Je me suis dit que si je choisissais de commencer par être moniteur à Marrakech je pourrais voler davantage. Je me suis donc porté volontaire pour le PIS. Ma candidature fut acceptée et je fus le seul officier à recevoir cette formation en même temps qu'une vingtaine de sous-officiers dont je devins le chef de détachement.
La Pilot Instructor School
Le stage commence presque aussitôt et dès le 12 février 1952 j'ai effectué ma première séance d'atterrissages depuis la place arrière du T6. Les tours de piste se faisaient au plus serré et j'ai effectué 20 atterrissages en 2 vols. Ce stage fut rondement mené et terminé fin mars 1952 avec 65 h de vol en deux mois. Nous avons eu d'intéressants cours de pédagogie dans lesquels on nous a appris que la base de l'apprentissage se résume en deux mots : "motivation et répétition".
Quel changement d'attitude par rapport à celle des moniteurs que nous avions connus à Salon. Ils criaient, s'énervaient et certains allaient même jusqu'à oter le manche à balai de la place arrière pour en asséner des coups sur le casque de l'élève. Ceci par ouï-dire, car le mien, un officier marinier, n'était pas comme ça.
Avant de quitter Craig, sans doute pour toujours (en effet en regardant la base sur Google Earth en 2012, je trouve toujours les pistes, le petit lac sur lequel nous avions improvisé un radeau à voile, mais plus aucun avion). Il faut que je mentionne une expérimentation qui a été menée pendant notre stage. Elle l’a été simultanément sur d'autres bases et a concerné environ 250 T-6. À la suite de plusieurs accidents mortels dans lesquels des élèves n'avaient pu sortir d'une vrille il régnait parmi eux une psychose qu'il fallait éteindre. On nous a donc demandé à chaque vol d'effectuer l'exercice suivant : montée à 9.000 pieds, partir en vrille et lâcher les commandes. Sur 250 T-6, un seul n'est pas sorti tout seul de la vrille et il en est sorti après l'exécution normale des manoeuvres préconisées.
N'ayant plus de raison de rester aux États-Unis nous devons rejoindre New York où un paquebot nous attend pour nous ramener en France. C'était l’Île de France. Je crois également qu'une partie du trajet s'est effectuée en train et j'ai découvert en tant que chef de détachement que la paperasserie française était largement dépassée par sa concurrente américaine. En effet chacun de nous disposait d'une liasse d'ordres de mission de presque 1/2 cm d'épaisseur. Cela m'était confié et j'en avais, en plus des deux miennes, une pleine cantine. À chaque étape dans un mess ou pour un couchage sur une base, il fallait en détacher un.
Arrivés à New York, nous sommes logés en attendant l'embarquement dans un hôtel non loin de Time Square. Nous avons déjà enregistré nos bagages, qui sont dans la soute du paquebot. Et presque à la veille de l'embarquement, la réceptionniste de l'hôtel me dit que quelqu'un m'attend dans le hall. Je descends pour voir de quoi il s'agit et je trouve un capitaine américain en uniforme. Il se présente comme étant un représentant de l'Air Picturial Service. C'est l'équivalent local de notre service cinématographique.
Il me dit :
- « Par accord entre nos gouvernements, nous devons tourner un film de propagande pour le recrutement d'élèves-pilote à former aux États-Unis. Je cherche dans votre groupe un volontaire pour tourner ce film. Il y aura deux autres candidats à choisir dans une promotion qui vous suit ».
Après un bref instant d'hésitation je lui réponds :
- « Je suis candidat ».
Il me dit alors :
- « Restez à l'hôtel, vous allez recevoir des instructions de la part de votre ambassade à Washington »
et il s'en va. Mon premier souci fut alors de foncer au port avec un taxi pour essayer si il était encore temps de récupérer mes deux cantines.
Tout le détachement des sous-officiers embarque le 15 février 1952. Je me retrouve seul à l'hôtel après leur départ. Et une semaine se passe. Je commence à me faire beaucoup de souci car je n'ai pas les coordonnées de l'officier américain qui m'a proposé ce deal.
Je reçois enfin un télégramme de l'ambassade. Il m'informe que le tournage du film ne devant commencer que dans quelques semaines, je dois en attendant rejoindre l'ambassade à Washington. Je laisse mes cantines chez des amis et je rejoins Washington par le train. Ce n'était pas encore un TGV, mais c'était un train rapide qui reliait les deux capitales et qui s'appelait le « congretional ».
À l'ambassade, on me confirme ces informations. Je loue donc une chambre meublée à Washington et j'attends de nouveaux ordres en jouant tous les jours au tennis avec une secrétaire de l'ambassade. Washington au printemps est une très belle ville qui n'a rien à voir avec New York. C'est l'époque des « cherry blossoms » (fleurs roses de cerisiers). C'est magnifique et je ne retrouverai un tel spectacle que des années plus tard au mois de mai au Japon. Je visite également un musée de l'aviation qui n'avait pas encore d'équivalent en France.
Un mois plus tard je reçois l'ordre de rejoindre, à New York, l'équipe chargée du tournage qui est sous les ordres d'un metteur en scène de la Warner Brothers. Je découvre que le calendrier du tournage n'a rien à voir avec l'ordre des séquences du film définitif. Il s'agit d'un court-métrage destiné à passer dans les salles françaises en première partie avec les actualités. Le titre du film sera "Ils grandiront".
Le 30 avril, je rejoins New York à bord d’un Convair T-29 et j'y retrouve à l'hôtel toute l'équipe du tournage et les deux autres pilotes (Duclos et Tierny). Un matin nous prenons une vedette rapide pour aller rejoindre au large le paquebot de Grasse qui arrive de France avec une nouvelle promotion d'élèves-pilotes. Nous montons à bord pour être filmés lors de son passage près de la Statue de la Liberté. Nous allons également dans une boîte de nuit car cela fait partie de la propagande. Nous sommes filmés près d'un pianiste noir et nous avons droit à un petit discours d'accueil de la part de Charles Boyer. Cet acteur, peu connu en France, était très célèbre aux États-Unis. Il avait accepté de tourner cette petite séquence mais, hors caméra, il nous toisait de toute la hauteur de sa célébrité.
Nous devons ensuite nous déplacer pour aller filmer l'équivalent de notre entraînement "basic" sur une base près de Tampa en Floride. On me filme en train de monter dans un T-6. Mais alors que j'ai un brevet de moniteur sur cet appareil, je n'ai pas hélas le droit de voler. Par contre nous pouvons faire du tourisme en visitant en hydroglisseur les Everglades et en allant assister à Cypress Garden à des démonstrations acrobatiques d'une équipe de skieurs nautiques.
Nous allons ensuite en Arizona sur la base de Phoenix pour filmer l'équivalent de notre entraînement sur T-33. Comme en Floride, on me filme en train de monter dans l'appareil mais je n'ai pas la possibilité de voler. Et d'ailleurs j'ai été breveté sur P-51 et c'est la première fois que je vois un jet. Ce n'est que plus de trois ans plus tard que je pourrais être lâché dessus à Meknès. Par contre il fait déjà très chaud et pour les besoins du film je dois simuler la joie d'être lâché en courant vers l'appareil, avec mon parachute sur le dos, sur une centaine de mètres. Il a fallu recommencer trois fois cette dure séquence.
Les scènes d'entraînement aux USA étant terminées, nous devons rentrer en France pour tourner en Auvergne les scènes de début du film qui concernent notre recrutement et notre entrée dans l'Armée de l'air. Mais le metteur en scène de la Warner a envie de faire un petit détour pour voir sa famille. Et nous allons passer trois jours de détente à Los Angeles.
Notre voyage retour vers la métropole s'effectue, depuis Boston, à bord d'un énorme avion : le Strato Freighter B-377 qui est dérivé de la Super Forteresse B-29. Le poste de pilotage est grand comme une salle de séjour et il y a des chambres avec des lits confortables sur lesquels l'équipage peut se reposer. C'est un avion du MAATS, l'équivalent de notre COTAM. Avec trois pilotes, il effectue le trajet Boston - Francfort - Boston avec, à chaque fois, escale aux Açores. Un autre avion nous ramène en France sur la base d’Aulnat.
Nous sommes logés dans un hôtel de Clermont-Ferrand et nous allons sur la base pour filmer les scènes de recrutement dans l'Armée de l'air, au cours desquelles, on nous remet nos uniformes. Bien sûr dans le film, je ne suis pas sous-lieutenant mais deuxième classe. Reste à tourner le tout début du film qui est censé montrer le déclic de notre vocation. Cela est concrétisé par une scène tournée au sommet du Puy de dôme. Je suis assis à côté d'une jeune et jolie figurante recrutée à cette occasion et je lève les yeux vers des chasseurs qui passent dans le ciel.
Le film étant terminé, j'ai droit à une permission avant de rejoindre début septembre la base de Marrakech.
Nous quittons donc l'équipe de la Warner Bros et notamment son metteur en scène avec lequel nous prenions tous nos repas depuis plus d'un mois. Je dois avant de terminer ce chapitre, mentionner une anecdote qu’il m'avait racontée lors de nos petits déjeuners et qui dénote un aspect très particulier de la civilisation américaine. Professionnellement, il était amené à recevoir dans son bureau de Los Angeles, de jeunes starlettes à la recherche d'un rôle. Il avait été obligé par mesure de précaution, de positionner en les cachant, deux témoins assermentés qui auraient pu le disculper si, par hasard, la fille avait simulé une agression sexuelle.
En outre, à l'époque, en France, pour obtenir une voiture, il fallait verser au concessionnaire la totalité de la somme et puis attendre environ deux ans sans aucun intérêt, pour en prendre possession. Par contre si on payait en devises étrangères, sans crédit bien sûr, on l'obtenait tout de suite. J'ai donc depuis New York commandé une 4 CV. Cette voiture avait à peine la longueur de la moitié d'une voiture américaine normale. Quand je montrais sa photo au metteur en scène de la Warner Bros, il a éclaté de rire et m'a dit :
- « Mais c'est un jouet, comment peux-tu entrer là-dedans ? Je vais en acheter une comme cadeau de Noël pour mon fils ».
Je suis libre jusqu'à début septembre. Je partage ma permission entre ma famille qui vit en Allemagne et des séjours sur la Côte d'Azur. Je suis en effet très mobile puisque l'on vient de me livrer ma 4 CV toute neuve. De passage à Aix-en-Provence, je peux, en allant au cinéma, voir projeter, avant les actualités, le film que nous venons de réaliser. Il a été monté à Los Angeles et cette fois les séquences sont dans le bon ordre chronologique.
Moniteur à Marrakech
J'embarque à Marseille, avec ma voiture, sur un paquebot à destination de Casablanca. Ce paquebot doit faire escale à Tanger. Et là, à ma grande stupéfaction, je découvre les servitudes militaires issues des habitudes séculaires de l'Armée de terre. Il y a un effet la vieille notion de garnison et de commandant d'armes. Et cela s'applique aussi à bord d'un bateau, et même pour des permissionnaires. Un colonel de l'Armée de terre assume le rôle de commandant d'armes et prend le sous-lieutenant que je suis comme adjoint. Résultat, lors de l'escale de Tanger, au lieu d'aller me détendre à terre et faire du tourisme je suis consigné sur la passerelle et je dois contrôler l'entrée et la sortie des permissionnaires.
Nous débarquons enfin à Casablanca mais nous sommes à la veille d'un week-end prolongé de trois jours et il m'est impossible de faire dédouaner ma voiture. Je ne savais pas que les règles d'immatriculation pouvaient être aussi différentes entre la métropole et un protectorat. Après ce contretemps, passé dans un hôtel de la ville avec l'impossibilité provisoire de rejoindre Marrakech, je peux enfin prendre la route. Je n'ai plus d'argent car j'avais laissé la 4 CV devant l'hôtel pendant la nuit. La portière a été forcée et ma valise qui contenait outre mes vêtements une somme d'argent et une arme avait été fouillée. On avait également volé une caméra 8 mm, un des premiers modèles à cassette, que j'avais achetée à New York. Le commissaire de police qui prenait ma plainte m'a alors déclaré avec condescendance :
- « Mais quelle imprudence jeune homme ».
Je prends enfin la route et j'arrive à l'entrée de Marrakech. Je croyais que c'était une grande ville et je fus fort déçu. En effet je ne considérais pas que l'immense "médina" était une ville et pour moi cette dernière se limitait au "gueliz". Cette partie européenne de l'agglomération était toute petite : un vrai village. En dehors d'un grand, et unique, carrefour on en sortait tout de suite. Ce fut la même surprise en faisant le tour de la palmeraie. Celle-ci n'était pas immense comme je l'avais imaginé, et surtout, entre les troncs, il n'y avait pas la moindre pousse de gazon.
J'arrive enfin sur la base aérienne (BA 707) et je suis logé dans de grands bâtiments en dur alors que les élèves sont dans des cabanes circulaires où ils sont entassés et où il fait une chaleur épouvantable. Avant notre départ du Maroc, elles seront d'ailleurs remplacées par des bâtiments en dur abandonnés peu après.
Après m'être présenté à mes supérieurs, j'entame le long cheminement du circuit administratif d’arrivée. Ce processus ne fut simplifié que de nombreuses années plus tard. Il consistait à passer dans les différents services administratifs de la base pour se faire enregistrer. Cela prenait une journée entière. Et d'ailleurs, lors d'une mutation, le circuit de départ était aussi complexe.
Je découvre mon véritable emploi ici : celui de moniteur sur T-6. Je serai second dans l'escadrille du Cne Chollet. À la différence de mes camarades sous-officiers, qui sortent comme moi du PIS, je n’aurais pas qu’à voler. Et de ce fait, chaque jour après la fin des vols, je devrais passer des heures à rédiger les ordres de vol du lendemain et à préparer les différents briefings à faire aux élèves.
J'aurais également sous mes ordres des moniteurs qui étaient déjà sur la base avant notre arrivée et qui ont été formés par la DMP (Division des Moniteurs Pilotes). Dans cette division formée de pilotes anciens ayant fait la guerre, on était jugé sur la réalisation impeccable de figures voltige. Le VSV (vol sans visibilité) n'y était pas encore enseigné. Les cadres de cette division avaient pensé que comme tout pilote affecté à Marrakech, nous devions faire un stage chez eux avant d'être utilisés. Mais heureusement, l'état-major en avait décidé autrement, et je fus chargé d'appliquer strictement, pour les promotions d’élèves-pilotes à venir, la progression définie aux USA.
Je recommence à voler le 10 septembre 1952 et après 2 vols de réaccoutumance en place avant je m'installe pour de longs mois en place arrière en tant que moniteur. J'ai essayé de voler le plus possible et j'arrivais souvent à totaliser plus de 40 h en fin de mois. Il y a quand même eu quelques interruptions :
- Premier arrêt dû à un séjour en hôpital pour une ablation de l'appendice. Les médecins m'avaient bien prévenu de faire attention lors de la reprise des vols. Je n'ai pas suffisamment tenu compte de leur conseil et lors de mon premier looping j'ai bien cru que ma cicatrice n'allait pas résister.
- J'ai été désigné pour aller pendant trois mois encadrer la formation de jeunes recrues arrivant de France. Comme j'ai essayé de faire remarquer que dans l'Armée de l'air il y a des officiers des bases dont c'est la mission, le capitaine Vanetzel m'a rétorqué :
- « Le rôle de l'officier n'est pas de voletailler ».
Je n'ai jamais oublié cette phrase et, d'ailleurs, cet officier voletaillait très peu. Je rejoins donc en voiture la base d’Oujda où il y a une piste sans avions et où les jeunes recrues effectuent leur "classes". En passant au-delà de Rabat, comme la route était mouillée et que la 4 CV qui est survireuse n'a aucune tenue de route je fais un tonneau dans un virage pris à moins de 80 km à l'heure. Je redresse la voiture, remonte le toit qui s'était affaissé en m’arc-boutant à l'intérieur et je termine mon trajet.
J'étais le seul pilote à effectuer cette corvée. Avec les autres membres de l'encadrement nous allons à Oran. Nous accueillons dans le port 300 jeunes recrues et nous les ramenons en train à Oujda. Pendant trois mois, je commande sans plaisir des 1, 2 et des demi-tours à droite. Heureusement, il y a l’instruction sur l'armement et les séances de tir qui seules m'intéressaient. Pendant la première semaine nous leur faisons passer des tests d'évaluation et je découvre avec stupeur que nombre d'entre eux font beaucoup plus de fautes dans une simple dictée que celle-ci ne comporte de lignes. Pendant ces quelques semaines j'ai quand même pu voler un peu en étant moniteur bénévole à l'aéro-club local. J'ai effectué les premières séances avec les élèves mais comme je voyais qu'il les lâchaient après seulement 7 à 8 h de vol, en n’ayant effectué que des tours de piste, je ne prenais pas la responsabilité du lâcher.
Puis je reprends mon rôle de moniteur à Marrakech jusqu'à fin octobre 1954. Je vais mentionner ci-dessous quelques détails qui concernent cette période :
- Dans la matinée, chaque moniteur prenait successivement, pendant une heure, trois élèves. Pour décongestionner la piste de Marrakech, nous allions souvent faire l’échange sur un petit terrain de déroutement situé à une cinquantaine de km (Sidi Zouine). Les élèves des deuxième et troisième tour et y avaient été amenés en Junker 52 appelé familièrement la Julie. Lorsque l'échange avait lieu à Marrakech, il se faisait à mi-longueur du taxiway et les avions redécollaient sur la moitié restante de la piste.
Comme l'été il faisait très chaud, nous faisions la journée continue. Début du travail à 5 h du matin non-stop jusqu'à 13 h 30. Puis sieste obligatoire. Et sur ce terrain de déroutement, pour garder les caisses de boissons à l'ombre, il n'y avait pas d'arbres. La seule protection contre le soleil était l'une des vastes ailes de la Julie.
Revenons à la Julie. Pourquoi ne pas essayer de domestiquer la bête ? Rien que le roulage au sol, était loin d'être évident. Il y avait des freins à air et c'est par un freinage différentiel sur les roues que l'on pouvait se diriger. Ce freinage s'effectuait en ramenant la manette des gaz des moteurs extérieurs en arrière de la position de ralenti. La manoeuvre pouvait s'effectuer en étant debout avec la tête sortant à l'extérieur du cockpit. Et l'échappement de l'air faisait un bruit de locomotive à vapeur. J'essaie de me mettre en place gauche avec à droite le capitaine Chollet. Je pousse en avant les trois manettes et en peu de temps je n'arrive pas à garder l'axe. La Julie par à 45° à droite en direction des 4 ou 5 T-6 qui sur le taxiway font l'échange des pilotes. J'entends alors à la radio l'un des occupants des T-6 qui crie :
- « La Julie ! La Julie ! ».
Je pensais que Chollet avait repris les commandes, et lui pensait que je les avais conservées. Nous sommes passés à quelques mètres au-dessus des T-6. Par la suite je n’ai plus cherché à être lâché sur la Julie et j'ai toujours volé en copilote. C'est de toute ma carrière le seul appareil dont les instruments de bord étaient gradués en unités métriques.
- Pendant cette période j'ai eu à former une promotion d'élèves cambodgiens. Ils étaient très travailleurs et avaient les meilleures notes en cours au sol. Mais en l'air leur accent rendait la communication difficile. Et lors du décollage en vol de nuit, j'avais un pied sur le levier du train et les mains sur les manettes de mélange et de pas de l'hélice.
- Nous avions appris (par des bruits qui circulaient) que certains élèves, en solo de nuit, se posaient à Sidi-Zouine pour embarquer des filles. Nous avons alors décidé qu'avec un ou deux moniteurs, nous irions tous feux éteints contrôler les points tournants de leur navigation.
- Lorsque nous arrivions à la période des tests de voltige, je devais faire effectuer des figures à noter pendant une demi-heure. Croyez-moi lorsque l'on subit des accélérations d'autant plus importantes que les figures sont mal faites, et que l'on doit baisser la tête pour écrire des annotations sur une planchette attachée à sa cuisse, il faut avoir le coeur bien accroché. Et il fallait recommencer de suite avec trois ou quatre élèves.
- J'ai également innové en programmant de l'entraînement VSV pour les moniteurs. En effet Marrakech dispose d'une météo magnifique et pour une école de début c'est le site idéal qui permet de maintenir le planning de formation des promotions successives. Cependant il arrive qu'une couche de stratus bas, venant de la mer, déborde de la petite chaîne du Djebilet et que le plafond soit trop bas pour mettre en l'air des élèves débutants. Alors que pour eux le vol était arrêté nous partions entre moniteurs pour effectuer des percées avec les moyens rudimentaires de l'époque (radio compas, radio range et variations de QDM avec l'aide d'un goniomètre au sol).
- Au cours de ma carrière, j'ai souvent eu des problèmes avec les commissaires et leur administration. En voici un exemple : il y avait en formation toute une partie de la promotion de l'École de l'air 1950. Nous étions donc amis. Les moniteurs avaient un blouson de vol en cuir et les élèves en avaient un en tissu. J'ai prêté le mien au Slt Escaig. Au cours d'un week-end, il a eu en voiture un accident mortel et le blouson n’a pu être récupéré. On m'a alors demandé de le payer. Et pour éviter cela j'ai dû profiter de la mort d'un autre moniteur (en T-6 cette fois) pour récupérer le blouson qu'il avait laissé dans sa chambre et ne pas être amputé d'une bonne partie de ma maigre solde de Lieutenant.
Ce qui va me rester de plus important de cette expérience de monitorat, c'est une véritable assurance-vie. J'ai vu commettre toutes les erreurs possibles et j'ai dû les laisser s'engager suffisamment loin pour que l'élève puisse en retirer une certaine expérience. Intervenir trop tôt n'est pas instructif et trop tard : bonjour les dégâts. Pendant tout ce séjour je n'ai eu qu'un seul accident. Lors d'un atterrissage l'élève ayant mis du palonnier à gauche, a perdu sa chaussure qui est restée coincée. Il en est résulté un magnifique cheval de bois mais l'appareil n'a pas été trop endommagé.
Cet avion est très sûr, mais il ne faut pas exagérer. Lors d'exercices d'attaque au sol, si on découvre un objectif au dernier moment, la tendance est de cabrer et de virer rapidement pour revenir dessus. Pour ne pas perdre l'objectif de vue on a la tête tournée vers l'arrière et le nez de l'avion étant dans le ciel, si l'on ne se méfie pas on arrive très vite à un décrochage qui à basse altitude ne pardonne pas. C'est ainsi que lors de manoeuvres le Cdt Robiau (de la division d'instruction) s'est tué. La même chose a failli m’arriver et j'ai récupéré in extremis. C'est vraisemblablement ainsi que nous avons perdu de nombreux T-6 lors de la guerre d'Algérie, mais j'en reparlerai plus tard.
Mais malheureusement là-bas, cela venait de se terminer douloureusement. Je vais donc, puisque je suis un chasseur être affecté en escadre. Je ne sais pas encore laquelle, mais je dois au préalable aller à Meknès pour effectuer ma "transformation jet".
Avant de quitter Marrakech, je vais évoquer quelques-unes des possibilités touristiques que permet cette belle région. Après quelques essais, je n'ai pas trop essayé d'aller à l'ouest vers l'océan. Ce dernier, contrairement à la Méditerranée, est froid et inhospitalier. Par contre la région montagneuse de l'Atlas est magnifique. J'avais en outre la possibilité de reconnaître certains itinéraires ou certaines voies d'accès en T-6 pendant la semaine et de les parcourir au sol le week-end. C'est ainsi que j'ai pu bivouaquer, sans l’abri d'une tente, à 3.900 m d'altitude au sommet du djebel Angour (en compagnie d'un élève-pilote polytechnicien, le capitaine Plessier que je retrouverai plus tard comme commandant de la base de Brétigny). Et au mois d'août dans certains creux des faces nord on pouvait encore trouver de minuscules névés. Je pouvais également monter le samedi soir à la station de ski de l’Oukaïmeden. J'étais hébergé dans le vieux bordj où il y avait une petite garnison de troupes de montagnes. Le lendemain matin de bonne heure on pouvait commencer à skier sur de la neige gros sel avant que le soleil de 11 h ne la transforme en soupe. Il restait alors la possibilité de redescendre à Marrakech et d'aller profiter dans l'après-midi de la piscine du cercle officiers.
J'avais également repéré quelques villages berbères perchés presque à 2.000 m. Dans ces hautes terres j'ai eu la surprise de trouver des noyers. C'est trop haut pour le blé et il y a de petits champs d'orge. J'y ai découvert des moissonneuses aux vêtements multicolores qui courbées vers la terre coupaient les tiges avec une simple faucille tout en chantant. Puis le chef de village est venu nous voir et apprenant que j'étais un militaire de la base, il m'a dit :
- « Je vais vous offrir le thé »
Et lorsqu'il est revenu, à ma grande surprise, avec beaucoup d'émotion, j'ai vu que sur sa gandoura blanche il avait accroché ses décorations de la Grande Guerre.
Meknès (la transfo jet)
Le 17 novembre 1954 j'effectue mon premier vol sur un réacteur : le T-33. Toujours avec un moniteur à l'arrière. Se succèdent les vols d'accoutumance, les vols en formation serrée et l'entraînement au VSV cette fois en place arrière. Le 30 du même mois, j'obtiens ma première "carte blanche" qui me donne le droit de voler seul aux instruments dans la circulation aérienne militaire. Alors qu'aux États-Unis ma qualification me permettait de voler en IFR dans la circulation aérienne générale, ce droit m’est syndicalement refusé en France. Nous sommes dans un pays où Courteline n’est pas mort. J'ai le droit de parler à la radio à bord d'un avion militaire. Mais si je prends ce même émetteur radio, sur la même fréquence, et que je l'installe sur un avion civil, je n'ai plus le droit de parler ni d'écouter. Je dois d'abord prêter serment devant un fonctionnaire des PTT. Et c'est ainsi que, contraint et forcé, j'ai obtenu le "Certificat restreint de radiotéléphonie".
En décembre, je prends contact avec un nouvel avion : le Vampire. Comme il n'y a pas de double commande, je suis pour la première fois lâché dès le premier vol. Je suis même lâché de nuit à la fin du mois. Début janvier 1955, j'effectue quelques tirs air-sol sur Vampire et je termine ainsi ma "transfo jet". Je dois quand même mentionner un incident : je décolle en patrouille serrée, par beau temps heureusement. Nous sommes en montée et à peine passé le bout de piste, mon leader se met à descendre. Je réduis les gaz et je le suis des yeux : il se crashe peu après à quelques mètres d'une station d'essence. Pas de flammes, pas d'explosion : il est indemne.
Je vais donc quitter le Maroc dans une ambiance telle que je n'y suis jamais retourné. Une bande de terroristes a investi l'hôpital de Port Lyautey, y a massacré, à la hache, médecins et infirmières. Ils se sont ensuite dirigés vers Kouribga mais grâce à notre intervention, ils n’y sont jamais parvenus.
Le sultan Mohammed V vient de rentrer de son exil à Madagascar et a obligé le vieux Glaoui à lui rendre hommage en lui baisant les pieds. En ville, certains amis des français sont massacrés et nous sommes consignés sur la base sans avoir le droit d'aller les défendre. No comment. D'ailleurs pendant mon séjour à Meknès, je suis rentré souvent le vendredi soir à Marrakech pour y passer le week-end avec mon épouse. Je passais donc de nuit en voiture par Kasba-Tadla. Et c'est sur cette route que quelques semaines auparavant trois journalistes de Paris-Match avaient été interceptés et sauvagement assassinés. Je roulais donc avec une arme chargée sur le siège de droite et j'étais prêt à bloquer les freins, à éteindre les phares et à sauter dans le fossé si des rochers sur la route avaient fait présager une embuscade.
9ème Escadre de chasse, Lahr RFA - Le F-84
C'est avec joie, que j'apprends mon affectation à la neuvième escadre. En effet, à Marrakech, j'étais logé chez mes beaux-parents et nous n'avions pas le moindre meuble. Je savais qu'en Allemagne nous serions logés gratuitement dans des appartements meublés et chauffés.
En février 1955, je rejoins donc mon nouvel escadron le 1/9 commandé par le Cne Birden. Commandants d’escadrille : Souchet et de Rolland. Le 28, je me lâche sur F-84E. Pas de double commande non plus, et après un bon briefing concernant les différents circuits hydrauliques et électriques, on met les gaz et on se retrouve seul sur la nouvelle bête.
Ma situation est un peu paradoxale. J'ai plus de 700 h de vol à mon actif mais en ce qui concerne la progression chasse française, je suis toujours élève-équipier. Au cours d'un vol en patrouille à quatre, le commandant d'escadre m'accordera cependant, quelques mois plus tard, la qualification d'équipier confirmé.
Parlons un peu du F-84E. C'est un avion à aile droite qui n'a pas encore de postcombustion. Il est donc peu puissant et lorsque l'on doit décoller avec des réservoirs pendulaires en plus des réservoirs de bout d’ailes, on atteint la vitesse de rotation après avoir parcouru 2.300 m alors que la piste n'en fait que 2.400. Et si l'on rajoute des bombes à cette configuration on ne peut décoller qu'avec l'aide de fusées JATO. Son plafond pratique est d'environ 43.000 pieds et arrivé à cette altitude on est coincé entre deux phénomènes. Leur espacement est d’à peine de 10 noeuds. Si la vitesse chute, on a le décrochage et si, en légère descente, on dépasse cette augmentation de vitesse de 10 noeuds, on ressent des vibrations qui sont la manifestation de l'impossibilité pour cette voilure d'atteindre la vitesse du son. Et paradoxalement, lorsque cela se produit, il n'est pas du tout recommandé de sortir les aérofreins. En fin d'année, nous devions recevoir un modèle ayant la même cellule mais avec un réacteur un petit peu plus puissant : le F-84G.
Quelques petites anecdotes concernant mon passage à la "9" :
- Nous allions de temps en temps faire des exercices de tir au sol sur un champ de tir situé près de Friedrichhafen au bord du lac de Constance. Au cours d'une de ces missions nous devions tirer des roquettes de cinq pouces. J'effectue mon piqué et la roquette ne part pas. Au cours de la ressource qui suit, alors que j'ai le nez en l'air dans la direction du lac, je triture machinalement les interrupteurs d'armement et ma roquette s'envole en une magnifique parabole. Elle retombe au milieu du Bodensee. Je suppose qu'elle y est toujours. Heureusement il s'agissait de roquettes à tête inerte.
- La piste de l'aérodrome de Lahr était camouflée. Elle était recouverte de larges bandes de peinture blanches ou vertes. Ces zones peintes, étaient extrêmement glissantes par temps de pluie et il ne fallait freiner que sur les zones où le béton était apparent. Le commandant en second de l'escadre, le Cdt Cardot, avait eu les pieds gelés alors qu'il rejoignait la France Libre à travers les Pyrénées. À l'atterrissage il ne pouvait pas doser son freinage. Un jour où la piste était mouillée, je leadais une patrouille de quatre avions et après le break, il se trouve que le Cdt Cardot était numéro quatre. Les trois premiers avions arrivent à s'arrêter avant la fin de la piste et heureusement, ils roulent le plus près possible des bords de cette dernière (deux à droite et un à gauche). Et à ce moment, ils voient passer le numéro quatre, qui glisse en étant orienté presque à 45° de l'axe de la piste. Il les dépasse sans heurter personne. Ce fut un vrai miracle.
- Par une belle journée, je monte en patrouille de combat vers 40.000 pieds sur un F-84. Au moment d'arriver à l'altitude où nous devions effectuer nos exercices, je vois mon leader qui part en virage engagé en quittant la patrouille. Et puis il pique à la verticale. À ce moment je me souviens de l'instruction reçue aux États-Unis concernant l’anoxémie lorsque nous sommes passés dans le caisson de décompression explosive. Je me souviens que le dernier sens qui disparaît est celui de l’ouïe. J'appuie sur le micro et je crie :
- « Oxygène, oxygène, oxygène ».
Il m'a certainement entendu puisqu’il est passé sur oxygène 100 % et qu'il a effectué une ressource qui lui a permis d'éviter de très peu la planète. Il avait eu une panne de pressurisation et le sélecteur d'oxygène en position normale ne débitait pas suffisamment.
Parmi nos missions, il nous arrivait d'aller nous poser sur certaines bases américaines de la RFA. Ceci nous arrivera beaucoup plus souvent lorsque je serai à la 13ème Escadre et j'en parlerai plus tard.
Je dois raconter deux de ces missions qui nous ont couverts de honte.
La première s'est produite alors que je me posais sur l'une de ces bases avec une patrouille légère de 2 F-84E. Après avoir refait les pleins de carburant, nous devions redécoller pour rentrer à Lahr. C'est alors que les mécaniciens américains chargés de nous remettre en oeuvre, se sont approchés de moi et m'ont dit :
- « Avec des pneus dans cet état nous ne pouvons pas vous laisser repartir ».
Ils en ont rendu compte à leur hiérarchie et on nous a changé les roues. Nous sommes repartis, toute honte bue, avec des pneus neufs.
Une autre fois je me suis posé sur une de leur base : Landstül. C'était à bord d'un bimoteur à hélices : un NC-701 (ex-Siebel 204). Cet avion était en dotation à l'escadre. Je n'étais que copilote et le commandant de bord était un commandant d'escadrille du 1/9 : le Lt Souchet. Ce vieil avion avait de très mauvais freins. Lorsque nous avons voulu repartir la tour nous a autorisé à rouler et à attendre avant de nous aligner sur la piste. La bretelle reliant le taxiway à cette dernière était en légère pente. Nous avons bien essayé, Souchet et moi, de maintenir notre position en nous arc-boutant sur les freins. Mais cette vieille carcasse continuait inexorablement à avancer lentement vers la piste. Le contrôleur de la tour s'est égosillé à nous crier
- « Hold it, Hold it !! ».
Il y avait en effet un B-52 en finale. Mais nous avancions toujours, nous avons mordu sur la piste et le gros avion a dû remettre les gaz : la honte !
Il y avait aussi une autre mission dévolue aux pilotes et la moins drôle de toutes : celle de PGA (Poste de Guidage Avancé ). Cela consistait à être détaché auprès d’une unité de l’Armée de terre pour guider par radio des avions venus les appuyer.
À cette fin, j’ai à nouveau fait un stage chez nos amis US et j’ai été certifié de l’ "Air Ground Support School".
L’une de ces "corvées" s’est effectuée l’hiver sur le plateau de Stetten. Il faisait moins 30° avec du vent. Et en fait de bonnet de fourrure pour protéger mes oreilles, je n’avais que mon calot d’aviateur. Et les Mystère IV que je devais guider sur des chars fictifs situés devant nous, tardaient à venir !!
Je risquais en outre le sourire narquois des "biffins", si ils avaient raté leurs cibles. Heureusement, ils ont fait mouche.
Transition
Dans le courant de l'été, nous apprenons que le terrain de Lahr doit être rétrocédé aux Canadiens. La 9ème Escadre va rentrer en France et aller sur le terrain de Metz. J'apprends presque en même temps que notre Armée de l'air va créer une nouvelle escadre dite "Escadre tous temps". C'est un concept américain et nous n'avons pas encore en France d'escadre de cette nature. Il y a seulement, à Tours, une escadre de chasse de nuit équipée de Vautour. Cette escadre sera équipée d'avions américains : des F-86K fabriqués comme le P-51 Mustang par North Américan. Elle devra être capable d'opérer, grâce a un radar de bord, aussi bien de nuit que dans les nuages.
Cette information m'intéresse car j'ai toujours préféré un travail technique à des évolutions brutales. D'ailleurs tous les films dans lesquels on nous montre ce genre d'évolutions, y compris celles de la PAF (PAtrouille de France ) sont pris à basse altitude. À haute altitude, les molécules d'air se font plus rares et il n'est plus question de voltige : l'on ne peut effectuer que des virages à faible inclinaison.
Cette escadre portera le numéro 13. Elle est destinée à s'installer sur un nouveau terrain en Alsace. Ce terrain situé à mi-chemin entre Colmar et Mulhouse, est encore en cours de finition. Il sera aux normes "NATO" avec une belle piste de 2.400 m. et s'appellera Colmar-Meyenheim. Cette base toute neuve sera la Base Aérienne 113 et sera commandée par le Col Rouquette. En 2013, au moment où j'écris ces lignes, la France n’a presque plus d'avions et a fermé la plupart de ses bases. Le terrain est maintenant occupé par l'Armée de terre.
La 13ème escadre sera sous les ordres du Cdt Joseph Risso (ancien héros du Normandie-Niemen). Nous n'avions pas encore reçu nos Sabre et nous serons stationnés provisoirement sur la base de Lahr en Allemagne.
Je me porte volontaire et ma candidature est acceptée. Comme les futurs pilotes de cette escadre devront être particulièrement entraînés au VSV, les Américains vont également nous fournir une dizaine de T-33 qu'ils livreront eux-mêmes sur le terrain de Lahr. Je serais dès le début, le commandant de cette escadrille. Mais pour être capable d'enseigner le VSV aux autres pilotes et de contrôler leur entraînement, je dois subir une nouvelle formation dans l'US Air Force. Avec le Lt Ferey, je vais rejoindre la base américaine de Fürstenfeldbrück en Bavière près de Munich. J’y suivrai l'enseignement du "Jet Instrument Instructor School". Nous commençons le stage le 2 septembre 1955, et en deux mois de vol sur T-33 avec des moniteurs américains, nous obtenons la qualification de "Jet Instrument Instructor". Ceci nous permettra de pouvoir contrôler, puis attribuer tous les six mois, la "Carte verte de VSV" des autres pilotes de l'escadre.
Cette base de Fürstenfeldbrück est une ancienne base de Luftwaffe. Elle comporte un très long bâtiment que les Américains surnomment le kilometerbuilding. Il y a une grande salle avec des portes en bois massif sculpté qui s'appelle la Schwörsaal. C'est là que les pilotes allemands prêtaient serment au Führer. Un jeune homme est employé comme moniteur de Link Trainer. Il avait été lâché sur Messerschmidt 262 quelques semaines avant la fin de la guerre. Je pense que la fin de cette dernière lui avait sauvé la vie. Nous avions sympathisé et lorsqu’il surveillait mes séances de simulateur, je lui demandais de guider mon approche en parlant en allemand.
Au cours de ce stage sur T-33, nous faisions des exercices de panneau partiel. Il y avait notamment un exercice d’aural null. Cela consistait à supprimer la fonction automatique du radio-compas et à rechercher le minimum de son en orientant manuellement l'aiguille. L'antenne cadre, que nous orientions manuellement, a 2 minima de réception espacés de180°. Et il faut effectuer un lever de doute. Cela fonctionne très bien lorsqu'il n'y a pas trop de vent. Mais ce jour-là, avec mon moniteur américain en place arrière, nous avions à 30.000 pieds un jet stream de plus de 200 noeuds dirigé vers l'est. Il faisait heureusement un temps épouvantable et nous étions dans la couche. Cette fichue aiguille ne voulait pas s'écarter pour nous indiquer l'approche de la verticale de la base. Finalement, nous avons dû passer une bonne vingtaine de minutes en Tchécoslovaquie. Les radars russes avaient dû nous apercevoir, mais à l'époque ils n'avaient pas de missiles suffisamment performants. Ayant remis le radio-compas sur automatique, il nous a fallu plus d’un quart d'heure plein ouest pour rejoindre Munich.
Toujours en panneau partiel, nous devions maîtriser la unusual position recovery. On nous apprenait à sortir de n'importe quelle position en utilisant uniquement : la bille, l'aiguille, le vario et l'altimètre. Nous étions autorisés, toujours sous capote, à reprendre les commandes aussi bien en haut d’une boucle qu’en virage engagé ou bien le nez vers le ciel presque en position de décrochage. Un tel entraînement eût peut-être été utile, quelques années plus tard, à l'équipage du Rio-Paris.
Nous devions également terminer le stage par un cross country. Il s'agissait d'un voyage en condition IFR vers la Grèce avec escales en Italie. Nous partons à 2 T-33. La première étape nous amène à Naples. On se pose face au Vésuve sur une piste qui n'est pas très longue et dans l'alignement de laquelle, des immeubles interdisent une approche trop plate. Les freins ont dû chauffer. Un contretemps nous ayant fait prendre du retard, nous nous apercevons que si nous redécollons en direction d'Athènes, notre séjour en Grèce sera trop bref. Nous décidons de rester à Naples. Nous sommes hébergés dans la partie américaine de la base. Nous avons 24 h pour visiter la ville. En passant près du port, je m'apprête à prendre une photo de la citadelle. Un gardien s'approche et me dit qu'il est interdit de photographier. Docile je commence à rengainer mon appareil. Mais non me dit-il :
- « Donnez-moi une petite pièce et je tournerai la tête ».
Nous nous promenons en ville avec nos deux moniteurs américains qui sont de grands blonds. Ils sont sans arrêt relancés par des gamins qui vendent des cigarettes à bas prix et vont jusqu'à proposer des filles. Comme je suis un petit brun, je ne suis jamais importuné.
En fin de stage me voici donc qualifié "Jet Instrument Instructor". Je rentre à Lahr et ma carte verte m’autorise à voler par tous les temps et de nuit sur un avion militaire. J'ai même le droit, toujours sur un appareil militaire, de faire un plan de vol et de m’insérer dans la CAG (Circulation Aérienne Générale). Ce droit m’est refusé sur un avion civil car pour les contrôleurs civils, je n'ai pas la qualification IFR et celle-ci ne peut pas être obtenue par équivalence.
En attendant de déménager définitivement sur Colmar, nous faisions avec nos T-33, de fréquentes rotations. Certaines au détriment de la douane, ce qui m’a valu quelques ennuis. Lorsque, résidant en Allemagne, nous étions mutés en France, nous avions droit à un certain quota de matériel importé en franchise de douane et de TVA. Ce quota était proportionnel à nos soldes. Mais les soldats effectuant leur service militaire n'avaient pratiquement pas de solde. Ils ne pouvaient donc ramener en France sans frais les appareils photos ou autres gadgets qu'ils avaient acquis en Allemagne. À chacun de ces voyages, je bourrais le T-33 de leurs acquisitions. J'ai été dénoncé par du personnel travaillant sur la base de Colmar. Ce traître, ou ce jaloux, a fourni aux douaniers le numéro de l'avion, le nom du pilote et l'emplacement de la pièce où étaient entreposés les colis. J'ai donc été convoqué à la direction des douanes à Mulhouse. Ce qui m'a sauvé la vie c'est que chaque paquet était identifié par le nom de son propriétaire. J'ai expliqué le pourquoi de mes transports et la direction des douanes a compris qu'il ne s'agissait pas d'un trafic. Elle a accepté mes explications : J’en fut quitte pour une remontrance.
Un jour le Cdt Risso me demande de l'amener à Colmar. Il avait une valise PN un peu trop grande pour être glissée dans la soute à bagages du T- 33. Il me dit :
- « Ce n'est pas grave je vais la prendre sur les genoux en place arrière ».
Décollage et vol sans problème, temps superbe, nous approchons de Meyenheim et au lieu d'effectuer une branche vent arrière tranquille, je décide, à tort, de faire comme à l'accoutumée un break. Nous voici à 1.500 pieds face à la piste.
J'incline brusquement l'appareil sur la gauche de presque 90° en tirant sur le manche et en sortant les freins de piqué. Cette manoeuvre aurait dû normalement donner un peu plus de 3 g. Je n'avais pas réalisé que la valise était ainsi devenue trop lourde. Le Cdt Risso n'a pas pu l'empêcher de venir s'appuyer sur le manche qui entre ses jambes était déjà en position arrière. C'est là qu'elle a rencontré le trim de profondeur qu'elle a déroulé complètement vers l'arrière. Combien de "g" avons-nous alors subis ? Quel effort sur le manche vers l'avant avant de pouvoir redresser l'appareil et le maintenir, malgré le réglage du trim, une fois la vitesse réduite ? Je ne m'en souviens plus. Comment n’avons-nous pas décroché ? Le reste du circuit et l'atterrissage se sont par la suite déroulés sans problème. Il n'y a pas eu de débriefing seulement un petit sourire complice.
Par la suite, sur des appareils à double commande, je n'ai jamais toléré que l'autre pilote ou que le passager ait un objet quelconque sur les genoux.
13ème Escadre, Lahr puis Colmar, 1er séjour
Pendant plus d'un an, je vais continuer à voler sur T-33, d'abord à Lahr puis ensuite à Colmar. Comme le premier escadron de la 13 qui sera commandé par le Cne Fonvieille tarde à percevoir ses appareils, je continue à voler sur F-84E et G. C'est d'ailleurs sur un F-84E que je vais passer une épreuve d'interception, avec une patrouille à quatre, pour obtenir enfin ma qualification de sous-chef de patrouille. Elle sera suivie par une épreuve d’assaut à basse altitude contrôlée, en place arrière du T-33, par le Cne Fleurot.
À noter pendant cette période, un vol sur T-33 vers Châteauroux. Un des tip tank refuse de se vider. Cela risque de poser des problèmes à l'atterrissage et les Américains qui n'ont pas encore été chassés de cette base par le général De Gaulle, me disent :
- « Largage ! ».
Ils ne prennent aucun risque et préfèrent sacrifier un bidon plutôt qu'un avion. Je fais donc en suivant leurs instructions un passage à basse vitesse et je largue le bidon récalcitrant entre la piste et le taxiway.
Nous convoyons également quelques F-84E vers Châteauroux où ils seront récupérés par des pilotes portugais. Je fais un voyage à 2 avions avec le Cne Fonvieille. Ce dernier qui n’avait jamais volé sur cet appareil se fait conseiller par un mécanicien pour la mise en route. Mais surtout, il ne se souvenait pas que sur cet avion, le "badin" est gradué en "statute miles" et pas en nœuds. Cela amène à surestimer sa vitesse de 15%. Et alors qu’en patrouille serrée sur lui, nous sommes en dernier virage, je sens mon avion frémir. Nous avons bien failli décrocher tous les deux !
Enfin le 16 novembre 1956 je suis lâché, ou plutôt je me lâche, sur un F-86K. Ce vol a été précédé par la lecture de toute la documentation technique. Bien sûr, elle est entièrement en anglais et ma formation aux USA a été fort utile. Nous avons également sur la base, un officier pilote américain qui nous conseillera sur la réalisation de missions fort différentes de celles pratiquées dans la chasse classique. C'est le Major Hill. D’ailleurs tout le trafic radio opérationnel, dans cette Europe, se fait en anglais. Nous utilisons l’IFF dans le rôle pour lequel il a été conçu c'est-à-dire celui d’ "Identification Friend or Foe". Ce n’est que des années plus tard que l’aviation civile le détournera de ce rôle pour en faire le "radar secondaire" et faciliter ainsi le travail de ses contrôleurs.

Le North American F-86K
Je vais découvrir sur cet appareil trois nouveautés :
- Le radar de bord. Au milieu du tableau de bord il y a un écran cathodique circulaire qui nous donne toutes les informations concernant l'interception d'un adversaire qu'on ne voit pas. Il y a également un affichage "tête haute" dans le pare-brise utilisable en ciel clair. Mais les indications de l'écran radar sont plus précises. Elles échappent en effet à toute la chaîne de miroirs mobiles et de gyroscopes qui amènent l'information sur le pare-brise. Il y a également sur ce tube cathodique l'image de l'horizon artificiel. Cet élément est fondamental dans le genre de travail que nous serons amenés à effectuer. Il y a également à gauche vers la manette des gaz un joy stick qui permet d'orienter l'antenne pendant la recherche de la cible puis d'accrocher sur cette dernière la conduite de tir.
- La post combustion. En français on dit la réchauffe mais tous les pilotes la nomment plus prosaïquement la PC. Elle permet des temps de montée que nous n'avions jamais connus au détriment d'une consommation élevée. Il y a également une notion nouvelle : celle de la position des paupières. Ce sont 2 coquilles mobiles, mues par des vérins, qui permettent d’adapter le diamètre de sortie des gaz brulés à leur débit. Un instrument sur le tableau de bord nous informe de leur position. Si elles se bloquent en position ouverte alors que la PC n’est pas allumée, il n’y a presque plus de poussée. Heureusement nous disposons d’une commande manuelle.
- Il y a enfin les ailes en flèche qui permettent d'approcher sans problème le "mur du son". Je dis bien approcher car nous n'irons guère au-delà. Nous étions autorisés à effectuer la manoeuvre à la verticale de la forêt de Haguenau. Il fallait monter à 45.000 pieds et basculer très doucement en piqué à la verticale, toujours pleine PC. Au bout d'un moment, qui paraissait très long, l'aiguille du machmètre atteignait le 1 fatidique. Une fois, j’ai même atteint 1,06. C'était la seule indication perceptible car l'avion ne frémissait même pas. On pouvait alors amorcer la ressource qui se terminait à une altitude raisonnable. Nous pouvions dès lors intégrer un club relativement fermé à l'époque et avoir le droit d'en porter l'insigne : il s'agissait du Mach buster club. Cet insigne, fourni je pense par North American était un minuscule F-86K, en argent, vu de trois quarts.

La "13" au temps de sa splendeur
Tout en restant le commandant de l'escadrille des T-33, je poursuis mes vols à Colmar en alternant T-33 et F-86K de l'escadron 1/13. Tout se passe bien jusqu'en avril 1957. J'ai déjà une bonne expérience des missions sur ce F-86. J'ai passé les stades du lâcher de nuit puis des interceptions de nuit. Je dois aller faire une démonstration d'atterrissage court sur la base de Tours. Sur mon carnet de vol, une écriture qui m'est étrangère, a marqué la base de Lahr mais je pense que c'est une erreur.
Donc j'avais présenté cet avion à une journée des bases, j'avais utilisé le parachute de queue et fait une démonstration d’atterrissage court. J'avais demandé qu'on amène un autre parachute pour le voyage retour mais le chef des opérations de la 13ème escadre, qui était à l'époque le Cdt Fleurot, ne l’a pas jugé nécessaire. Par la suite il a nié ce refus.
C'est la raison pour laquelle je voulais, à tout prix, me poser sur les tous premiers mètres de la piste.
Après avoir effectué un Peel off, j'ai touché des roues en effleurant le sol sur l’overrun à environ 8 m du début du béton. En temps normal il ne se serait rien passé mais ce jour-là, une petite tranchée avait été creusée en travers de l'overrun pour passer un câble électrique. Comme elle n'avait pas été rebouchée, elle était bordée par un petit remblai. Ce dernier m'a brisé la jambe du train principal à gauche.
Le train est fait pour encaisser des efforts verticaux. Mais dans le sens horizontal il est fragile. Je n'ai donc pratiquement rien ressenti et ce n'est qu'un peu plus tard que j'ai vu que mon aile gauche s'affaissait. Tant que la vitesse me l’a permis, avec le manche à fond à droite, j'ai pu maintenir l'appareil sur la piste. Mais l'aile gauche a fini par toucher le béton et l'appareil est aussitôt parti à 45° à gauche en labourant les galets de la plaine du Rhin. L'avion a parcouru 800 m puis s'est arrêté. Heureusement que c'est le train gauche qui a été plié. De l'autre côté, j'aurais pu traverser le taxiway et percuter la rangée des appareils alignés sur le parking.
Pendant ces quelques secondes qui m'ont paru un siècle, les secousses étaient terribles. Malgré les sangles de mon harnais serré correctement, mon casque se heurtait violemment aux côtés de la verrière. Puis dans le silence revenu, j'ai vu un nuage dans lequel il m’était extrêmement difficile de distinguer si il s'agissait de poussière ou de fumée (car la terre était sèche). Il est difficile d'imaginer ce que peut être la peur du feu. Je parvins après avoir coupé la batterie pour éviter l'incendie à soulever la verrière qui normalement est mue par un moteur électrique.
Le véhicule d'alerte incendie était sur les lieux moins d'une minute plus tard et le chef des pompiers fort étonné de me trouver debout à côté de l'appareil, alluma une cigarette. Moi qui ne fume jamais d'habitude je l'ai consommée en silence. Une visite médicale n'a rien décelé d'anormal à ma colonne vertébrale. J'aurais pu en profiter pour obtenir une pension d'invalidité mais je voulais à tout prix continuer à voler et je n'ai rien demandé.
L'avion, trop endommagé, n'a pu être réparé. Et j'ai su que le commandant de la base a eu des ennuis à cause du non balisage de cet obstacle.

Le 1er CATAC à Lahr (Commandement Aérien TACtique)
J'ai écopé d'un mois d'arrêts de rigueur pour indiscipline en vol à cause du Peel-off, pas à cause de l'accident (les hypocrites !). Pourtant en cas de conflit, le Peel off est le seul moyen qui permet de réduire le temps pendant lequel l’appareil est vulnérable. On arrive près du sol et on part dans une boucle située dans un plan à 45° de la verticale en réduisant les gaz et en sortant les aérofreins. La vitesse chute beaucoup plus vite que dans un break à l’horizontale. On peut se poser en moins d’une minute. C’est alors qu’il était sans défense, avec le train sorti, que le fameux Col Novotny s’est fait descendre sur son Messerschmitt 262. J'aurais vu au fil des ans interdire tous les exercices un peu dangereux et qui avaient pourtant une importance décisive en cas de conflit. Par la suite, lorsque dans l'entourage du général de Gaulle on tirait à la courte paille celui qui devrait se dévouer pour aller lui annoncer qu'on avait perdu un avion, d'autres exercices ont été interdits. Armée de l'air ou aéro-club ? Fin de la digression.
Je me suis donc retrouvé muté à l'État-major du 1er CATAC situé dans la ville de Lahr et qui était alors commandé par le sympathique Gal Stehlin. Ce dernier nous racontait qu’étant avant la guerre, attaché militaire à Berlin, il avait connu personnellement le maréchal Göring.
J'étais dans le même bureau que le Cne Labansat, que je devais retrouver plus tard comme général commandant la quatrième région aérienne à Aix-Les-Milles. Dans le même bureau, il y avait un commandant grand et mince qui, dans ma vieille mémoire, s'appelait Pichoff. Mon ami Jean Houben me dit que je me trompe. Mais l'image que j'ai de cet ami est bien réelle. J'ai perdu de vue la plupart des officiers de cet état-major et nombre d'entre eux ont disparu. Il m'est donc impossible de vérifier le nom mais je suis sûr de l'histoire. Je l'appellerai donc X.
J'étais resté abonné à la 13ème Escadre de Chasse où j’allais voler sur F-86 et le commandant X volait lui sur RF-84F. Il décollait de la piste de Lahr qui était sur le point d'être abandonnée par la 9ème Escadre de Chasse qui déménageait vers Metz.
Je me souviens de ce matin où il m'a dit en quittant le bureau je vais faire un tour de 84F. Il avait hélas décidé d'emmener sur la base son épouse et ses deux enfants. Il voulait qu'ils puissent assister au décollage.
Ils y ont assisté mais : une minute après le lâcher des freins, le réacteur a explosé. À l'époque il n'y avait pas encore de sièges éjectables zéro-zéro. Entre le moment où la vitesse permettait encore d'engager la barrière d'arrêt, et celui où la vitesse et l'altitude permettaient, à condition d'avoir une vitesse verticale positive, l'utilisation du siège éjectable, il y avait une bonne minute sans issue. Ainsi a disparu mon ami X . Il y a d'ailleurs eu plusieurs accidents similaires sur ce type d'appareil. (1)
Une fois de plus, j'ai dû mettre les gants blancs et accrocher le poignard.
J'ai pu reprendre mes vols sur T-33 et sur F-86K en allant passer chaque mois quelques jours à Meyenheim. J'ai dû les interrompre de la fin novembre jusqu'en février 1958. En effet le chef d'état-major du premier CATAC avait décidé que, au sein de son état-major, j'assumerais le rôle d'officier spécialiste ABC (Atomique Biologique et Chimique). J'ai donc effectué à Bourges dans l'Armée de terre un stage ABC. Et puis, à nouveau dans l'US Air Force un stage nommé "NATO nuclear weapon employment course".
Les bâtiments au sein desquels j'ai suivi ce stage, se trouvaient près d’une jolie petite ville de Bavière : Oberammergau non loin de Garmishpartenkirchen. C'est dans cette ville que, tous les cinq ans, une grande partie de la population se déguise et joue : la passion du Christ. Ceci attire bien sûr de nombreux touristes. Mais cette région a d'autres attraits : c'est également une station de sports d'hiver. Un petit train qui part de la plaine monte ensuite à la Zugspitze qui culmine à près de 3.000 m et se trouve sur la frontière autrichienne. Les derniers kilomètres de la voie ont été creusés dans la montagne et la gare terminale est souterraine. Cette région est également aménagée pour la détente des permissionnaires américains. J'en ai profité pour skier gratuitement. J'ai également pu dîner au bord d'une patinoire et assister au spectacle de "Holiday on ice".
Revenons à ce stage où je suis le seul français. En un mois, on m'enseigne les rudiments de l'analyse d'objectifs. Il s'agit de déterminer en fonction des objectifs à détruire et de la précision du vecteur utilisé pour le lancement, des modalités d'utilisation de l'arme nucléaire. Notamment il faut choisir la puissance de la bombe et l'altitude de l’explosion. Il y a également des cours sur la protection contre les radiations et le calcul des zones de retombée des poussières et des intensités que l'on peut y trouver. J’ai accès à des documents intéressants.
Parmi les stagiaires il y a des Américains des trois armes. J'ai droit pratiquement à tous les cours mais ne peux assister à certaines présentations qui ont lieu dans le sous-sol. J'ai fini par savoir qu'on leur montrait une maquette de l'arme. Dès mon retour à l'état-major du 1er CATAC, je suis convoqué à Paris où je rencontre discrètement des techniciens du CEA qui me posent des questions auxquelles j'ai beaucoup de mal à répondre. Je peux cependant leur dire que l'on m'a parlé d'une arme dans laquelle, les conditions critiques ne sont pas obtenues par le rapprochement de 2 masses d’uranium mais grâce à la concentration d'un coeur sphérique de plutonium par un explosif classique.
De retour à Lahr, je vais avoir à rédiger des consignes pour la protection de nos bases et le desserrement des appareils sur les "marguerites". Je devrais également instruire des personnels sur l'utilisation des appareils de détection. À cette fin on m'a procuré une source de cobalt 60 de une curie. On peut la détecter à plusieurs dizaines de mètres. En dehors des exercices, que je fais effectuer sur nos diverses bases, je la conserve dans un gros cylindre en plomb. J'avais aussi ramené de la documentation et notamment l'ouvrage "Effects of nuclear weapons". J'ai rédigé un fascicule décrivant les dommages que subirait l'une de nos bases lors de l'explosion aérienne d'une arme de 100 kilotonnes.
On m'avait également expliqué pendant ce stage, comment on pouvait construire des abris très efficaces et peu coûteux. Ces abris pouvaient protéger aussi bien de bombardements classiques que des radiations issues de retombée de poussières radioactives. On pouvait, à l'aide d'un engin de terrassement creuser une tranchée d'une vingtaine de mètres de long ou plus. On y insérait ensuite des arceaux métalliques que l'on pouvait recouvrir avec la terre qui venait d'être extraite. Ces arceaux, en tôles épaisses, avaient la même structure que les palplanches que l'on enfonce dans le sol dans certains ouvrages maritimes. Le remblai de terre qui les recouvrait protégeait efficacement des rayons gamma.
Nous disposions de crédits en marks pour les acheter en RFA. Cet achat fut effectué et nous avons pu aménager des abris sur la base de Bremgarten. On a commencé à creuser des tranchées sur nos bases françaises de Dijon, Luxeuil et Saint-Dizier.
À ma grande surprise, lorsqu'il a fallu transporter les arceaux sur ces trois bases, la douane française s'y est opposé. Les interventions du Gal Stehlin n'ont rien pu y faire. Les matériels achetés avec ces crédits devaient rester en RFA. Ils y sont restés et ont dû y rouiller. Les abris sur nos bases de France n'ont jamais été réalisés.
La 13ème Escadre - Escadron 2/13 Alpes
Finalement, le Gal Stehlin a eu pitié de moi. Il a estimé que ma punition avait suffisamment duré et il a obtenu que je sois réaffecté à la 13ème escadre. On y avait entre-temps créé l'escadron 2/13 commandé par le Cne Brisset. Au cours de l’été 1958, j'ai rejoint Meyenheim comme commandant en second de cet escadron.

Le North American F-86K "Sabre"
Un an plus tard, le Cne Brisset nous quitte et on me confie le commandement du 2/13.
Avant de reprendre un certain nombre d'anecdotes typiquement aéronautiques et vécues sur ce brave F-86K, je voudrais consacrer quelques lignes aux contraintes administratives d'un commandant d'unité.
Je crois savoir que cette manie remonte à la cuisante défaite que nous avons subie en 1871. Cela a bien sûr commencé par l'Armée de terre, mais s'est rapidement propagé à l'Armée de l'air quand elle a été constituée.
On confie la responsabilité de l'existence des matériels (et non de leur état) aux commandants d'escadron. On leur donne le titre pompeux de "détenteur dépositaire". Bien sûr les échelons supérieurs de commandant d'escadre et de commandant de base s'en lavent les mains. Donc lorsque le Cne Brisset nous quitte, je dois signer des documents pour prendre en compte le matériel de l'escadron.
Il y a dans l'Armée de l'air 2 sortes de matériels : les matériels de commissariat et les matériels techniques. Les premiers sont gérés par les commissaires et les seconds par la DCMAA (Direction Centrale des Matériels de l’Armée de l’Air).
Je me trouve donc personnellement responsable et sur mes finances propres de ces matériels. Et d'ailleurs au cours d'un exercice de desserrement pendant lequel nous avons vécu sous la tente à quelques kilomètres de la base, on m'a imputé des piquets de tente en bois et des couvertures. Je suis également détenteur des vêtements spéciaux de nos pilotes et j'ai dû payer quelques caleçons longs qui manquaient.
Le plus révoltant dans cette affaire, c'est que les injonctions à payer sont adressées directement à mon domicile par la direction du Trésor public.
Lorsque des matériels de commissariat sont en mauvais état et que l'on veut pouvoir les retirer de la liste, il faut passer par une commission de réforme. Et c'est un officier supérieur du Commissariat qui préside la commission permettant ce transfert (fût-ce pour des couvertures ou des piquets de tente) vers l'administration des domaines. Dans le cas des matériels techniques qui en général sont beaucoup plus onéreux, c'est un sous-officier mécanicien qui peut décider que le tube émetteur d'un radar de bord ne fonctionne plus et doit être mis au rebut. D'ailleurs lorsqu’un contrôleur général des Armées passe dans l'unité et vérifie la concordance des fichiers et des matériels, il accorde beaucoup plus d'importance aux caleçons longs qu'aux moteurs d'avion. Mon officier mécanicien m'avait d'ailleurs signalé que sur le bimoteur de liaison que j'avais en compte, sans l’avoir jamais vu à l'escadron, j'étais détenteur de trois moteurs. Cela n'a pas intrigué le contrôleur. Quid de l’utilité de ce corps du contrôle ? (les planqués de la République !!)
Sur ces entrefaites, j'apprends que je suis également détenteur dépositaire des matériels de mobilisation. Ces matériels comprennent de nombreux véhicules permettant la vie à l'extérieur de la base en cas de desserrement. Certains peuvent s'agrandir en faisant coulisser les côtés et constituer une salle d'opération. Il y a même des remorques douches et toilettes. Ils avaient été achetés sur des crédits "Mark" et étaient censés rester en Allemagne. Ils sont enfermés dans un hangar dont l'accès m’est refusé. Il y a notamment une remorque salle météo, et rien que pour elle, il existe plusieurs pages d'inventaire et je serais responsable sur ma maigre solde de capitaine de la disparition du moindre crayon.
Que croyez-vous qu'il advint ? J'ai refusé de signer la prise en compte de ces matériels. Et par la suite, j'ai constaté que dans mes notes, il était mentionné que le commandement de mon escadron n'avait pas été une réussite. No comment !
Une autre singularité, liée aux vieilles habitudes de l’Armée de terre : la notion de garnison. Pour ne pas subir des contraintes, le commandant de la base avait décidé que sa base ne ferait pas partie de la garnison de Colmar. Mais toutes nos familles étaient logées à Colmar. Or on n’a pas le droit de sortir de sa garnison sans permission. En cas d’accident sur le trajet, nous n’aurions pas été couverts. Cette règle était tout à fait compréhensible à l'époque où l'on se déplaçait à pied ou à cheval. Mais au XXe siècle … Comment résoudre ce dilemme ? Tout simplement en gardant sur nous une permission permanente qui nous permettait de ne pas être en infraction lorsque nous rejoignions nos familles le soir ou au petit matin.
Avant de passer à des souvenirs qui concernent la raison d'être de cette escadre, c'est-à-dire à sa fonction opérationnelle en pleine guerre froide, évoquons encore la rigidité de notre administration.
Notre système de défense aérienne européen était très intégré. Lorsque nous décollions pour un exercice d'interception, nous étions d'abord pris en compte par un radar français mais nous pouvions très bien poursuivre la mission sous le contrôle d'un radar allié. C’était le "hand over". Et en fonction de la localisation géographique de la fin de cette interception, nous devions, faute de carburant, aller nous poser sur une base de nos alliés. Cela se produisait plusieurs fois par mois et si c'était aux heures de repas il fallait bien aller se restaurer avant de repartir. Et là il fallait mendier un ticket repas à un pilote américain ou canadien. Ils se sont toujours acquittés avec le sourire de cette aumône faite à un pauvre français.
Pour résoudre ce petit problème, j'ai demandé que l'on puisse fournir à nos pilotes, qui étaient en alerte, une enveloppe contenant un dollar américain, un dollar canadien, et une livre sterling. Quelle montagne n'avais-je pas soulevé : il a fallu plus d'un an pour obtenir satisfaction. Cette enveloppe était scellée et il fallait signer sa prise en compte avant d'aller prendre l'alerte en bout de piste.
Revenons à un certain nombre de souvenirs concernant directement notre vie avec ce brave F-86K et à son utilisation opérationnelle.
Certaines aventures avec nos amis canadiens du terrain de Gros Tenquin : ils étaient dotés d'un autre F-86 qui n'avait pas de radar, était plus léger et virait mieux que le nôtre. En effet lorsque nous avons touché nos premiers F-86K, qui étaient livrés par les Américains dans le cadre de l'OTAN, notre modèle possédait des ailes avec un bord d'attaque fixe et qui étaient plus courtes. Les Américains d'ailleurs n'ont jamais été dotés du K, ils utilisaient le D qui lui ressemblait fort car doté d'un radar.
Les pilotes canadiens, excellents en Dog fight (combat tournoyant) finissaient presque toujours dans notre queue. Et puis un ou deux ans plus tard, nos ailes ont été modifiées. Elles ont été rallongées et dotées de fentes mobiles de bord d'attaque qui sortaient automatiquement à partir d'un certain angle d'incidence. La manoeuvrabilité de l'appareil en a été fortement améliorée. Et nous faisions alors jeu égal avec eux. Mais nous leur avons réservé une grosse surprise, qui n'a duré hélas que quelques mois. Leur jeu préféré lorsque nous engagions un combat, était de se précipiter vers un gros cumulus en virage serré d'un côté puis d'inverser brutalement le virage à l'intérieur du nuage. Il eût été alors difficile à un chasseur normal de deviner dans quel sens se ferait la sortie du nuage. Mais avec un radar plus de problèmes, revenus en ciel clair, à leur grand étonnement, nous étions toujours derrière. Même étonnement lorsqu’en ciel clair, ils breakaient vers le soleil. Le poursuivant aveuglé les perdait de vue. Mais avec un petit tube cathodique, tout rond au milieu de la planche de bord : on ne les perdait plus.

Canadair CL-13 "Sabre"
Un jour l'un d’eux m'a tiré d'un bien mauvais pas. Il faisait un de ces mauvais temps courants dans la plaine du Rhin en hiver : plafond bas, visibilité nécessitant une approche guidée par radar et couches montant jusqu'à 43.000 pieds. Nos appareils étaient équipés d'un poste radio UHF à lampes : un poste unique. Était-ce un problème de fiabilité du matériel ou un défaut de maintenance, je ne suis pas sûr de la réponse (bien que penchant pour la seconde hypothèse). Car les F-86 canadiens, équipés du même appareil, ne signalaient pas ces ennuis). C'était le seul problème sur cet appareil qui par ailleurs était très fiable. Nous avons eu de nombreuses pannes, entraînant des situations dramatiques. Pourtant le "fuel control" qui réglait l'arrivée du carburant dans les chambres de combustion, et était d'une technologie à lampes, ne nous a jamais lâchés. Nous en aurons d'ailleurs un bon exemple un peu plus loin dans la suite de ce récit.
Je décolle pour une mission d'interception guidée par le radar de Drachenbronn. J'effectue au-dessus de la couche quelques interceptions guidées sur des plastrons qui je crois n’étaient pas de la 13. Et puis, alors que je n'avais aucun appareil ni en vue ni même au radar, la radio tombe en panne. Notre avion même avec des bidons de 600 litres n'avait pas une grosse autonomie, d'autant plus que la montée avec postcombustion était très gourmande. Avec une telle météo tenter une percée au radio compas n'était pas raisonnable. J'applique donc la seule procédure recommandée dans ce cas de figure : je tourne en rond à la verticale de la base, régime économique pour réduire la consommation de fuel et je passe mon IFF sur Emergency. Je tourne, je tourne. J'espérais que le radar français verrait mon signal et ferait décoller de Colmar un autre F-86K qui viendrait me guider. Hélas, soeur Anne, je ne vis rien venir. Les yeux sur le jaugeur et sur la montre, je me disais :
- « Dans 10 minutes c'est l'éjection ».
J'avais presque la main sur la poignée, sans avoir vraiment envie de tirer dessus car j'étais bien au chaud et je savais que dehors il faisait -60°.
Et soudain le miracle : un F-86 rassemble sur moi et bat des ailes pour que je le suive. Mais il n'avait pas un gros nez noir comme les nôtres : c'était donc un Canadien. Son radar sol avait vu mon signal de détresse et l'avait fait décoller de Gros Tenquin. Chapeau les contrôleurs français ! Ils devaient jouer au tarot ou regarder la télé ? Patrouille serrée, je lui fais le signe visuel de la panne radio et il amorce aussitôt une percée. Là j’ai vraiment collé à son saumon. Il a fait un GCA et a donc pris l’initiative de passer sur la fréquence de l’approche de Colmar. Quand j'arrive en vue de la rampe d’approche un battement d'ailes et il disparaît. Il me restait à peine un peu plus de 100 litres dans les réservoirs. Je n'ai jamais connu son nom et je n'ai jamais pu le remercier. Je regrette aujourd'hui de ne pas avoir pris l'initiative de téléphoner à Gros Tenquin pour les remercier.

Un autre "Sabre" canadien
Une autre histoire de panne radio. Il faisait ce jour-là à peu près la même météo, avec en outre des averses de neige. Nous décollons à deux avions et effectuons une montée en patrouille serrée pour faire une série d'interceptions au-dessus de la couche. La mission se déroule normalement, et puis alors qu'il était temps de rentrer à la maison, ma radio tombe en panne. Nous rassemblons à vue avec mon équipier qui était un jeune pilote arrivé depuis peu à l'escadron (le Slt Duhamel). Je n'avais pas encore eu le temps de le juger, et donc de connaître le degré de confiance que je pouvais accorder à ses réactions. Nous rassemblons en visuel et je lui fais, depuis mon cockpit, le signe de la panne radio. Je réduis ma vitesse pour qu'il passe devant. Je vois qu'il réduit également la sienne pour rester derrière. À ce petit jeu nous aurions pu décrocher. Il finit par comprendre et je lui fais signe d'amorcer la descente.
Celle-ci se déroule normalement et nous voici au palier précédent le GCA, à 1.500 pieds. Notre appareil n'était pas encore équipé de DME et je m'étais donc pas à même d'apprécier à quelle distance de la piste nous nous trouvions. En outre la visibilité était très faible et je ne pouvais que jeter de furtifs regards sur mon tableau de bord. La piste de Meyenheim est orientée au 200 et nous étions bien à ce cap. À cette altitude, cela permet de voler parallèlement au relief des Vosges ou de la Forêt Noire sans prendre de risques.
Et tout à coup, panique, il vire de 45° vers la droite : droit vers les Vosges ! Je n'ai pas d'autre alternative que de rester dans son aile en essayant de ne pas perdre de vue son saumon. Un bref calcul mental me révèle que dans trois ou quatre minutes, à ce cap et à cette altitude, nous allons percuter les premiers contreforts des Vosges. Je me prépare à l'éjection car à quoi bon percuter à deux. À ce moment-là, oh miracle et soulagement, il amorce un virage à gauche et le poursuit sur 180°. Toujours sans radio je me demande bien ce qui peut se passer dans sa tête, et nous nous dirigeons vers la Forêt Noire. Ce que j'ignore, c'est que le terrain de Colmar vient de passer rouge et que l'approche vient de le diriger sur le terrain de Bremgarten de l’autre côté du Rhin. Descente, sortie du train et après un excellent GCA nous voici posés à Bremgarten : ouf !
On répare ma radio. Et là, n’ayant pas envie de coucher à Brem, alors que la météo s'améliore légèrement, je décide après avoir fait les pleins de rentrer en vol à vue sur Meyenheim. J'ai pris là une très mauvaise décision. Après un décollage en patrouille serrée, avec moi comme leader cette fois, nous nous sommes retrouvés à 3 ou 400 pieds sol dans des averses de neige. Et seule une excellente connaissance des environs de la base nous a permis de rentrer sains et saufs au bercail.
Heureusement, le F-86K outre le désembuage classique du pare-brise par l'intérieur, possédait un système de dégivrage extérieur extrêmement efficace qui consistait en un soufflage d'air chaud, prélevé sur le compresseur, parallèlement au pare-brise : la neige ne collait pas. Un tel système m’eu été très précieux quelques années plus tard lorsque j'effectuai au CEAM de Mont-de-Marsan les premiers vols de nuit du Mirage III C.
Il se trouve que le Slt Duhamel (sous-lieutenant à l'époque) après avoir lu mon récit sur le site "Histoires d'aviateurs" de Jean Houben m'a envoyé un mail précisant comment il avait de son côté vécu cette aventure. Je me permets d'inclure ci-dessous une partie de sa réponse.
Bonjour,
Le piégeard de la promo 56 que je suis, salue son ancien de la 49 (et au passage bien sûr la mémoire de "Le Cong" : notre parrain).
Ce faisant, le sous-lieutenant que j'étais au 2/13 salue le capitaine commandant de l'escadron 2/13 que vous étiez à la même époque. Mais ce faisant aussi, le jeune pilote que j'étais à la dite époque, salue le chef de la patrouille de F-86K qui, un certain jour de mars 1960 (le 21 précisément), a été déroutée sur Brem cause météo, avec son leader en panne radio.
Je n'ai pas oublié le déroulement de ce vol, un tantinet épique, ainsi que vous l'avez évoqué. Mais je ne l'ai pas oublié non plus pour quatre autres raisons.
- Première raison : au cours de la première phase de notre percée sur Colmar, votre panne radio m'a paru suspecte. Convaincu qu'elle était simulée et qu'il s'agissait donc d'un exercice, je trouvais tout de même un peu "raide" que mon premier vol avec mon commandant d'escadron soit l'occasion de me tester ! (j'étais présent à l'escadron depuis un mois et je totalisais royalement 16 heures de vol sur l'appareil). Cette prévention de ma part a fini par se dissiper quand raisonnablement, dans les stratus à 1.500', au cap 240 vers les Vosges, je me suis dit qu'avec un autre que moi : la manœuvre pouvait être suicidaire ... et que donc la panne devait être réelle !
- Deuxième raison : je n'ai pas oublié la "délicatesse" du contrôleur d'approche me donnant par 2 fois notre position sol près de Mulhouse (conscient qu'il était que nous devions trouver le temps très long dans la couche, à ce cap et à cette altitude),
- Troisième raison : mon tour de piste inutile et très hasardeux après vous avoir "largué" à l'entrée de la 05 de Brem. Inutile car je pouvais tout simplement me poser avec vous mais un peu long (et nous étions par ailleurs "justes" en carburant). Très hasardeux, car je n'avais pas à remettre les gaz, et faire comme je l'ai fait, un 360, trains et volets sortis avec un plafond de 200 à 300 pieds, à l'occasion duquel, les yeux rivés sur le badin j'ai perdu de vue, au moins 2 fois, la rampe d'approche lumineuse. Je me suis donc fais un peu peur et ... c'est bien connu, ça ne s'oublie pas ! –
Quatrième et dernière raison (d'ordre presque privé) …
Très content d'avoir partagé avec vous ce souvenir que nous avons en commun, et très cordialement.
Michel DUHAMEL
Et toujours avec l'escadron 2/13 nous avons réalisé une première lors du départ pour la campagne de tir annuelle à Cazaux. La dotation de l'escadron était de 25 avions et nous avons réussi, ou plutôt nos mécanos ont réussi, à en utiliser 18 pour rejoindre Cazaux de nuit. 18 avions, par groupes de 2, se suivant, au radar, à des intervalles de quelques minutes et se posant de nuit là-bas. La base de Cazaux n'avait jamais vu ça et la chasse française non plus.
Avant le départ pour cette campagne il a fallu passer nos avions à la butte de tir pour régler les canons. L'avion étant sur vérins, les armuriers enfoncent dans les tubes une lunette spéciale dotée d'un miroir à 45° et ils peuvent ainsi modifier la position des armes par rapport à la référence du fuselage. Mais comment régler ? Il y avait la méthode conventionnelle adoptée jusqu'alors par les as de guerre et qui consistait à faire converger les trajectoires sur un point unique situé à environ 400 m. Cette méthode permettait aux bons tireurs de faire des scores impressionnants. Mais je n'étais pas d'accord : je voulais que même les jeunes pilotes et ceux qui tombaient sur un appareil moins bien réglé puissent quand même mettre un ou deux obus dans la cible. J'ai donc adopté un réglage en "escopette". Grâce à cette méthode, à l'issue de la campagne de tir, au lieu d'avoir quelques pilotes ayant réussi des scores impressionnants, nous avons pu qualifier tous nos pilotes même les plus jeunes.
Un certain été, il y a eu une journée des bases. Cela se passait le dimanche et on ouvrait le terrain au public. Il y avait foule sur le parking. Je devais présenter l'avion en vol. Je comptais faire un passage à grande vitesse suivi d'un peu de voltige et d’un atterrissage très court. Je me présente dans l'alignement de la piste à 500 pieds et à 600 noeuds. C'était en début d'après-midi. Soudain alors que je suis encore à quelques kilomètres de la piste une légère turbulence fait tressauter l'avion. A basse vitesse on monte et on descend. On parle de trous d'air. À grande vitesse on a l'impression de rouler sur des pavés inégaux. En à peine une seconde, le mouvement s'amplifie et je subis des accélérations que j'estime à 6 ou 7 g. Par réflexe, et cela m'a sauvé la vie, je lâche le manche et tout s'arrête. J'effectue normalement mon passage devant la foule. Que s'était-il passé ? Il s'agit d'un phénomène qui est maintenant bien connu mais dont personne ne m'avait parlé jusqu'alors. Le mouvement de l'avion fait osciller mon corps. Mon bras en fait autant. Et comme il est posé sur le manche, la boucle est bouclée. Il y a réaction positive et si on ne coupe pas la boucle en lâchant le manche, le phénomène diverge. Peut-être qu'avec les commandes électriques et le filtrage par ordinateur cela ne peut pas se reproduire ? Mais j'ai eu chaud.
Notre avion était très fiable et pendant la durée de mon commandement de l'escadron 2/13, nous n'avons eu aucun accident mortel.
Il y avait eu un décès, un mois avant mon arrivée, mais sur un T-33. Et là encore le Commissariat m'a obligé à relancer la veuve pour récupérer la valise PN du malheureux ! Ce n'est pas d'un coeur joyeux que j'ai dû effectuer cette démarche.
Il y a quand même eu quelques incidents. J'ai déjà raconté les circonstances de mon crash. En voici un autre :
Un jour de beau temps, nous décollons en patrouille serrée face au nord (l’équipier était Lebolzer). Arrivés aux environs de 1.000 ou 1.500 pieds, son avion recule par rapport à moi. Je ne me souviens pas si son réacteur avait explosé, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il s'éjecte aussitôt. Je coupe la postcombustion et je vire en palier à vitesse réduite pour surveiller sa descente. Le parachute s'ouvre normalement, il me fait signe que tout va bien. Peu après, il se pose dans une clairière près d’un petit bois. Je vois qu'il est sain et sauf. Mais un peu plus au nord, et hélas près d'une route fréquentée, il y avait une boule de feu. L'avion avait dû percuter à la verticale, car il y avait un seul cratère presque cylindrique.
Je m'aperçois alors, que des véhicules s'arrêtent et que des personnes s'approchent du lieu de l'accident. Nos avions étaient armés. Et les obus de 20 mm qui n'avaient pas encore explosé constituaient un réel danger pour elles. Ne sachant que faire, j’ai effectué quelques passages à très basse altitude pour essayer de les effrayer. Bien au contraire cela les a amusés et ils sont restés autour du trou. Heureusement il n'y a pas eu de blessés.
Un autre incident est survenu au cours d'un vol de nuit, et il aurait pu se terminer très mal. Nous étions en alerte à cinq minutes, en bout de piste. Il y avait sur l'aire d'alerte une baraque chauffée et nous attendions l'ordre de décollage assoupis sur des chaises longues. Nous avions fait l'inspection de l'avion et lorsque la sonnerie qui déclenchait cet ordre résonnait, il ne nous restait plus qu'à courir l'avion, grimper à l'échelle, se glisser dans le cockpit, attacher les bretelles et effectuer un rolling take-off pour respecter les délais du contrat.
Nous effectuions parfois trois missions la même nuit et il est certain que lorsque la sirène résonnait vers 4 h du matin, les paupières étaient ouvertes mais l'esprit n'était pas encore très clair. Il nous arrivait de nous retrouver, après avoir rentré le train, le nez vers les étoiles, assis sur la postcombustion, de nous demander :
- « Mais qu'est-ce que tu fabriques ici au lieu d'être tranquillement dans ton lit ?».
Mon tour arrive. Je cours vers l'avion, je mets en route et j'allume la postcombustion tout en faisant un rolling take-off. La piste faisait 2.400 m et en temps normal nous en utilisions à peine un tiers avant le quitter des roues. Mais ce soir là, avec la manette à fond en avant, l'avion n'accélérait pas. Notre appareil possédait un système de grilles mobiles dans l'entrée d'air. Ces grilles protégeaient le compresseur contre une éventuelle absorption de corps étrangers pendant le décollage. Elles étaient articulées, et mues par un moteur électrique. Une fois ouvertes, en fait rabattues, elles dégageaient complètement l’entrée d'air. Normalement nous décollions avec les grilles fermées et après avoir rentré le train, on pouvait les rabattre pour avoir un meilleur débit d’air.
Donc l’avion n’accélérait pas. Le temps de réaliser, j’étais trop rapide pour la barrière d’arrêt et le siège n’était pas un "zéro-zéro". Donc pas d’autre issue que d’essayer quand même de décoller. Je m’arrache péniblement du sol près du bout de piste et je me traîne avec un vario à peine positif. La T4 (température turbine) est normale. Le régime, je n’en suis plus sûr mais je crois qu’il était normal. Et pourtant : ça ne poussait pas !! Je rentre quand même le train pour diminuer la trainée et je signale à la tour que je passe directement en vent arrière. Tout cela, je le rappelle en fin de nuit et heureusement par beau temps.
Je commets alors une énorme erreur, je rentre les grilles. Si leur conception n’avait pas été aussi bonne, c’eut été l’explosion réacteur immédiate. Je n’ai compris pourquoi qu’après le retour au parking. Leur charnière était en bas et en se repliant, elles retenaient les corps étrangers plaqués dessus par la pression de l’air.
Je remonte le taxi way et vient me garer à l'aire d'alerte. Il fait toujours nuit bien sûr. J’éteins le réacteur et en ouvrant la verrière je vois qu'il y a devant mon appareil, le chef de piste et plusieurs mécanos qui font une drôle de tête. Je descends de l'échelle et je me dirige vers l'endroit où convergent leurs regards : j'y découvre le spectacle de la photo ci-dessous. L’inventaire est complet, il y a là les débris :
- du cache d’entrée d’air,
- du cache pitot,
- des goupilles de train accompagnées de leurs rubans rouges,
- les 2 pièces circulaires que montre la photo et qui sont peut-être des caches canon ?? Que s’était-il passé ?

Pendant que je somnolais sur ma chaise longue, dans la baraque, les mécanos ont dû pour une raison que j’ignore, déplacer l’avion dont j’avais, bien sûr, effectué l’inspection extérieure avant d’aller me reposer. Lors de ce tour d’avion, ce matériel indésirable n’était pas dans l’entrée d’air. Pour déplacer l’appareil, ils ont tout remis dedans en ayant bien l’intention de le reposer par terre après coup mais ils ont oublié. Le cache d’entrée d’air n’était pas en place, mais posé à plat et ceci a permis un démarrage normal du réacteur.
Par la suite le fuel control, avec ses amplificateurs à tubes, a décelé un manque d’air et il a donc mis intelligemment moins de pétrole en gardant les paramètres moteur normaux. Mais seul le chronomètre peut déceler un manque de poussée.
Nous étions tous fatigués en cette fin de nuit et il n’y a eu ni enquête ni sanctions.
Une autre nuit, toujours par mauvais temps, un plafond bas, mais heureusement une très bonne visibilité en dessous de la couche. Je termine des passes radar vers 40.000 pieds et me trouvant vers Strasbourg décide d’une percée directe sans repasser verticale base. Cap au sud je descends, freins de piqués sortis, moteur réduit et pente à environ 30° à l’horizon artificiel car bien au-delà des capacités du vario. Dans cette configuration, les aiguilles de l’altimètre tournent très, très vite. Il y trois aiguilles sur cet altimètre, et la petite qui indique la dizaines de milliers de pieds est peu visible. Alors que je passe entre 12.000 et 11.000 pieds, l’approche de Colmar me dit :
- « Je viens de perdre votre écho ! »
Je ne prête pas trop attention car cela peut arriver. Mais soudain je me trouve face à face avec des, mais oui, des phares de voiture. J’étais sur la nationale Colmar-Strasbourg. Manette en avant, freins de piqués rentrés, je tire sur le manche et remonte à 1500 pieds. Je m’étais tout simplement trompé de 10.000 pieds. A ce moment l’approche me dit :
- « J'ai retrouvé votre écho ».
Reste de la descente et atterrissage normal.
Depuis, suite à plusieurs incidents identiques, les altimètres ont été modifiés et une zone hachurée de noir et de blanc apparaît en dessous de 10.000 pieds.
Il n'y a pas eu heureusement que des incidents dans la vie de cette escadre. Il y a eu également des épisodes un peu comiques. Nos avions devaient toutes les 600 h de vol subir une révision majeure. Et cette révision été confiée à la société Fiat à Turin. D'ailleurs les révisions de 600 h de nos Super-Mystère étaient effectuées en Israël. La France n'est-elle pas capable ? Qui est à l'origine de ces conventions boiteuses ? Comprenne qui pourra !
Nous allions donc presque chaque mois poser un F-86 à Turin et en ramener un autre flambant neuf. Mais si vous prenez une carte et que vous tirez un trait entre Colmar et Turin, ce trait traverse la Suisse. Réglementairement nous aurions dû en faire le tour en passant au sud de Genève. Mais nous n'en prenions pas la peine. En gardant pleine PC après le décollage, on pouvait en quelques minutes et quelle que soit la météo, laisser loin derrière nous et bien en dessous le Mont-Blanc. Et c'était amusant pendant la brève durée de cette traversée en catimini, de voir des Vampire suisses qui peinaient en essayant de monter à notre niveau et qui n'y parvenaient pas.
Dans nos caissons à munitions nous ramenions du Chianti et autres alcools qui étaient bien meilleur marché de l'autre côté des Alpes. La douane dépêchait un agent par principe. Mais nous nous gardions bien de déballer la marchandise sur le parking. Le soir l'avion était rentré dans le hangar et ni vu ni connu. D'ailleurs par bonheur la durée du vol était faible car les caissons n'étant pas réchauffés, les bouteilles de champagne auraient pu éclater par -60°.
Un autre jour alors que je passais en vent arrière légèrement à l'est de la base, j'ai perdu la verrière. Je ne me souviens pas avoir fait une fausse manip. Elle est peut-être toujours dans cette forêt car je ne crois pas qu'on l'ait retrouvée. Il y a quand même un peu de courants d'air dans le cockpit et c'est gênant à l'atterrissage.
Interception de la reine
Pour donner une idée du travail très particulier qui est celui d'une escadre de chasse tous temps, je vais décrire en détail le déroulement d'une mission (mission de nuit du 14 juin 1960 sur le F-86K n°867).
Je ne l'ai pas choisie au hasard car j’en ai un souvenir très précis. La plupart du temps nous effectuons ces interceptions sur des cibles amies. Il s'agit en général d'autres avions de la 13 et parfois d'un avion d'une autre escadre. Le but de cet entraînement, est de pouvoir identifier ou détruire un appareil venant de l'autre côté du rideau de fer car nous sommes en pleine guerre froide. À cette fin nos canons sont toujours armés et les caissons à munitions emplis d'obus de 20 mm. Mais cette fois…
Je suis d'alerte et me repose dans la baraque située en bout de piste à quelques mètres de nos avions. J'ai déjà fait l'inspection de l'appareil et il ne me reste plus qu'à sauter dedans, à boucler le harnais, à mettre en route et à effectuer un rolling take-off. C'est ce que j'effectue presque machinalement lorsque la sonnerie d'alerte retentit.
Nous sommes en début de nuit et il fait un temps épouvantable. Il tombe des cordes et la météo nous prévoit un sommet de la couche supérieur à 40.000 pieds.
À peine ai-je rentré le train que je monte avec la postcombustion allumée, à un cap prédéfini en direction des Vosges. J'ai décollé en utilisant la fréquence de l'approche de Meyenheim et je passe aussitôt sur la fréquence du radar sol qui surveille la région. Je ne suis absolument pas préoccupé par la navigation car c'est le contrôleur de ce radar sol qui va me guider vers la cible puis me ramènera au bercail. Mais contrairement à nos missions habituelles cette cible est réellement à identifier. C'est un appareil qui ne respecte pas son plan de vol et qui se situe aux environs de 20.000 pieds.
Je continue à monter en suivant les ordres du sol et en 2 ou 3 min, je me stabilise vers 20.000 pieds. Le contrôleur radar me donne des caps à suivre pour que je me retrouve derrière la cible à une distance de l'ordre de 20 km. Je pourrais alors l'apercevoir sur le tube cathodique de mon radar de bord et prendre à mon compte le reste de la mission. Il m'indique que la cible se dirige vers l'est et je vais donc être amené à me rapprocher par derrière pour pouvoir l'identifier. Il m'informe également de la vitesse de la cible et j'en déduis que ce n'est pas un jet.
Peu de temps après, j'aperçois l'écho de cette dernière tout en haut du tube cathodique à une quinzaine de kilomètres. Ce tube, d’environ 15 cm de diamètre, occupe une position centrale sur le tableau de bord. J'effectue l'acquisition en utilisant avec ma main gauche le joystick qui se trouve près de la manette des gaz. Je déplace un point sur l'écran et je le fais coïncider avec la tache de l'écho. J’obtiens le Lock-on (l'accrochage). On est dans la phase poursuite et dès cet instant, l'antenne du radar de bord ne balaie plus : elle est braquée sur la cible. La technique de l'époque ne permet pas d'agir autrement et cela permet malheureusement à l'ennemi de savoir tout de suite qu'on arrête de le rechercher et qu'on l’a trouvé. Les systèmes plus récents n'ont pas cet inconvénient : on les appelle des Track While Scan (poursuite en continuant la recherche). L'antenne continue à balayer et la poursuite se fait sur ordinateur. Cela permet en outre de traiter des cibles multiples. Sur le 86K une fois l'accrochage obtenu on devient aveugle sur le reste de l'environnement.
Je continue à me rapprocher en utilisant les informations précieuses que me donne la conduite de tir. Notamment je peux voir quelle est notre vitesse relative. Tant que je suis loin je garde de la puissance mais si par hasard j'arrive sur cette cible comme un boulet, je ne pourrai pas l'identifier et si je passe devant, je la perds. Donc je réduis progressivement la vitesse pour terminer à quelques centaines de mètres en m'approchant à pas de loup. Il y a heureusement sur cet écran une barre qui représente l'horizon artificiel. Ceci est fondamental puisque dans la phase finale de l'approche on ne regarde plus les autres instruments. Hélas un an plus tard au CEAM, lorsque l’on me confia l’expérimentation de l’armement du Mirage III C cette aide n’existait pas et je me suis souvent retrouvé sur la tranche pendant la poursuite.
Lorsque la distance diminue, l'écho traverse l'écran de haut en bas mais il ne sert plus à grand-chose. Il faut continuer à observer la vitesse relative en la réduisant progressivement et surtout il ne faut pas rester à la hauteur de la cible car on pourrait la percuter. Notre écran nous fournit alors un autre renseignement précieux : il y a un point mobile qui nous indique notre position relative par rapport à la cible dans un plan vertical. En fait si on garde ce point au centre du tube, on peut une fois arrivés à distance de tir, le détruire au canon. Si on garde ce point à environ 1 cm au-dessus de l'horizon, on est sûr que lorsque la distance va s'annuler on sera, sans danger pour les deux, en dessous de l'appareil à reconnaître.
Lorsque j'arrive à moins de 100 m avec une vitesse relative presque nulle je commence à écarquiller sérieusement les yeux dans l'espoir de voir apparaître quelque chose dans la glace avant. Nous sommes de nuit, dans les nuages et la visibilité est presque nulle. Je me rapproche lentement. Soudain je commence à distinguer, juste en haut du pare-brise, comme des lueurs clignotantes. Je me rapproche encore un peu et au-dessus de moi, à quelques mètres, je peux enfin identifier, à ma grande surprise, trois dérives qui je crois sont celles d’un Constellation.

Un Lockheed "Constellation" vu de l'arrière ... au sol ... et de jour
Je pense qu'à aucun moment, ni l'équipage ni les passagers ne se sont doutés un seul instant qu'ils avaient un chasseur armé à quelques mètres de leur queue.
Je rends compte par radio de ma découverte. La visibilité m’interdit de procéder à la suite de l’identification. Par ciel clair, on s’avance sur le côté de l’inconnu pour lire son immatriculation et éventuellement, sur ordre du centre d’opérations, on l’incite à se dérouter ou à se poser. Il faut noter que cette procédure qui consiste à passer devant en battant des ailes, est tout simplement suicidaire si il s’agit d’un ennemi armé.
J'ai l'autorisation de rentrer au bercail. Malgré la mauvaise météo le retour au terrain et la finale guidée par le GCA se déroulent comme dans un livre. Je reviens sur l'aire d'alerte et regagne la baraque qui nous sert de repos dans l'attente d'une éventuelle nouvelle mission et en espérant qu’elle n’aura pas lieu. Il arrive parfois que l'on décolle trois fois dans la même nuit. L’approche prudente de la cible à prolongé le vol qui a duré 1 h. D’habitude les interceptions de plastron amis (on appelle cela des missions King ou Dahut ) s’arrêtent dès le Lock-on et le vol ne fait que 35 minutes. Pas de quoi accumuler des heures de vol.
J'ai appris le lendemain, à mon grand étonnement, que l'avion que je venais d'intercepter et d'identifier transportait la reine d'Angleterre !
Chef de patrouille ?
Comment concilier ce type de mission, effectuée au plus à 2 avions, avec la traditionnelle hiérarchie de la chasse française ? Celle-ci comporte en effet les qualifications ci-dessous :
- élève équipier,
- équipier confirmé,
- sous-chef de patrouille,
- chef de patrouille,
- chef de dispositif.
Cette progression est totalement indépendante du grade et nos amis de l’Armée de terre étaient très étonnés lors de manœuvres communes, de voir un Cdt obéir, en l’air, à un Sgt pilote. D’ailleurs, sous la pression américaine et j’espère celle de la raison, tous les pilotes sous-officiers seront nommés ORSA (Officiers de Réserve en Situation d’Activité).
Comment donner le commandement d’un escadron à un pilote qui n’est même pas chef de patrouille ? Cela n’est pas concevable au sein de la section chasse de l’état-major de la place Balard. Je ne suis en effet que sous-chef de patrouille. Alors on improvise. Au cours d’une interception semblable à toutes les autres, on décide que je passe l’épreuve de chef de patrouille et on a sauvé la face.
Dans les années 60 et dans le cadre de l’OTAN, nous devions monter à 1.500 avions de combat. Nous sommes en fait arrivés à plus de 750 grâce aux prêts d’appareils américains. Nous avions 13 escadres à 3 escadrons de 25 appareils (la 13 n’avait que 2 escadrons soit 50 appareils plus une douzaine de T-33).
Mais quid de la notion de chef de dispositif ? Aujourd'hui, alors que nous n'avons presque plus d'avions, ce terme prête à sourire, voire à pleurer.
En fait de dispositif, il m’est arrivé de leader 16 ou 24 avions mais seulement dans le cadre de défilés de temps de paix. Je me souviens d’un défilé sur Baden-Baden avec 144 avions du premier CATAC. Il y avait en dehors des nôtres, des F-100, des Mystère IV et peut-être des Vautour. Je leade l'un des paquets de 12 avions et le rassemblement de l’ensemble a pris presque une heure. Les paquets étaient espacés d'environ 500 m. Avec uniquement les yeux il est très difficile de conserver cet espacement malgré le respect d'une vitesse déterminée lors du briefing. Mais une fois de plus avec un petit tube cathodique au centre du tableau bord il n'y avait plus de problèmes. On voyait en plus du paquet précédent l'ensemble de tous ceux qui nous précédaient.
Il y avait pour chaque type d'appareil des avions en spare qui auraient pu au dernier moment prendre la place d'un appareil défaillant. Un des appareils du groupe a annoncé à la radio :
- « J'ai le voyant machin chouette qui vient de s'allumer. Que dois-je faire ? »
Et la voix du chef de dispositif a répliqué aussitôt avec un timbre qui ne permettait pas la réplique :
- « Tu fermes ta gueule ! ».
Je crois que c’était le "Peps". Nous donnions ce surnom au Cdt Perfettini.
J'ai commandé le 2/13 en étant jeune capitaine. Aujourd’hui, le commandement d’un escadron de 15 avions, dont bien sûr seulement une partie peut être disponible chaque jour, est confié à un lieutenant-colonel.
Ce commandement m’a évité de participer aux opérations d’Algérie. Mais j’avais appris que nous avions acquis des T-6 et que l’on prélèverait des pilotes en escadre pour les détacher là-bas. Ces pilotes n’avaient volé que sur jet. Mon expérience de moniteur à Marrakech, me permettait de pressentir le pire. J’ai timidement demandé qu’on les entraîne auparavant. Mais que représente la voix d’un capitaine, aussi expérimenté soit il auprès des pontes de l’EMAA ?
En outre, les T-6 utilisés en Algérie, étaient beaucoup plus lourds que ceux de Marrakech. Ils étaient alourdis par le blindage et l’armement. Il eût fallu tenir compte de ce facteur dans leur emploi.
Le résultat fut tragique : nous avons perdu 110 T-6, soit 220 morts car derrière le pilote, il y avait un aspirant observateur. Et comble de l’ironie, seuls 10% d’entre eux ont été descendus par les "fels".
Bien sûr il y a eu par la suite la "Fameuse nuit de la 13" pendant laquelle plusieurs avions se sont crashés. Il n’y a pas eu de morts. Mais j’étais déjà à la section NBT (Navigation Bombardement Tir) du CEAM de Mont-de-Marsan en charge des essais du système d’armes du Mirage III C.
J’espère que l’un des pilotes qui l’a vécue, voudra bien la raconter et compléter ainsi ce récit.
Le CEAM (la période la plus passionnante de ma carrière)
Au bout de 2 ans, le couperet tombe et je dois céder la place. Normalement, c’est mon second, le Cne Fradin qui aurait dû prendre le commandement du 2/13 ; mais il récuse cette responsabilité. Et c’est un pilote venu de l’extérieur qui me succède : le Cne de Flines. On a beaucoup d’émotion lorsqu’il faut quitter une unité à laquelle on a tout donné et qui vous l’a rendu au centuple.
Quel sera mon sort ?
Le CEAM, à Mont-de-Marsan, vient de percevoir ses premiers Mirage III C.
La section NBT (Navigation Bombardement Tir) possède les techniciens qui sont en charge du radar et de la conduite de tir ainsi que les armuriers qui mettent en oeuvre les deux canons de 30 mm ainsi que les nouveaux engins "air-air" : les Matra 511 et 530.
C’est le chef de cette section (le Cdt Fonvieille, momentanément indisponible pour raisons de santé) qui me fait venir de la base de Colmar où il avait commandé le 1/13. On a tenu compte de mon expérience en vol tous temps et de nuit pour me confier les essais opérationnels du système d'armes du Mirage III C. J’y serai donc, en fait, le seul pilote.
C'est la section chasse, qui a un plus grand nombre de pilotes, certains venant de la 13ème escadre, qui est chargée de l'exploration opérationnelle du domaine de vol et de la maintenance de l'appareil.
Normalement, un certain nombre d'essais préalables auraient dû être effectués par le CEV concernant ce système d’armes. Mais l'appareil câblé spécialement pour cette mission s'est crashé sur la piste de Cazaux (Cne Farcy). J'ai donc hérité d'un domaine non défraîchi.
J’arrive à Mont-de-Marsan en avril 1961 et je commence l’étude des différents circuits et les séances de simulateur du III C. Que faire en attendant ?
Je fais un vol en copilote d’un Nord-2501 vers Reganne et puis je me lâche sur :
- Super-Mystère SMB2,
- Mystère IV,
- Fouga,
- MS Paris,
- T-28,
- Broussard,
- Flamant.
Je ne sais pourquoi, je méprise les Vautour. Je me rattraperai plus tard en Polynésie.
Mais pendant quelques jours il y a un autre souci. Notre pays traverse une grosse crise et les généraux d'Alger ont fait leur putsch. Quelques jours plus tard le gouvernement redoute l'arrivée vers la métropole d'avions de transport amenant des parachutistes. Nous recevons alors l'ordre de les intercepter et de les obliger à se poser sur le terrain de Cazaux où les attendent des compagnies de CRS. On déplace même une partie de la 13ème escadre sur Mont-de-Marsan et sur Orange.
Je me retrouve en bout de piste dans un Super-Mystère avec les canons armés. Nous sommes deux appareils et l'autre pilote est un de mes anciens de l'École de l'air. Je connais sa position et il en résultera plus tard un notable retard dans sa carrière. Il me dit :
- « Petit, surtout tu tires pas ! ».
Bien sûr que je ne vais pas ouvrir le feu sur un Nord 2501 transportant nos troupes d'élite. D'ailleurs tirer sur un tel appareil, ne serait pas un combat mais un assassinat. Et si il fallait donner le change, je suis bien décidé à tirer soigneusement à côté.
Quelques jours plus tard la tentative a échoué et tout rentre dans l'ordre mais nous voyons bien que l'Algérie est perdue. Pendant toute cette période nous n’avons reçu, bien sûr, que des ordres verbaux. Il n’en restera donc aucune trace écrite.
Arrive enfin le grand jour : je me lâche le 19 mai sur le III C n° 07. Et je dois employer la première personne car il n’y avait pas encore de biplaces.
Le décollage ne pose pas de problèmes en dehors du fait qu’il ne faut pas traîner pour rentrer le train après avoir quitté le sol. En effet les trappes de ce train ne doivent pas être sorties au-delà de 250 kt. Et si l’on a un peu tardé, il ne reste plus qu’à mettre le nez dans le ciel pendant la rétraction de cet appendice.
La montée classique, consiste à accélérer près du sol jusqu’à 500 kt, puis à garder cette vitesse jusqu’à ce que le Machmètre indique 0.9. On garde ce Mach jusqu’à la tropopause.
Et c’est pendant cette montée que commence la surprise. On est tout à l’avant et on ne voit ni les ailes ni le nez : on est comme pendu dans le vide. L’avion est "en lisse", sans charges ou réservoirs extérieurs et il accélère toujours. Si on ne lève pas assez le nez, cette fichue machine, c'est à peine croyable, va passer le Mach en montée ! Comme le dossier du siège est un peu incliné vers l’arrière, on a l’impression de monter au ciel. Le vario est en butée depuis longtemps. En fait l’assiette de l’avion n’est pas très cabrée : tout au plus une vingtaine de degrés. Ce qui donne une telle vitesse ascensionnelle, c’est qu’elle est tout simplement la composante verticale d’une vitesse sur trajectoire élevée.
On se met en palier en coupant la PC, en réduisant le régime et alors on réalise : il va falloir ramener la bête au bercail, qui derrière parait minuscule, et personne pour t’aider... J'effectue quelques manoeuvres pour mieux connaître l'appareil et je commence la descente pour rentrer au terrain.
À l’atterrissage, pas de difficulté non plus mais on est surpris par le cabré d’une aile delta sans gouvernes canard et par la vitesse en finale : 190 kt. Je ferai même plus tard, à Brétigny, un vol sur un Mirage de présérie dont les ailes n’avaient pas encore les bords d’attaque cambrés et là il fallait 210 kt en finale (F-86 : 140 kt et Rafale beaucoup moins je suppose). Il y a une nouveauté, qui est un rudiment de sonde d'incidence. Mais il n'y a pas d'indication continue, il y a simplement 3 voyants : vert, ambre et rouge. Cela s’apelle l’ "Adhémar sans garantie pour l'orthographe. Et nous n'avons pas encore la "régulation d'approche". Ce dispositif permet de conserver une vitesse en finale GCA sans toucher à la manette des gaz. Les variations nécessaires de poussée, sont obtenues par un pilotage des paupières. Si le pilote est légèrement en dessous de la trajectoire, il lui suffit de tirer légèrement sur le manche pour revenir sur le plan de descente. C'est super confortable. Je l’expérimenterai au mois de septembre en effectuant 4 finales GCA au cours du même vol.
Habitué à regarder plus le tableau de bord que l’extérieur, je fais de même en ciel clair et je découvre la boule. Cet instrument remplace à la fois l’horizon artificiel et le compas. C’est une merveille. C’est une sphère noire sur laquelle sont dessinés des méridiens et des parallèles. Elle n’a pas de limites angulaires et si on suit un méridien en tirant sur le manche, on effectue un looping parfait sans dévier d’un degré. Cela sans presque toucher au palonnier. Quelle différence avec la même figure sur P-51 !

Planche de bord d'un Mirage III E avec un radar "Cyrano"
Je continue quelques vols de transformation sur Mirage III C et des vols d'entraînement notamment sur SMB2 et Mystère IV. Sur ce dernier j'apprécie particulièrement la douceur des commandes de vol et c'est avec cet appareil que je me régale en voltige.
Le Lightning P1
En juillet 1961, s'offre à moi une fabuleuse opportunité : il va y avoir un échange de pilotes entre le CEAM anglais et le nôtre. Des pilotes anglais vont venir effectuer des vols sur Mirage et un pilote français va pouvoir voler à Coltishall sur le Lightning P1. Je suis l'heureux élu.

English Electric P-1 "Lightning" (G. Guisnel)
Le Cne de Rousiers m'accompagne et nous rejoignons l'Angleterre en Flamant après une escale à Brétigny. L'accueil est chaleureux. Nous avons droit au luxe de l'officer’s club et à ses profonds fauteuils en cuir. Un vieux majordome, de type retraité de l'armée des Indes, nous apporte le thé au réveil et nous présente nos chaussures qu'il vient de faire briller. Il y a bien sûr des repas solennels au cours desquels nous devons porter de nombreux toasts à la reine. Il y a aussi quelques distractions dans le "London by night".
Mais tel n'est pas le but de notre séjour ici. Tandis que le Cne de Rousiers va pouvoir voler sur Hunter, je passe de nombreuses heures dans le simulateur pour me familiariser avec les procédures et le tableau de bord du P1. Ce qui étonne au premier abord c'est qu'il n'y a pas de voyants lumineux mais de petites sphères noires qui se recouvrent d'un couvercle blanc lorsque le voyant de chez nous devrait s'allumer. Je crois qu'ils appellent ça des "eye bowl". Je n'en suis pas sûr mais on finit par s'y faire. J'étudie, bien sûr, les diverses procédures et notamment celles qui concernent la panne d'alternateur. Cela va bien me servir quelques jours plus tard
Arrive enfin le jour du lâché sur la grosse bête. Pas de biplace non plus. Par rapport au Mirage il s'agit d'un biréacteur de plus de 17 t. La mise en route se fait à partir d'une cartouche qui dégage une fumée noire mais qui permet la remise en oeuvre à partir de n'importe quel terrain. Comme le terrain est près de la mer et que la majorité du vol aura lieu sur celle-ci, il faut enfiler une Mae-West. Je n’ai pas de combinaison anti-g car je ne vais pas faire du cirque à basse altitude. Je vais voir comment à haute altitude, on peut utiliser le radar.

L'auteur devant un English-Electric P-1 (Coll. M. Cavat)
Pour monter dans l'avion, qui est équipé de missiles air-air nous disposons d'une échelle et petit détail, le dernier barreau de celle-ci porte des brosses. On peut donc s'essuyer les pieds avant de pénétrer dans le cockpit.
En ce 25 juillet 1961 nous avons une météo typiquement anglaise : le plafond est bas et nettement inférieur à 500 pieds. Tout le vol retour, aura donc lieu aux instruments. Je décolle et après avoir coupé la PC, je réalise que cet avion, "en sec", monte plus vite que le Mirage. Cette particularité est intéressante car elle permet d'arriver à l'altitude de travail avec plus de carburant. J'effectue quelques évolutions sans trop m'occuper du radar pour ce premier vol. J'avais néanmoins mis ce dernier sous tension avant le décollage. Et pas de chance le voyant de l'alternateur m'indique que celui-ci vient de me lâcher. Je coupe aussitôt le radar pour diminuer la consommation électrique et demande à rentrer immédiatement terrain.
Après la descente, je me retrouve en palier à 1.500 pieds et je sais que, presque jusqu'au dernier moment, je serais au-dessus de la mer. Je redoute un épuisement de la batterie qui me priverait de radio. Les Anglais ont pitié de moi et ils font venir à l'approche un contrôleur parlant français. Le GCA et l'atterrissage se passent sans encombre : mais je n'ai pas aimé.
Dans les jours qui suivent j'effectue deux autres vols et je peux enfin étudier le comportement du radar et de la conduite de tir. Ce dernier n'a pas de performances notablement supérieures à celui du Mirage mais l'écran est beaucoup plus propre. Une astuce permet de réaliser plus facilement l'accrochage : le joystick ne déplace pas sur le tube cathodique un point comme sur le Mirage ou sur le F-86K, mais un petit cercle qui vient entourer l'écho de la cible. On peut donc très facilement centrer l'écho dans ce cercle et réaliser rapidement l'accrochage. Sur nos avions le point que l'on déplace masque un peu cet écho et l'accrochage est moins facile. Je me suis privé d'une soirée festive pour rester dans ma chambre et étudier des documents que l'on m'avait prêtés concernant cette conduite de tir. Jusqu'à une heure avancée de la nuit j'ai recopié ce qui me paraissait le plus intéressant. À mon retour ces précieux documents ont été méprisés et n'ont jamais servi.

J'ai pu effectuer 2 vols en copilote sur le vieux Javelin qui atteignait péniblement Mach 0.9 mais dont l'énorme radôme abritait une antenne de plus de 1m de diamètre. La surface de l'antenne était donc neuf fois supérieure à celle du Mirage et le signal qui faisait l'aller-retour était 18 fois plus fort !! Il avait bien sûr, des lobes secondaires très atténués et pas d’échos parasites. Il avait en outre, une seconde petite antenne de 20 cm qui permettait lorsque l'on était plus près de la cible d'accrocher cette dernière. C'était l'ancêtre du Track While Scan.
C’était un biplace. Hélas, les gros avions biréacteurs coûtent cher et les biplaces aussi.

Gloster "Javelin"
De retour à Mont-de-Marsan il va falloir aborder le vrai but de ma mission c'est-à-dire l'expérimentation et l'utilisation de la conduite de tir.
Le Mirage III C est équipé d'un radar Cyrano 1 bis (construit par CSF) dont les performances sont à peine égales à celles que j'avais connue sur F-86K. Non seulement la portée en détection est faible mais la vidéo restitue un écran bourré d'échos fixes. Il était pratiquement impossible d'acquérir et de traiter une cible située plus bas. En outre, un avion à ailes delta de faible envergure a peu d'inertie en roulis. Alors que le F-86K disposait d'un horizon artificiel sur l'écran radar, le Mirage n'en a pas encore. Concentré sur ce tube cathodique pour essayer d'acquérir une cible en poursuite, je me suis souvent retrouvé sur la tranche.
Le Mirage est un petit avion, il a donc un petit nez qui ne peut contenir qu’une petite antenne. Avec une antenne de 37 cm de diamètre, nos ingénieurs ne pouvaient pas mieux faire.
Le Cyrano avait des amplificateurs à lampes (petits tubes crayon) qui chauffaient énormément. Les chassis qui les supportaient, étaient donc creux et parcourus par un liquide de refroidissement. Nos radaristes étaient des électroniciens et pas des plombiers. Les fuites de ce liquide qui carbonisait sous tension, provoquaient de nombreuses pannes. Nous avons avec nos radaristes, joué à découper avec des ciseaux des plaques de tissu absorbant et à les coller sur le bas du radôme. Nous avons essayé ainsi, sans grande réussite, à limiter les échos parasites venant du sol.
Je suis donc persuadé que pour intercepter le plus tôt possible un bombardier venant de l'est, c'est-à-dire pour le détruire le plus loin possible de notre capitale, il vaut mieux un avion un peu plus lent doté d'une grosse antenne. Il doit cependant monter très vite et emporter des missiles capables d'une forte dénivelée …
Mais quand j'écris ces mémoires, la guerre froide est terminée et les opérations les plus récentes ont opposé à nos chasseurs des forces sans composante aérienne. Il n'y a donc plus de chasseurs : il ne reste plus que des bombardiers. Et cela me rappelle la chanson que nous chantions sur la base de Craig lors des Free beer party.
Vol de nuit
L'avion doit être capable d'effectuer des interceptions de nuit. J'essaie de me renseigner auprès des pilotes de la section chasse : aucun d'eux n'a encore volé de nuit sur cette machine.
J'essaie d'obtenir des informations à la source et je m'aperçois que ces vols n'avaient été réalisés auparavant, ni par le constructeur ni par le Centre d'essais en vol.
Je me prépare donc à une première. Le 23 octobre je mets en route et je décolle pour le premier vol de nuit d'un Mirage.
J'avais déjà, quelques semaines auparavant, volé de nuit sur SMB2. À l'époque, la piste de Mont-de-Marsan n'était pas encore équipée d'une rampe d'approche et on se retrouvait, en fin d'approche, dans le noir, au-dessus du ravin de la rivière Douze.
Dès le début de ce vol je rencontre une difficulté qui aurait pu facilement être évitée si le constructeur avait pensé à regarder le tableau de bord, même au sol, et de nuit. Il est impossible de réduire la brillance du tube cathodique et sa luminosité empêche de distinguer correctement les autres instruments du tableau de bord. En outre le désembuage du parebrise est mal conçu et je me retrouve en finale en ne pouvant utiliser que les deux vitres latérales.
Le lendemain je règle facilement le problème en me rendant en ville et en achetant dans une librairie un morceau de plexiglas rouge. Je le découpe en cercle, je le scotche sur le tube et je peux enfin voir le tableau de bord. Le tout m'a coûté deux ou trois francs. Je rends compte bien sûr de cette mésaventure et je suis convoqué à Paris pour une réunion avec le STTA. Il en résulte la fourniture d'un accessoire qui ne fait pas mieux mais qui coûte 800 francs.
Je vais vivre de nuit une autre mésaventure. Il se trouve que le train d'atterrissage des Mirage était trop fragile au début. Il pouvait se briser lors d'un atterrissage normal. C'est le cas de celui de la photo ci-dessous qui s'est produit de jour. Le pauvre pilote n'y était pour rien.
Je décolle de nuit sur un SMB2 pour servir de plastron à un Mirage piloté par le Lt Boisnaud (un ancien de la 13). C'était une belle nuit très claire et après plusieurs passes il était temps de rentrer à la maison. Lequel de nous deux allait percer le premier ? Nous nous faisons des politesses et je lui dis à la radio :
- « Laisse-moi passer le premier par ce que si tu casses l'avion à l'atterrissage je n'aurais pas l'air malin ».
Il me répond :
- « N’importe quoi ».
et il descend le premier. Je le suis et au moment où je vais entrer dans le circuit de piste, la tour m'annonce :
- « le Mirage s'est cassé, il est sur la piste ».
Je fais un petit tour à basse altitude dans les environs en attendant qu'un camion grue dégage la carcasse. Mais il reste des débris sur la piste et je commence à manquer de carburant. Il ne me reste plus qu'une seule solution : je me pose dans le sens opposé de la piste en service et en faisant chauffer les freins, je m'arrête avant les premiers débris.
Par la suite, Dassault a renforcé les trains.
La haute altitude
Pour travailler à haute altitude, on avait prévu de monter sur cet appareil une fusée. J'ai pu effectuer un vol avec cet accessoire. Il faut savoir que à partir de 16.000 m si une décompression se produit, le sang bout à 37°. En temps de guerre il est donc prudent de revêtir l'habit "haute altitude" qui est le même que celui des cosmonautes. Mais en temps de paix j'ai fait l'impasse.
Sur cette fusée on ne peut sélectionner que 2 durées de fonctionnement : une ou deux minutes je crois et il n'y a pas de contrôle de la poussée autre que le choix de cette durée. Je monte donc à la tropopause et j'accélère à Mach 1.6 avec la postcombustion puis j'allume le chalumeau en maintenant le Mach. Et je monte, je monte sans doute au-delà de 60.000 pieds avant qu'elle ne s'éteigne. Mais gros problème, le réacteur n’aime pas cela du tout et il frôle le surrégime même avec la manette des gaz en plein ralenti. Je sors les aérofreins et redescend sans guère pouvoir faire autre chose.
J'en conclus que sur le plan opérationnel son utilisation n'est pas évidente. En outre pour mettre dans les réservoirs l'acide nitrique et l’hydrazine il faut sacrifier du fioul. Finalement je pense qu'il est préférable de garder ce fioul et de pouvoir utiliser plus longtemps la PC.
J'effectuais souvent des missions sans cette fusée aux environs de 45 ou 50.000 pieds. Lorsque l'avion est à un mach élevé à cette altitude on constate 2 choses :
- Il faut presque 2 minutes pour faire demi-tour et le diamètre de ce virage effectué à faible inclinaison est de plus de 50 km,
- La consommation de fuel de est de l'ordre de 300 kg par minute. Étant donné la faible autonomie de l'appareil, on a intérêt à terminer ce virage au cap de la base.
Et alors, la descente la plus économique possible est la percée opérationnelle. Cela consiste à mettre le nez à 30° sous l'horizon à l'aide de la boule, à sortir les aérofreins et à réduire les gaz. Dans cette configuration on ne consomme plus que 30 kg par minute. Il faut à peine une minute pour passer de l'altitude de travail à celle de l'approche GCA soit 1.500 pieds. Il est bien sûr inutile de regarder le vario car il est incapable d'afficher un taux de descente de 50.000 pieds par minute. Et on est obligé, à plusieurs reprises d’effectuer une manoeuvre de "valsalva" comme lors d'une descente en plongée sous-marine. J'adorais ce type de percée.
Le canon
En ce qui concerne le tir canon, nous disposions, à quelques minutes de vol, du champ de tir de Cazaux. Mais pour expérimenter le missile ainsi que les tirs canon sur des cibles ou véhicules réels, il fallait monter une expédition à Colomb Béchar.
Avant de relater le déroulement de cette campagne algérienne, je vais mentionner quelques faits marquants des essais effectués à Cazaux. Il s'agissait de tir canon air-air sur des cibles remorquées par des Vautour. Au début il s'agissait de panneaux en tissu dont la mise en oeuvre était délicate car il fallait les ramasser par une manoeuvre un peu acrobatique puis les larguer sur le terrain. Aussi les ingénieurs ont-ils mis au point un dispositif qui permettait de décoller normalement puis arrivé en altitude de dérouler un câble qui mettait l'engin à la distance de sécurité du remorqueur. Il s'agissait d'un bidon fuselé contenant de l'électronique et équipé sur son pourtour de quatre écouteurs. La reconstitution des sons enregistrés permettait de restituer la distance de passage des obus ainsi que la position spatiale de ce passage. Cet ensemble avait pour nom "Javelot".
Les ingénieurs avaient tout prévu sauf une chose : le Mirage III C en altitude (les tirs se faisaient vers 30.000 pieds) est une plate-forme très stable, dotée d’un exvellent canon de 30 mm et qui permet des tirs extrêmement précis. Après la destruction de quelques bidons par des rafales trop bien ajustées, l'expérience a été abandonnée.
Il y a eu également à Cazaux des tirs canon air-sol sur des cibles en textile.
J’ai en outre fait quelques vols d’évaluation du Matra 530 à tête infrarouge. Il n’était pas question de tir mais seulement d’accrochage. Nos armuriers ont été confrontés à un nouveau problème. La tête devait être refroidie à l’azote liquide. Entre cette tête et la réserve d’azote, il y avait des canalisations qui givraient.
Par contre ces vols, pendant lesquels nous nous approchions des Vautour remorqueurs, sans tirer bien sûr, nous ont permis de découvrir un tout autre phénomène, loin d'être agréable celui-là. En passant dans le souffle du Vautour, même sans trop s'approcher, le Mirage à mon grand étonnement se transformait en mobylette. Nous subissions un décrochage compresseur. L'avion vibrait, le réacteur ne poussait plus et la manette des gaz n'avait plus aucun effet sur son régime. Il y avait alors deux solutions :
- Couper le réacteur et descendre en vol à voile jusqu'à 6.000 m, altitude au-dessus de laquelle on ne peut pas rallumer. Croyez-moi, un Mirage planeur et silencieux ça fait bizarre et on espère avoir une batterie en bon état.
- Ou bien piquer presque à la verticale pour essayer de recoller les filets d'air dans le compresseur. Mais cela faisait perdre beaucoup d'altitude.
Nous avons par la suite eu l’explication de ces désagréments. Les réacteurs Atar livrés à l'Armée de l'air, avaient un compresseur dont les aubes étaient «"forgées finies". Il n’y a pas de petites économies. Les pilotes israéliens n'avaient pas ce problème. Nous avons alors su que leur compresseur possédait des aubes fraisées qui coûtaient plus cher bien sûr mais dont les côtes étaient respectées avec beaucoup plus de précision.
Venons-en à Colomb Béchar
Il fallait passer aux cibles réelles et une campagne de tir a été organisée sous la direction de la section chasse (Cne de Rousiers) avec la collaboration de la section NBT.
Nous sommes partis à 2 Mirage (le 3 mai 1962) et avions été précédés par deux Nord 2500 qui transportaient les mécaniciens de la section chasse, quelques pilotes de cette section ainsi que les radaristes et les armuriers de la section NBT. Le trajet de Mont-de-Marsan à Béchar, en évitant un peu les côtes espagnoles, durait 1h45 avec les bidons de 600 litres. Départ de bonne heure car sans ILS je redoutais plus le vent de sable que les brouillards de la vallée du Rhin.
Le lendemain, reconnaissance du polygone de tir d’Hamaguir à bord d’un B-26 du CEV. Sur ce polygone étaient implantés quatre postes occupés par quelques hommes sans défense particulière. Ils étaient équipés de ciné-télescopes (suisses) à très grande focale et filmant à un très grand nombre d’images par seconde. La photo ci-dessous témoigne de leurs performances : je suis à 30.000 pieds et le Mirage occupe la moitié d’une pellicule 24 x 36 (découpée dans une des bandes de film ramenées à Mont-de-Marsan dans d’énormes sacs). Dans le coin inférieur gauche : le chronomètre.

Nous faisons un ou 2 vols de reconnaissance et c’est fabuleux de raser les dunes à 900 km/h au lever du soleil. Quelques heures plus tard, cela ne sera plus possible à cause de la turbulence.
Nous commençons par les tirs air-sol sur un convoi de véhicules positionné à Hamaguir. Il y a des blindés légers (half-track) et des GMC. Nous procédons en essayant de reproduire les conditions opérationnelles : patrouille de deux avions et tirs directs sans procéder à une passe préalable de repérage. De cette mission nous pouvons tirer deux remarques :
- La première, concerne un phénomène déjà connu, celui de la configuration de la voilure du Mirage. Lorsque le pilote, après avoir lâché sa rafale, tire sur le manche pour reprendre de l'altitude il a besoin de modifier l'assiette de l'appareil. Il faudrait lui relever le nez mais bien au contraire les élevons se braquent vers le haut et on lui abaisse la queue en perdant une bonne partie de la portance. De ce fait, l'avion se trouve bien en position de cabré mais il s'enfonce. Ceci oblige à effectuer le tir sous un angle de piqué faible (15 à 20°). Il est donc impossible de piquer à la « stuka » et d'être précis avec des bombes classiques. Le problème a été par la suite résolu, partiellement d'abord par les Israéliens avec le Kfir en rajoutant de petites gouvernes canard fixes et puis de façon totalement satisfaisante sur le Rafale. Le Mirage III qui est une excellente plate-forme de tir en altitude, n'est pas du tout adapté au tir canon air-sol : il est même dangereux.
- La seconde, concerne les résultats de nos tirs. Nous partons en jeep. La fin du trajet se fait hors-piste et nécessite beaucoup de prudence car le terrain est parsemé de petites demi-sphères vertes qui paraissent être de mini-buissons (30 cm de haut). Mais elles sont très dures, pleines de sable aggloméré et la suspension du véhicule ne résisterait pas à leur rencontre.
Nous arrivons sur le lieu de stationnement du convoi attaqué et commençons à évaluer les dégâts. Et là ô surprise : il y a bien eu de nombreux coups au but, mais les pare-chocs des half-track sont à peine éraflés et le radiateur d'eau d'un GMC qui a pris un impact en son centre, est boursouflé, il fuit, mais n’est pas traversé. Nous trouvons de nombreux obus ouverts comme des boîtes de conserve avec à côté d'eux la poudre grise qui n'a pas brûlé.

Recherche d'impacts sur le "Half-Track"
Que s'est-il passé ? Nous avons utilisé des obus destinés à tirer sur des avions (ces obus sont suisses de marque « Oerlikon »). Ils ont été conçus pour traverser une faible épaisseur d'aluminium puis à exploser à l'intérieur de l'appareil. Ils comportent donc une enveloppe très mince contenant un maximum d'explosif. Lorsqu'ils rencontrent un blindage sous un angle faible, la fusée d'ogive se desserti de l'obus. Celui-ci s'ouvre comme un fruit trop mûr et la poudre brûle sans exploser ou ne brûle pas. Ces munitions sont donc totalement inadaptées pour des tirs air-sol. Nous avions utilisé quelques obus inertes, en métal plein : eux ont fait des trous. Mais pourquoi utiliser des obus suisses : notre industrie n’est-elle pas capable d'en produire ?? Pourquoi ne pas disposer d’obus spécifiques pour l’attaque au sol ? On n'est pas du tout le bienvenu quand on pose ce genre de questions. Est-ce que cela a changé aujourd'hui ? j'en doute.
Nous entamons ensuite l'expérimentation air-air des canons et du missile Matra 511. Avant de passer aux tirs réels, nous effectuons quelques vols sur des engins cibles subsoniques de type CT 20. Ils sont télécommandés depuis le sol. Il y a parfois des ratés au départ. Lorsque le pilote qui est déjà sanglé dans le Mirage doit attendre la mise en place sur la rampe de lancement d'une nouvelle cible, et qu'il ne dispose pas d'une combinaison ventilée, il perd beaucoup de sueur avant le décollage car nous sommes au mois de mai à la porte du désert.

CT-20
Lors de chaque vol, nous effectuons plusieurs décollages. En effet, la piste de Béchar dont le revêtement est en très bon état, présente des ondulations de grande amplitude qui ressemblent à la grande houle du Pacifique. Et l'avion quitte le sol deux ou trois fois avant un décollage définitif. Cette piste a été refaite plus tard et je pense que la campagne de 1964 en a profité.
La manoeuvre est délicate car l'accrochage du radar, celui du missile et le positionnement à distance de tir, doivent se faire sur une base qui ne fait que 17 km de longueur. À 30.000 pieds et à 0.9 de Mach pour le Mirage, on ne réussit pas à tous les coups. En outre pour que le tir soit autorisé par directeur des opérations, il faut que au moins trois télescopes aient acquis le Mirage dans leur champ et donnent trois feux verts à ce même directeur.

Matra 511
Nous décidons d'effectuer le tir missile avant le tir canon. Remarquez que missile est bien au singulier. Nous n'étions autorisés qu'à en tirer un seul. C’est pingre pour faire des statistiques et surtout pour qualifier raisonnablement cet engin !
Avant de quitter Mont-de-Marsan, j'avais étudié le cahier des charges qui définissait pour le constructeur les performances du missile. J'avais noté qu'il était précisé que l'engin devait pouvoir atteindre une cible qui virait avec une accélération de 2g. Or les expérimentations constructeur et CEV avaient toujours fait voler la cible en ligne droite. J'ai demandé de la faire virer avec une inclinaison de seulement 30° donc bien en deçà des spécifications.
Arrive le jour du tir sur une cible constituée par un mistral (C’est un Vampire remotorisé en France avec un réacteur Nene plus puissant). Il est télécommandé du sol par des mécaniciens et non par des pilotes.
Tout se déroule parfaitement : le Cyrano accroche la cible, le missile aussi, et j'obtiens le feu vert pour le tir. J'appuie sur la détente et rien ne se passe. Que faire ?
J'avais en mémoire l'accident d'un vautour du CEAM, au même endroit, quelques mois plus tôt. Il effectuait des tirs de roquettes situées dans des paniers escamotables sous le fuselage. Le panier arrière avait été tiré mais une des roquettes n'était pas partie. Lors de la mise à feu du panier avant, les jets brûlants sont venus lécher cette roquette et elle a explosé sous le fuselage. Sur un monoplace, le pilote se serait sans doute éjecté à temps. Mais à deux, on hésite un peu trop, on attend que le navigateur soit parti, et ils sont morts tous les deux.
À nouveau que faire ? Je ne sais pourquoi je décide de prendre le risque et au lieu de le larguer, je ramène l'engin au parking pour que les ingénieurs de chez Matra puissent diagnostiquer la raison de ce non fonctionnement. Ils découvrent qu'une pile auto-amorçable n'avait pas joué son rôle et avait été la cause de cet échec. Aucun remerciement !
A priori, ce n'était donc que partie remise mais, incroyable mais vrai, des impératifs administratifs vont venir contrecarrer le déroulement normal des essais. Le chef du détachement nous réunit et nous informe que la somme allouée pour les frais de déplacement de nos sous-officiers allait être épuisée et que nous ne pouvions pas prolonger le séjour.
Nous décidons alors d'un commun accord de réessayer le tir du missile puis si la cible n'était pas détruite de continuer au cours du même vol par le tir canon.
Je décolle à nouveau avec le missile qui a été entouré de toute la sollicitude des techniciens de chez Matra en blouse blanche. Mais cette fois les canons sont armés. Le vol se déroule normalement. J'obtiens le feu vert pour le tir. J'appuie sur la détente. Le Matra 511 s'échappe de sous mon fuselage avec une grande gerbe de fumée et de flammes. Je le vois qui se rapproche de la cible et il explose à proximité. Mais mon Mistral se comporte gaillardement, il continue à répondre correctement aux ordres de télécommande et ne paraît pas avoir été incommodé par l'explosion du missile. Appliquant les décisions prises pour abréger la campagne, je demande qu'on le repositionne sur la base, je fais moi-même un tour et effectue une approche pour le tir canon.
Pour vérifier l'efficacité de la conduite de tir et des armes, je décide de faire tout d'abord une passe en tirant d’assez loin. Je lâche une courte rafale à 700 m. J'aperçois un léger impact sur l'extrados de l'aile droite à moins d'un mètre du fuselage. Nous refaisons un tour et cette fois je décide d'ouvrir le feu à 400 m. La rafale aboutit dans la tuyère du Mistral dont le réacteur explose et il part en vrille. Je tire violemment sur le manche car la cible est à 0.6 de mach et le Mirage à 0.9. Cela se rapproche très vite et l'on ne tient pas à passer dans les éclats.
C'est avec un peu de tristesse, que je suis des yeux sa descente tournoyante qui n'en finit pas et que j'aperçois son explosion au sol.
Quand je rentre au parking, nos armuriers se précipitent avec un petit pochoir pour peindre la victoire sur le fuselage de l'avion. Mais je remarque que les techniciens de chez Matra font triste figure. Ils auraient voulu que l'on fasse poser le mistral pour vérifier si par hasard leur engin n'avait pas fait un petit trou dedans. Une sombre histoire de frais de déplacement dont le montant était sans aucun rapport avec le prix du missile et celui de la campagne, ne nous a pas permis de leur donner satisfaction.
Le lendemain un autre pilote (le lieutenant Bothe) a abattu un autre Mistral au canon. Et tout le monde a pu prendre le chemin de Mont-de-Marsan en faisant une escale, avec les Nord 2500, à la Senia, aéroport d'Oran. La piste venait de recevoir une nouvelle couche de bitume d’environ 8 cm d'épaisseur. L'autre Mirage a touché des roues quelques mètres avant le bitume et cette bosse a marqué les plombs du train. Cela a immobilisé l'appareil et je suis rentré seul à Mont-de-Marsan.
Une petite remarque sur la vie à Béchar. L’Algérie va devenir indépendante dans un mois. Ici pas la moindre trace de violence ou de danger. Nous pouvons boire un verre, tranquillement, le soir, sur la place du village : tout est normal. Avec un ami, pilote de Dakota je peux visiter la magnifique Beni-Abbes et ses dunes puis passer quelques heures à Tabelbala.
Convoyage vers Israël
J'ai convoyé le premier Mirage que nous avons vendu à Israël (29 juillet 1962). Nous étions une patrouille de trois Mirage III CJ. Il y avait le Cne de Rousiers. J'ai oublié le nom du troisième.
Mirage III CJ (Zdenek Machacek)
Notre Armée de l'air était dotée de trois types de bidons larguables : des 600 et des 1200 litres non supersoniques et des 600 litres supersoniques. Dassault a fabriqué pour Israël des 1700 litres que nous avons utilisés pour la première fois pour ce convoyage. Pour expérimenter ces bidons j'ai réalisé deux ou trois vols de longue durée en faisant des allers-retours entre Mont-de-Marsan et Solenzara. Parfois je faisais le tour de cette île magnifique, qu’est la Corse, avec la PC et les aérofreins pour gagner du temps.
Le jour du départ a été déterminé par une météo favorable car cette mission eût été impossible par vent contraire (pas de ravitaillement en vol sur Mirage III C). Les avions ont été remorqués jusqu'en bout de piste de Solenzara pour économiser la consommation de fioul du roulage. On les a alors mis sur vérins pour pouvoir compléter les réservoirs en y rajoutant une centaine de litres.
Nous étions sans papiers d'identité ni insignes de grade et avec un faux plan de vol pour Tunis. Au décollage, PC coupée dès le train rentré. Nous avons atteint notre destination en 2 h 50. Silence radio bien sûr pour que les Arabes ne puissent nous entendre. Trajet à finesse maximum, en croisière montante, commencé vers 33.000 pieds et terminé vers 43.000. Nous avons passé la côte israélienne avec 10 min d'autonomie restante. Nous aurions pu éventuellement effectuer 500 km de plus en larguant les bidons dès qu'ils étaient vides. Mais les Israéliens les avaient payés et les voulaient.
Nous avions pour nous repérer des travers de balises vers la Sicile, la Grèce, la Crête et Chypre (à l’époque, ni GPS ni centrale à inertie, juste radio compas et TACAN). En outre, un Nord 2.500 qui patrouillait entre la Grèce et Chypre avec à son bord le Col Maurin (commandant de la base de Mont-de-Marsan et futur chef d'État-major de l'Armée de l'air) nous aurait indiqué par radio tout changement important dans le régime des vents. Nous avons été pris en compte par les radars israéliens pratiquement depuis Chypre. Ils nous ont guidés vers Ramat-David.
À l'arrivée, je me suis quand même payé une remise de gaz. Il y avait un léger vent de travers et les bidons de 1.700 litres créaient un effet de sol auquel nous n'étions pas habitués. Ce petit palier, avec les roues près du sol et les ailes horizontales causait une légère dérive latérale. Plutôt que de risquer d'abîmer des pneus qui ne m'appartenaient pas, j'ai préféré recommencer. À peine posés nous étions dirigés vers des hangars souterrains.
L'accueil fut chaleureux. Une semaine complète avec chauffeur et voiture, hôtel de luxe, ski nautique sur le lac de Tibériade, visite d'un kibboutz, etc. Il y a même eu une soirée barbecue sur une montagne d'où nous dominions le pays avec vue sur la mer. Le chef d'État-major de l'Armée de l'air dont j'ai oublié le nom mais dont j'ai été étonné par la jeunesse me disait en me montrant le panorama et le couloir étroit qui reliait le pays à la capitale Jérusalem :
- « Ça ne peut pas rester comme ça, ils peuvent nous couper en deux en 10 minutes ».
Quelques années plus tard ils ont corrigé ça.
Le retour s'est effectué vers Zürich puis Bruxelles, à bord d'un 707 d’El Al dont les pilotes étaient d'anciens membres de l'escadron auquel nous venions d'amener les Mirage : le trajet s'est effectué dans le cockpit avec des verres de champagne. Un Convair de la Sabena nous a posés au Bourget d’où un Flamant nous a rapatriés sur Mont-de-Marsan.
L’EMSST (l’enseignement Militaire Supérieur Scientifique et Technique)
J’ai passé un peu plus de 2 ans au CEAM et j’y serai resté volontiers davantage mais j’avais osé :
- Critiquer les faibles performances du radar Cyrano,
- Au cours d’une campagne de tir à Colomb-Béchar, faire virer faiblement la cible,
- Effectuer le tir canon sans permettre de vérifier si l'explosion de la tête du missile n'avait pas, pour le moins, fait un petit trou dans ce pauvre Mistral,
- Révéler l’inefficacité de nos obus dans le tir air-sol,
- Montrer que le Mirage III C, sans gouvernes canard, était dangereux dans ce tir.
Les industriels n’ont pas apprécié ces analyses et ma hiérarchie ne m'a jamais défendu. Je sentais bien que par la suite, je serai écarté du circuit des essais et de tout poste de responsabilité au Bureau des Programmes de Matériel.
Pourtant j'étais en pleine possession de mes moyens et un des pilotes les plus aptes à utiliser et à mettre au point une conduite de tir.
J'étais encore capitaine. Je n'étais pas destiné à retourner en escadre et je n'avais absolument pas envie d'aller tout de suite servir de gratte-papier à l'État-major de la place Balard.
Les armées venaient de créer l’EMSST. Pourquoi ne pas poursuivre des études d'ingénieur. J'avais déjà le titre d'ingénieur de l'École de l'air mais ce n'était qu'une façade. Cette façade me donnait cependant droit d’intégrer une école d'ingénieurs en 2ème année.
Je postule et tant qu'à choisir j'opte pour l’IPG Institut Polytechnique de Grenoble dont j'avais déjà, quelques années auparavant, réussi l'examen d'entrée en classe préparatoire. Ma candidature est acceptée et je vais redevenir étudiant avec tout le confort de ma solde d'officier.
Je pense que je n'ai pas fait le bon choix. J'aurais dû choisir l’EPNER (École du Personnel Navigant Essais Réception). Mais on ne peut pas regretter toute sa vie une décision qu'on n'a pas prise.
Je rejoins donc cette école à la rentrée 1962. Il y a également 2 officiers mécaniciens de l'Armée de l'air et nous sommes 3 de plus de 30 ans avec des élèves d'une vingtaine d'années. Heureusement j'avais commencé en prévision de cette rentrée à étudier dans des livres de mathématiques et de physique. Car dès le départ en cette seconde année du cursus nous attaquons par les équations de Maxwell.
N’ayant pu faire venir ma famille lors du premier trimestre, je profite de l'hospitalité de l'École des pupilles de l'air et je prends dans leur mess le repas de midi.
En 2 ans, j'obtiens le diplôme d'ingénieur radioélectricien ainsi qu'une licence en électronique. Bien sur, le transistor vient seulement d'apparaître et l'on nous parle surtout des tubes et des antennes.
J'ai toujours la hantise d'aller faire le gratte-papier place Balard et je postule pour une 3ème année d'études qui m'est accordée. Je vais donc suivre les cours de la section "automatique" et l’été suivant je suis breveté ingénieur automaticien et j’obtiens un DEA "Diplôme d'études approfondies" en automatique.
Mais me direz-vous quid du vol pendant ces 3 années ? La première année, je suis toujours abonné au CEAM et j'utilise mes vacances scolaires pour aller voler. Quand un des professeurs de l'école me demande comment j'ai utilisé mes vacances de Pâques et que je lui réponds que c'est en volant sur Mirage III, il est plus qu'étonné. J'ai encore des amis sur place et pour écourter le trajet et pour pouvoir voler davantage je rejoins en voiture la base de Chambéry toute proche. C'est là que le Lt Lebourg vient me chercher avec un Morane Saulnier Paris et il me pose à Mont-de-Marsan. Il me ramène à Chambéry en fin de séjour.
Les 2 années suivantes, je suis abonné à la 5ème escadre d'Orange et je peux m'y rendre directement en voiture pour voler sur SMB2. Je suis considéré comme un des pilotes de cette escadre. Je peux décoller en leader d’une patrouille de 4 avions ou faire des exercices d'atterrissage guidé par radar de nuit et par mauvais temps.
Deux anecdotes.
- Nous partons à 2 avions pour un exercice de combat. Nous sommes en virage serré vers 30.000 pieds en essayant de passer derrière l'autre. Soudain alors que je serre un peu plus le virage et que j’ai le nez au-dessus de l'horizon mon avion déclenche brutalement vers l'extérieur du virage et il part en vrille. Je n'avais jamais fait de vrille volontaire depuis le T-6. Et d'ailleurs que ce soit sur Mirage ou sur SMB2 cet exercice est très peu recommandé et même interdit.
La vrille est très violente et à chaque tour, le nez de l'avion passe au-dessus et au-dessous de l'horizon. Comme il fait beau, je vois le sol. Nous sommes au-dessus de la Durance et j'ai l'impression que ce n'est pas mon avion qui pivote mais que c'est cette rivière qui tourne de façon saccadée en dessous de moi. Mes efforts pour en sortir semblent vains et je vois l’altitude qui décroît. La consigne c’est que à 3.000 pieds on doit s’éjecter. Mon équipier, qui observe la scène me crie à la radio :
- « Mon capitaine quelle gamelle !».
Alors que je me prépare à l'éjection, la rotation s'arrête à 5.000 pieds. Je garde le nez sous l'horizon pour prendre de la vitesse et le reste du vol s'effectue normalement. Mais j'ai toujours en mémoire cette Durance qui tourne.
- Je décolle en leader d'une patrouille de 4 par un très mauvais temps et nous effectuons des exercices au-dessus de la couche nuageuse. Quand arrive le moment du retour, je demande au contrôleur du Mont-Agel, qui ne nous avait pas en contact radar de me donner un cap pour rentrer au terrain. Pour satisfaire ma demande, il utilise un goniomètre. Il me donne un cap. Heureusement par un calcul mental rapide je réalise que ce cap est farfelu et je ne le suis pas. J'arrive à l'estime à ramener la patrouille aux environs de la base d'Orange et nous effectuons une percée normale. Si j'avais suivi le cap indiqué par ce contrôleur, nos 4 avions auraient percuté les Alpes...
Nous sommes en été 1965 et cette fois à la fin de ma permission, le gratte-papier je n'y couperai pas.
L’EMAA, Bureau transmissions
Bd Victor, non loin de la place Balard, se trouvent les bâtiments abritant l'État-Major de l'Armée de l'Air. Le sous-chef opérations de cet état-major, (un général) coiffe plusieurs bureaux. Il y a bien sûr le Bureau des Programmes de Matériel qui définit en principe les caractéristiques de nos futurs avions. En fait il ne définit pas grand-chose car il obéit aux suggestions des industriels et bien sûr aux contraintes économiques. Ce sont ces dernières qui aboutissent en général à la conception d'un appareil unique qualifié de "multi-rôle".
Cette décision permet sans doute de faire des économies. Mais dans chaque mission particulière un appareil polyvalent est toujours médiocre par rapport à un appareil spécialisé. Et puis nous avons raté la coopération européenne et les Allemands ont acheté 700 F-104. Plus tard il y aura d'un côté le Rafale et de l'autre côté l’Eurofighter. Et pourtant on sait bien que les frais de recherche et de développement sont toujours divisés par le nombre d'appareils produits...
C'est dans ce bureau que j’eusse aimé être affecté. Hélas...
En cette fin d'été 1965, j'atterris dans le Bureau Transmissions. Il est commandé par le colonel Furet. Ce bureau joue un peu le rôle du bureau précédent en ce qui concerne les matériels de télécommunications de l'Armée de l'air et notamment les postes de radio équipant nos avions. Je suis chargé de ventiler le budget annuel attribué à ces matériels. Mais là encore ce sont surtout les personnels de la DMA (Direction Ministérielle de l’Armement), en particulier le STTA (Service Technique des Télécommunications de l'Air) qui décident. En effet ce sont eux qui passent les marchés avec les industriels.
Une chose me choque tout de suite : nous rejoignons notre lieu de travail, et nous travaillons, en civil. Nous sommes dans un pays dans lequel les militaires ont honte de prendre le métro en uniforme. À mes yeux c’est très grave.
Pendant 3 mois, je suis logé avec ma famille dans un hôtel "conventionné". Ce sont des bâtiments qui seraient depuis longtemps passés au bulldozer si l'État ne les finançait pas ainsi artificiellement. Depuis 3 ans, les prix de l'immobilier explosent à cause de la demande importante qui est due à l'arrivée chez nous de plus de 500.000 réfugiés pieds-noirs. Grâce à mes beaux-parents, j'arrive à cependant à réunir l'apport initial pour acheter, à crédit, un appartement à Châtillon-sous-Bagneux.
Je n'ai pas des rapports excellents avec le chef du bureau. Ce dernier sachant qu'il a peu de chances de passer général prépare avec zèle le concours du Contrôle général des armées. Un an plus tard d'ailleurs, (il avait des relations) il intègre ce corps des planqués de la République. Il n’aime pas trop me voir quitter le bureau pendant la semaine pour aller voler.
J'ai pu être abonné à la 10ème escadre sur la base de Creil. Je pourrai voler sur Super-Mystère SMB2. Mais je devrai y consacrer mes week-ends. Heureusement ma présence soulage les pilotes de l'escadron car je prends à leur place la PO (Permanence Opérationnelle). J'arrive en général, à effectuer six missions en 2 jours.
Je suis également chargé de rédiger un texte qui définit l'organisation des moyens de télécommunications de l'armée de l'air. Ce n'est pas simple, car ces moyens sont répartis entre 3 entités :
- Le CTAA (Commandement des Transmissions de l’Armée de l’Air) qui gère les liaisons à grande distance et les matériels téléphoniques,
- Le CAFDA (Commandement Air des Forces de Défense Aériennes) qui gère les Radars, les Centres de contrôle et les liaisons Air-Sol),
- Les régions aériennes qui gèrent les moyens des bases via les STB (Section de Transmission de Base).
La répartition de ces moyens est complexe et elle est sujette à des rivalités. Quand je rédige un brouillon, nos dactylos doivent le taper dans une pièce ou leurs machines mécaniques font un bruit d'enfer. Par la suite ce texte de plusieurs de pages, est proposé aux différents généraux qui doivent l'approuver. Lorsque l'un d’eux change, fusse une virgule, il faut tout retaper. C'est là que les traitements de textes auraient été les bienvenus.
Au bout d’un an, c'est le colonel Pineau qui devient le chef de bureau. L'ambiance change tout de suite. Nous avons beaucoup d'affinités et il m'a pris sous son aile. Il me demande toujours de l'accompagner lorsque nous sommes reçus par des industriels. Après les visites d'usine d'ailleurs, nous terminons la plupart du temps dans des restaurants huppés de l'avenue des Champs Élysées. Il y a même eu une soirée au Crazy Horse.
D'ailleurs c’est lui qui m'encourage à aller voler à Creil même pendant la semaine.
Bien qu’appartenant à une illustre famille, il n'en montre rien. Par la suite après avoir suivi les cours de l’ESGA, je pense que j'aurais pu avoir grâce à lui une autre fin de carrière. Devenu général, il occupait un poste important au sein de la direction du CEA. Et c'est avec de nombreux responsables de ce CEA qu'il monte un jour dans un bi-turbopropulseur Nord 262. Cet avion, peut-être à cause de givrage, s’écrase dans les Cévennes. Il n'y a aucun survivant. Outre la peine sincère que j'éprouvais en apprenant cette nouvelle, je savais que désormais je n’obtiendrai jamais les étoiles de général.
L’ESGA (École Supérieure de Guerre Aérienne)
Je suis enfin passé commandant après 8 ans de capitaine alors que quelques camarades de promotion sont déjà lieutenant-colonel. Ceci n'augure rien de bon pour l'avenir. En effet lorsque les tableaux d'avancement annuel sont publiés, les futurs promus y figurent par ordre inverse d’ancienneté dans le grade. Dans mon cas je suis sûr de ne pouvoir être nommé au grade supérieur qu'en décembre ou éventuellement en janvier de l'année suivante et cela s'accumule.
Normalement en étant titulaire de l’EMSST, je dois pouvoir accéder sur titre à l'ESGA sans passer par le concours d'entrée. J'en effectue la demande et cela m'est refusé. Je suis suffisamment proche de l'obtention des diplômes d'ingénieur pour pouvoir envisager un emploi dans l'industrie. Mais je ne veux pas démissionner purement et simplement et je demande à obtenir un "congé du personnel navigant". Cela m'est également refusé.
Alors je demande à passer le concours d'entrée à l’ESGA. Ma demande est acceptée. Je suppose que c’est grâce à une intervention du colonel Pineau auprès du sous-chef OPS l’orgueilleux Gal Fabry. Je passe le concours en 1968 et je suis reçu dans les premiers. Ce stage est une étape indispensable pour les futurs généraux. Et c'est pour cela qu’il y a eu une certaine résistance à m'y inclure. Mais ce concours a lieu au mois de mai et je dois éviter les zones chaudes de Paris pour aller passer les épreuves en étant en uniforme.
Nous commençons les cours à l'École militaire. Il y a encore dans cette ancienne caserne des écuries et des chevaux. Nous voyons évoluer dans la cour des nostalgiques de cette monture.
Je vais pendant toute une année être très intéressé à la fois par les cours qui sont prodigués par d'excellents intervenants et par les différentes visites ainsi que par le grand voyage d’étude. Nous devons parfois faire des exposés à des représentants du monde politique. Comme par hasard je suis choisi pour cette tâche. Je me retrouve sur une estrade et à quelques mètres devant moi se trouvent : le général de Gaulle, Michel Debré et M. Couve de Murville. Je dois alors exposer le fonctionnement des forces aériennes stratégiques dont je ne ferai jamais partie bien qu'étant le seul français titulaire du diplôme "NATO Nuclear Weapons Employment Course". La France a le chic pour ne pas employer les compétences de ses serviteurs.
Nous sommes surtout des commandants mais plusieurs stagiaires sont lieutenant-colonel. Nous visitons quelques sites industriels et notamment l’aciérie de Dunkerque. Nous visitons un site où sont fabriquées les ailes du Mirage. Des fraiseuses creusent dans des plaques d’alliage léger de presque 20 cm d’épaisseur pour enlever du métal entre les nervures de l’aile. Celle ci est ensuite réalisée en assemblant 2 de ces blocs. Il n’y a donc aucun rivet dont la tête viendrait perturber l’écoulement de l’air à grande vitesse. Mais lorsqu’ils sont libérés des griffes qui les maintiennent sur le plateau de la fraiseuse, ils se gondolent légèrement. Ils avaient pourtant auparavant été envoyés aux États-Unis pour y subir un traitement thermique spécifique.
Et là, malgré toute la technique moderne, on doit recourir à l'homme. C'est un vieil ouvrier (et peut-être le seul dans cette usine) qui à l'aide d'une presse hydraulique contrôlée à la main, redonne à ces plaques la planéité nécessaire.
Et puis il y a le grand voyage d’étude. Nous partons dans un DC-6. Nous commençons par les États-Unis avec escale aux Açores.
Avant de les quitter nous nous posons à Seattle près de l'usine où sont fabriqués les énormes 747. Ce terrain appartient à la firme Boeing et lorsque nous y arrivons avec un ancêtre à hélices, qui plus est : un Douglas, nous provoquons beaucoup de curiosité.
Là aussi nous voyons des fraiseuses qui enlèvent des mètres cubes de copeaux d'aluminium que des convoyeurs souterrains amènent vers les sites de recyclage.
Nous sommes reçus par le PDG de Boeing et après son briefing, vient l'heure des questions. L'un des stagiaires pose alors la question que je n'aurais osé poser :
- « Que pensez-vous du Concorde ».
Et sa réponse cinglante fuse immédiatement :
- « Play with it. I am making money out of mine » (Jouez avec. Moi je fais de l'argent avec le mien).
Et puis notre quadrimoteur nous amène au Japon où nous allons passer plus d'une semaine. Comme il a les pattes trop courtes nous y amener d'une seule traite, nous prenons le chemin des écoliers. Nous faisons le tour du Pacifique en faisant une escale en Alaska et une autre dans une petite île située dans la chaîne des Aléoutiennes. Cette petite île, c’est Adak où il y a une base américaine et nous en reparlerons lorsque j'évoquerai le voyage retour.
Nous arrivons par un temps superbe. Étant du bon côté de l'appareil, je peux prendre de très beaux clichés de la cime enneigée du Fuji-San (que les français prononcent, je ne sais pourquoi : Fuji-Yama). Nous nous poserons successivement à Tokyo, Iruma, Nagoya, Osaka puis Tokyo.
Nous assistons à une réception pendant laquelle l'ambassadeur de France tient des propos de type "quai d’Orsay". Il dit à demi-mot que les militaires ne servent pas à grand-chose. Par politesse je me suis tû. Mais j'avais une énorme envie de lui poser la question suivante :
- « À quoi peuvent bien servir les ambassadeurs depuis qu'on a inventé le téléphone ?».
Nous alternons la visite de sites touristiques avec celle de centres industriels. Nous visitons une usine d'électronique (j'en sors avec dans ma poche une petite poignée de transistors). Nous visitons une usine d'automobiles, un chantier naval, et une aciérie. Cette dernière, comme celle de Dunkerque, est en bord de mer et les bateaux minéraliers peuvent déverser directement leur contenu. C'est pourquoi je ne suis pas étonné à l'heure où j'écris ces lignes qu'on ait dû fermer les hauts-fourneaux de Lorraine.
Nous assistons depuis notre hôtel à une manifestation violente dont j'ignore la cause. Pour eux cela semble être de la routine. Quelques heures auparavant toutes les vitrines sont protégées par des panneaux de contreplaqué. Dès que les manifestants sont passés, les panneaux disparaissent et la vie reprend son cours.
Nous passons une demi-journée au Ministère de la défense. La discussion avec les officiers supérieurs japonais se fait bien sûr en anglais. Les mots passent mais pas les idées. Et pourtant ce n'est pas une question de compréhension de la langue puisque parmi nous il y a un officier supérieur anglais.
Nous repartons en direction de l'Alaska. Ce n'est qu'une tentative car par suite d'un ennui moteur nous devons faire demi-tour et après 5 h de vol nous revenons à Tokyo. Nouvel essai et cette fois nous nous posons à Adak. Le paysage est une vraie désolation. En dehors de la piste et de quelques bâtiments il n'y a qu'une petite herbe rase spécifique des régions arctiques. Les Américains qui vivent sur cette base se rendent de leur lieu de travail vers leur logement et leurs lieux de distraction par des souterrains. Ils sont là avec leur famille et ils sont assez nombreux pour qu'il y ait même un lycée. Nous sommes accueillis par le professeur de français ce lycée. Il y a un petit port et nous apprenons qu’un jour ils ont accueilli un sous-marin soviétique à bord duquel un marin devait subir l'ablation de l'appendice. L'escale se prolonge un peu car notre vieil appareil à des problèmes sur les volets de capot de l'un de ses moteurs. Les américains nous le réparent.
Prochaine étape : l'Alaska. Nous nous posons à Anchorage qui a été secoué quelque mois plus tôt par un violent tremblement de terre. Comme il y a surtout des maisons basses en bois, il y a eu peu de victimes. Sur la base militaire, il y a un gros trafic d'avions-cargo. Ils constituent un pont aérien pour amener du matériel au Viet-Nam.
Dans cet immense pays grand comme 3 fois la France, il y a de nombreux lacs et beaucoup d'avions privés qui se posent soit sur skis soit sur flotteurs. Il y a un brevet de pilote pour 75 habitants et un avion pour 125 habitants. De nombreux chasseurs et pêcheurs n'hésitent pas à partir très loin le week-end pour pratiquer leur distraction favorite. Et les militaires américains qui nous accueillent, nous disent que leur travail du lundi matin consiste à aller retrouver ou dépanner ces téméraires qui se sont posés à des milliers de kilomètres de leur terrain de départ.
Prochaine destination le Groenland. Le trajet se fait de jour et d'ailleurs ce n'est pas difficile car à ces latitudes, au mois de mai, le soleil ne se couche pas. Les lacs et la terre se confondent car tout est blanc. Nous admirons au passage les 6.000 m du mont Mac Kinley. Nous nous posons sur la base de Thulé qui se trouve sur la côte nord-ouest de cette grande île. Nous y passerons la "nuit" puis le jour suivant nous visiterons les grandes antennes, fixes et gigantesques. On dirait des terrains de football relevés à la verticale. Nous sommes reçus au centre de contrôle qui pourrait détecter le départ d'un missile balistique soviétique. En dehors des militaires, ce sont des techniciens civils qui sont chargés de la maintenance et de l'exploitation de ces radars. Contrairement aux militaires qui ne font que de brefs séjours, ils passent toute l'année sur le site mais leur salaire est fixé en conséquence.
Nous assistons à plusieurs briefings. Nous notons la présence d'un officier danois qui est chez lui. On nous explique comment, il y a quelques années, ils ont dû gratter la banquise sur plusieurs hectares à la suite du crash d'un bombardier B-52 porteur de plusieurs armes nucléaires. La neige récupérée à été mise dans des conteneurs qui sont partis aux États-Unis pour décontamination. Quelques armes sont toujours au fond de l'océan.
Pour prolonger la période pendant laquelle des bateaux peuvent accoster dans le port et ravitailler la base, il y a des compresseurs dont l'air remonte en grosses bulles le long du quai. Ils empêchent ainsi la glace de se former. Tous les bâtiments sont sur pilotis car ils sont construits sur du permafrost il ne faut surtout pas réchauffer le sol sous peine de s'enfoncer. La piste est d'un blanc immaculé et sur le côté des hangars on voit de grosses manches à air destinées à faire passer de l'air glacé sous les bâtiments.
Et finalement c'est le retour vers la France avec une escale sur l'aéroport de Keflavik en Islande. Rien n'avait été prévu pour accueillir les nouveaux jets transportant des centaines de passagers. Comme il y en avait un en même temps que nous, nous n'avons pas pu aller aux toilettes car la queue était trop longue.
Après le retour à Paris, et quelques semaines de stage interarmées, nous allons découvrir notre nouvelle affectation. Pour moi la cause est entendue : ce sera le CTAA.
CTAA (Commandement des Transmissions de l’Armée de l’Air)
Je suis donc affecté, en janvier 1970, à l'État-major de ce commandement qui se trouve sur la base de Villacoublay. J’y serai sous-chef opérations. Je ne serai promu au grade de lieutenant-colonel qu'au mois d'août de la même année.
Il y a des escadrons de câbles hertziens dont une partie du personnel est répartie sur des points hauts et notamment au sommet du mont Ventoux. Ils assurent le fonctionnement des faisceaux hertziens dont le réseau permet de relier quelques bases et c'est très important, de faire transiter des communications qui repartiront en radio vers les avions en vol.
Le réseau Air-70 est en cours d'installation. Les liaisons existantes ne fonctionnent qu'à vue directe. Les nouveaux faisceaux seront troposphériques et ils pourront faire des bonds de 300 km. Ils permettront de relier nos centres d'opérations et toutes nos bases, jusqu'en Corse, en étant totalement indépendants des PTT.
Ces matériels sont partiellement révolutionnaires. En effet les commutateurs qui sont sur les points hauts ne ressemblent en rien à nos vieux centraux téléphoniques mécaniques. La commutation est numérique temporelle. Par contre les liaisons entre points haut, sont conventionnelles et utilisent la transposition de fréquence. Pour avoir une telle portée ils utilisent d’énormes paraboles de 9 m de diamètre. Nous étions également en train de mettre en place sur les bases des relais automatiques de commutation de messages. Ce système s'appelait le RAID.
Avec le Col Roche qui est chef d'état-major nous allons souvent visiter ces diverses installations en prenant d'abord un MS Paris, puis ensuite soit en hélicoptère soit en voiture.
Cela me permet de voler un peu et surtout de pouvoir m'intégrer dans la circulation aérienne générale quelle que soit la météo. Mais je vais également continuer à voler sur SMB 2 à la 10ème escadre sur la base de Creil. Cette escadre va toucher des Mirage III C et je vais à nouveau voler sur Mirage dès novembre 1972. Entre-temps, la version biplace a été produite et je vais pouvoir effectuer une reprise en main sur Mirage III B à Dijon.
Le gouvernement nous a également confié une autre mission qui consiste à assurer le contrôle de la circulation aérienne en cas de grève des contrôleurs civils. Le CTAA fourni les techniciens et le CAFDA les contrôleurs. Cette mesure s'appelle "Clément Marot". Pour la préparer nous envoyons nos techniciens visiter les centres de contrôle civils. Mais là encore nous sommes le pays des demi-mesures. Ces visites ont lieu sous forme touristique et nos techniciens sont en civil. Pour pouvoir redémarrer les ordinateurs si les grévistes les ont arrêtés, il faut pouvoir disposer d'un double des bandes magnétiques. Le chef de centre refuse de nous les donner car nous dit-il :
- « Si ils le savent, ils vont me tuer ».
Cette mesure est appliquée à plusieurs reprises mais dans de très mauvaises conditions. Par exemple à Orly nos contrôleurs sont sous la tente avec les pieds dans la boue. Ils ont une très mauvaise visibilité du trafic au sol. Pendant ce temps les grévistes qu'il n'est pas question de déloger, sont bien au chaud et jouent aux cartes en haut de la tour de contrôle. Et puis les pilotes d'Air France n'y mettent pas du leur. Nous avons des bandes magnétiques enregistrant leur refus d'obéir aux consignes des contrôleurs militaires. Ce qui devait arriver arriva : il y il eut à Nantes une collision entre 2 avions et de nombreuses victimes. Par la suite le gouvernement renoncera à briser ces grèves et les contrôleurs seront rois. Ils le sont toujours plus de 40 ans plus tard. En outre nous ne tenons pas nos engagements internationaux puisque lors de leurs grèves à répétition, ils paralysent une partie du trafic aérien européen. Et je ne parle pas de la gêne que cela entraîne pour les usagers.
Il faut être un pays très riche pour se payer deux systèmes indépendants de contrôle aérien en dédoublant tous les moyens depuis les radars jusqu'aux salles de contrôle. A quand un système européen unifié ?
Comme sous-chef opérations, j'ai également sous mes ordres deux services très particuliers :
- La banque des quartz. Une bonne partie de nos avions de transport et de liaison sont encore équipés avec des postes radio qui nécessitent un quartz spécial pour chaque fréquence. Comme les équipages de transport peuvent partir en mission en Afrique ou à l'étranger à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, notre banque des quartz doit fonctionner 24/24 pour les satisfaire. Pourtant les avions de combat sont déjà équipés d'un poste à standard de fréquence. Dans ce cas, un seul quartz suffit pour générer toutes les fréquences nécessaires. Et ce quartz est considéré comme un matériel technique qui est géré tout simplement par la DCMAA.
Il n'en est pas de même pour les quartz de notre banque. Par conservatisme, et par manque d'imagination, nous avons conservé pour ces cristaux la même manie du secret que celle qui devait protéger les fréquences lors de la 2ème guerre mondiale. Ce ne sont donc ni des matériels techniques ni encore moins des matériels du Commissariat. Que sont-ils alors ? Eh bien ce sont des "documents Secret Défense". Et comme Courteline n'est pas mort, il est impossible de les réformer. Que faire lorsqu’un lot de certains d'entre eux n’a plus d'utilité ? Eh bien comme ce sont des documents on va les traiter comme tels. On doit les incinérer ! On creuse un trou, on les arrose d’essence et on met le feu. J'ai essayé d'expliquer au général commandant le CTAA (c'était le Gal Simard) qu’il fallait sortir de cette situation ubuesque. Il n'a pas osé prendre cette décision et je ne sais pas combien d'années après mon départ a pu durer cette comédie. C'était d'autant plus ridicule que l'on pouvait se procurer ces mêmes quartz à très faible prix chez tous les marchands de surplus. - Le chiffre : tous les messages, à partir de "Confidentiel Défense" devaient être chiffrés. Il y avait encore dans les STB et à bord des avions de transport de vieilles machines mécaniques datant de la Seconde Guerre Mondiale. Il fallait les remplacer en utilisant la rapidité et surtout la sécurité permises par l'électronique. Il y avait en concurrence des projets d'industriels différents soutenus par chacune des 3 armées. Chacun d'eux portait un nom de fleur. Celle de la marine n'eut aucune chance car l'amiral qui le soutenait est décédé. Il y a eu une lutte féroce entre les 2 autres et je ne trahirai pas le nom de celle qui a gagné et qui fut donc utilisée par les 3 armées.
Il y avait également une tâche très particulière dont je peux parler aujourd’hui car on trouve tous les détails sur internet. Elle n’est donc plus comme à l’époque couverte par le secret défense. Nous devions assurer toutes les liaisons chiffrées avec B2 Namous y compris les courriers entre les personnels et leur famille. Pour connaître l’activité de ce sîte que nous avions conservé bien après l’indépendance de l’Algérie, il suffit d’aller sur Wikipédia.
La Polynésie : l'atoll de Hao
Il y avait plus de 2 ans que j'occupais ce poste et il fallait bien penser à la suite. De toutes façons je n'étais pas destiné à commander une base. Lorsque j'allais voler à Creil, j'en discutais avec le Col Colombet. Et il me parlait de son séjour en Polynésie. Pourquoi pas. Je savais que le poste de chef des Moyens opérationnels de l’atoll de Hao qui était tenu par mon ami Billard allait devenir disponible. J'ai postulé et ma candidature a été retenue.
Fin juin 1973, je rejoins donc Papeete dans un DC-8 du COTAM. Ce voyage est très agréable puisque effectué en grande partie devant avec les pilotes.

Douglas DC-8
24 heures plus tard l'un des quatre DC-6 que l'Armée de l'air met en oeuvre sur l’aéroport de Faaa me dépose à Hao, 900 km plus à l’est. Quel dépaysement ! Et Mururoa est encore 450 km plus loin.

Douglas DC-6
Cette Polynésie c’est surtout de l’eau avec quelques volcans qui en s'enfonçant lentement au fil des siècles ont laissé surnager une couronne de corail. Quelques-uns dépassent encore et ce sont les îles hautes telles que Tahiti, Moorea et Bora-Bora. L'ensemble à la même surface que l'Europe.
Le 15 du même mois, j'avais encore volé sur Mirage III C à Creil et le 30 ce mois de juin, je fais mon premier vol en double sur l’un de nos deux Cessna 411. Ce sont des petites merveilles de bimoteurs de tourisme.

Cessna 411
Il y a sur cet atoll, un escadron de Vautour. C’est le "Loire" dont les appareils sont utilisés lors des campagnes de tir. Les Vautours IIN prennent des photos tandis que les Vautours IIB traversent le nuage une heure après les tirs pour prélever des poussières qui seront analysées dans les laboratoires du CEA.

Le parking du "Loire"

Un V2B-PP : à l'avant des bidons, l'écope permettant le prélèvement de poussières
Le mois suivant, j'effectue quelques vols en double sur Cessna avec des tours de piste, des exercices en monomoteur et des approches ILS (Instrument Landing System). Avec son pilote automatique couplé au récepteur ILS, je ne peux qu'admirer la précision de sa trajectoire.
Le "Loire" a reçu un message du 3ème Bureau l'informant que je serais abonné chez lui. Pendant tout le mois de juillet, j’étudie les différents circuits du Vautour puis je fais des exercices de roulage au sol. Je fais même un simulacre de décollage en sortant le parachute de queue avant de rentrer au parking.
Pourquoi tous ces préalables ? Cet appareil a un train d’atterrissage très particulier. Il a 2 diabolos principaux sous le fuselage et 2 petites balancines sous les ailes. Mais pourquoi nos ingénieurs ont-ils voulu faire mieux que les autres ? La direction, lorsque l'appareil est au sol, est bien assurée par la rotation du diabolo avant. Cette rotation est bien commandée par le palonnier. Mais alors que dans tous les autres avions du monde la position du palonnier détermine la position du train avant, ici sa position détermine la vitesse de rotation de ce train. Il fallait y penser et il faut s'y habituer.
Le 30 juillet, je me suis lâché sur un Vautour IIN. Ce jour-là, je n'ai pas de navigateur en place arrière. De la salle d'opération du "Loire", on a une vue plongeante sur le début de la piste. Et tous les navigateurs de l'escadron ont le nez collé à la vitre en faisant des paris sur le nombre de booms que je pourrais faire à l’atterrissage. Cet avion, qui est réputé "kangourou" à l’atterrissage, est très facile à piloter : je n'en fais aucun. Et lors des vols suivants, j'aurai un navigateur derrière moi.
Par la suite, je dois satisfaire aux rites de l'escadron et l'on me trempe, en combinaison de vol, dans une grande douve remplie d’eau. Heureusement bien que nous soyons au milieu de l'hiver austral, il fait chaud. Et c'est ainsi trempé, que j'arrive au mess où l'on m’attend pour le repas de midi.
L’atoll a 50 km de long et 20 de large. J'ai pris cette photo à 42.000 pieds en Vautour. J'avais mon 6 x 6 noir et blanc, et j’ai incliné l’avion à 90° sur la gauche pour prendre le cliché à travers la verrière.
Sur la gauche de la photo on voit (en zoomant et de bas en haut), la passe Kaki, le parking et les hangars puis la piste de 3.000 m qui pouvait servir de secours à la navette US.



La base d'Hao
Quelques détails de la vie quotidienne avant de passer à la partie opérationnelle.
Les moustiques nous gâchent la vie. À l'intérieur des bâtiments on s'en protège en faisant brûler de petites spirales vertes que l'on appelle des "tortillons chinois". Pour l'extérieur nous faisons procéder, chaque semaine, à un démoustiquage par pulvérisation. Mais ces petites bêtes sont malines. Si on pulvérise à partir d'un hélicoptère, elles se réfugient sous les cocotiers. Si on procède à partir d'un camion elles passent au-dessus. On est donc obligé de travailler en simultané hélicoptère et camion. Malheureusement dans le village d’Otepa qui est tout proche, les habitants recueillent l'eau de pluie à partir de ce qui tombe sur leurs toitures. Il est donc impossible d'intervenir sur le village et en quelques jours les moustiques épargnés envahissent à nouveau la base.
Nous avons un club sportif au bord du lagon et nous pouvons pratiquer la voile sur de petits dériveurs ainsi que le ski nautique. Mais je suis particulièrement intéressé par la plongée sous-marine. Juste avant mon départ j'avais effectué un stage d'une dizaine de jours dans un club près de Toulon, mais je n'étais pas moniteur. Le successeur du Col Chamouton, le Col Leroy, m'aide à créer un club et nous pouvons trouver, parmi les hommes du rang effectuant leur service, les moniteurs nécessaires.
Sur un atoll, il n'y a pas d'eau douce et pas de ruissellement car le corail est perméable. On peut en creusant presque 2 m trouver de l'eau saumâtre et on arrive dans ce trou à faire pousser des pastèques. Il n'avait pas été envisagé de récupérer l’eau de pluie, abondante sous ce climat, par crainte de retombées. Il n'y en a jamais eu. Pour la base vie il y a des bouilleurs mis en oeuvre et entretenus par les légionnaires. Nous consommons mensuellement 40 t de fuel pour faire bouillir l’eau du lagon. Le réseau de canalisations qui va vers les bâtiments n'est pas dédoublé, il est en mauvais état et il y a des fuites. Mais, luxe suprême, les chasses d'eau de nos WC sont alimentées en eau distillée. Il en faut cependant une centaine de litres pour les réacteurs qui utilisent de l'injection d'eau lors du décollage. L'eau distillée qui est produite doit je ne sais pourquoi être reminéralisée. Les sacs qui contiennent ces minéraux arrivent par bateau.
C'est comme cela que je découvre que je suis le directeur d'un aéroport. Je n'avais jamais pensé que la dernière syllabe de ce mot pouvait être prise à la lettre. Les cargos entrant par la passe Kaki peuvent venir se mettre le long d'un quai pour décharger leur cargaison. Je découvre également que mon correspondant concernant le traitement de cette cargaison, n'est pas le capitaine du bateau mais que c'est le "subrécargue".
Un jour un cargo arrive avec une cargaison de ciment. Ses grues déposent les palettes sur le quai. Il va pleuvoir et il est impératif de mettre ce ciment à l'abri dans nos hangars. J'ai à ma disposition suffisamment de légionnaires pour effectuer ce travail rapidement avant la pluie. L'État-major de Papeete m'interdit de le faire car il y a une clause qui prévoit que pour cette tâche on doit faire venir de Tahiti, un plein DC-6 de dockers. Je suis sidéré et lorsque le lendemain matin ces dockers arrivent le ciment est trempé.
Lorsqu’un organisme n’est pas limité dans ses dépenses, le gaspillage incontrôlé qui en résulte dépasse l’imagination. En effet le CEA est placé sous l’autorité directe de la Présidence du Conseil, ses finances ne faisant l’objet que d’un contrôle à posteriori par le Ministère des Finances et son budget n’est pas voté par nos parlementaires. Prenons un exemple : un illuminé envisage de faire un essai en haut d’une tour de 300 m. Je vois arriver sur nos quais un "sous-marin" en inox, qui était sans doute une chambre d’expériences ? Ensuite on débarque des tubes en inox d’environ 30 cm de diamètre. Assemblés, ils doivent former un tuyau de 300 m de long dans lequel on peut faire le vide. Je reçois l’ordre de rentrer tout cela dans nos hangars en sortant nos véhicules et nos matériels de piste. Avec les embruns salés qui aspergent régulièrement l’atoll, nos matériels subissent une corrosion incroyable. Certains d’entre eux deviennent de la dentelle de métal en moins d’un an. Nous avons la visite de l’administrateur général du CEA : André Giraud (futur ministre de la défense). Je lui dis que ces tubes sont en inox mais pas nos véhicules et qu’il vaudrait mieux les laisser dehors jusqu’à leur départ pour Mururoa. Il me regarde d’un air condescendant et m’ordonne de les rentrer. Depuis, l’illuminé a dû changer d’avis car cet essai n’a pas eu lieu et les tubes n’ont jamais servi. J’ai en mémoire tellement d’autres exemples et notamment pléthore de personnels. Avec un minimum de rigueur et de contrôle nous aurions certainement pu faire la même chose pour beaucoup moins cher.
J'étais arrivé seul sur le territoire, mais 3 mois plus tard, ma famille a pu me rejoindre également à bord d'un DC-8. Me rejoindre ? Enfin pas tout à fait. Elle a loué un "faré" sur les bords de la plage de sable noir de la pointe Vénus. En dehors des campagnes, je peux rejoindre Tahiti un week-end sur trois.
On a écourté mon séjour à Tahiti, car la campagne de tir annuelle va commencer et que l’on a besoin de moi à Hao.
L’organisation est très particulière. Sur l’atoll, il y a la base aérienne 185. Son commandant est le Col Chamouton, mais ce dernier est également commandant des éléments air en Polynésie. Il a donc un bureau à Papeete et n’est là en permanence que pendant l'été. C'est donc le second de la base qui en est en fait le vrai commandant. C’est le Col de Taxis du Pouet.
Il y réside en permanence sans pouvoir se rendre à Tahiti et de ce fait il n'y reste qu’une année. Les autres postes comme le mien sont de deux ans avec la famille à Papeete. En effet il n'y a pas de familles à Hao. Elles sont cependant autorisées à venir y séjourner quelques jours pour Noël et à la fin de l'été après la campagne de tirs.
Il y avait également sur l'atoll des détachements du génie et une compagnie de Légion étrangère. Il y avait aussi une flottille de la Marine et des marins de la division portuaire. Devant superviser les activités de tout ce monde, je n'ai jamais eu aucun problème avec le génie ou les légionnaires. Avec les marins c'était beaucoup plus délicat. Et pourtant l'aéroport étant unique il fallait bien coordonner l'activité aérienne. Lorsque je demandais à la Légion de protéger pendant la nuit les alentours d'un avion ayant un chargement particulier, je pouvais dormir sur mes 2 oreilles : personne ne s'approchait. J'avais cependant un petit problème avec eux. Lorsqu'ils faisaient une fête à laquelle j'étais invité, leur but était d’arriver à saouler l'aviateur. Et il était très difficile de leur résister sans les froisser.
Cette campagne dure 2 ou 3 mois, au milieu de l'été. Pendant sa durée nous n'avons aucun contact avec l'extérieur.
Contrairement à ce que croient certains, les militaires n'ont qu'un rôle de support des personnels du CEA. En fait, ce sont les personnels de la DAM (Direction des Applications Militaires). Nous sommes là uniquement pour les loger, les nourrir, les transporter et assurer la sécurité de ce qu’ils manipulent. Les installations du CEA sont loin de l'aéroport, de l'autre côté du village et nous n'y allons presque jamais. Ils ont leurs propres salles de mess et il y a très peu de contacts entre eux et les militaires. Ils ont leurs propres clubs sportifs (voile, plongée...). Ces clubs sont richement dotés et les nôtres, à côté, font pitié. En outre, en dehors des campagnes, ils retournent presque tous en métropole.
La campagne commence et comme ce n’est pas la première, tout est bien rodé. Il faut amener de France les "bidules". Avec une telle charge, il n'est pas question de survoler les États-Unis en prenant le chemin habituel via à Los Angeles. Nos DC-8 devront donc effectuer une très longue étape en reliant directement Pointe-à-Pitre à Hao. Comme ils n'ont pas encore de centrale à inertie, ils doivent effectuer une navigation astronomique. Ils doivent voir les étoiles et ils arrivent donc toujours au milieu de la nuit. Nous disposons d'une balise de 5 kW que leur radio compas peut commencer à capter à plus de 2.000 km de l'atoll. Nous avons également un radar d'approche et ils peuvent disposer du confort d'une finale ILS. Bien sûr, sur de telles étapes la charge utile est limitée. Surtout, sur le trajet retour, à cause des vents contraires, ce gros appareil ne peut emporter que 800 kg. Le courrier des personnels du CEA a priorité et j'ai beaucoup de mal à y joindre le courrier des militaires. Ensuite ce sont nos DC-6 qui emmènent les engins vers Mururoa car la piste de là-bas est trop courte pour les DC-8.
Il y a également des C-135 qui effectuent des reconnaissances météo vers l’est car dans ce vaste océan il n'y a aucune station qui pourrait nous renseigner.
Il est impératif de n'effectuer les tirs, qui sont aériens, que lorsque les vents sont favorables et n'entraîneront pas de retombées sur des zones habitées. Il n'y en a jamais eu. Il nous est arrivé d'être obligés d'attendre plusieurs semaines avant d'avoir le feu vert. La France a dépensé d'ailleurs pas mal d'argent pour construire sur quelques atolls des abris bétonnés capables d'accueillir toute la population en cas d'impondérables. Ces abris disposaient d'un arrosage automatique du toit. Ils n'ont jamais servi.
Quelques mois avant mon arrivée, nous avons malheureusement perdu un C-135 et son équipage. Ils ont eu un problème sur un ou plusieurs réacteurs lors d’un départ de nuit . Ils ont essayé de revenir se poser mais alors qu'ils avaient déjà parcouru toute la branche vent arrière, ils ont touché l'océan en essayant de revenir vers le début de piste. J'avais dans un de nos hangars environ 3 m3 de débris qui avaient été récupérés au large de la passe le lendemain.

Présenté au Gal Gauthier CEMAA, l'équipage du C-135 n°473 qui devait disparaître en mer le 30.6.72 : Cdt Brunet cdt l'escadron, Gal Gauthier, Cdt Dugué (pilote), Lt Frugier (copilote), Lt Parage (navigateur), Adc Hecq (ORV)
Lorsqu'ils décollaient de nuit, j'étais toujours à la tour de contrôle et je déclenchais mon chronomètre. Comme ils sont sous-motorisés, je les entendais peiner pendant presque une minute avant de pouvoir quitter le sol. Sur Mirage, cela prenait 16 secondes. Par la suite, comme il semble que cet accident était dû à la corrosion par les embruns marins qui recouvrent régulièrement l'atoll, on ne les a jamais laissés coucher à l'extérieur.
Les DC-8 devaient, lorsque l'attente se prolongeait, effectuer un petit vol d'entretien tous les 3 jours. J'en ai profité et j'ai découvert que cet appareil sans charge utile et avec très peu de pétrole se maniait comme un véritable chasseur.
Et puis nous avons reçu 2 Transall qui, via Hawaï, avaient amené chacun un Mirage III démonté.
J'ai eu un jour de l'été 73 un parking surchargé par des appareils de 12 types différents :
- Armée de l’air : DC-8, C-135, 2 Mirages III, 2 Transall, 1 Mystère 20, 4 DC-6, 2 Cessna 411, 10 Vautour, une Alouette 2.
- Marine : 2 Alouettes III, 4 Super Frelon, 6 P-2V7 Neptune.
J'ai également vu un Mirage III décoller avec une bombe atomique et revenir sans. Par mesure de sécurité, je l'ai fait décoller vent dans le dos à l'opposé du village... L’année suivante, ce fût un Jaguar et l’année précédente un Mirage IV.
Comme les armes explosaient en altitude, il fallait évacuer tout le personnel de Mururoa au moment des tirs. C’est une foule que nous voyions alors arriver à Hao par pont aérien ou par bateau.
Lorsque les conditions météo permettaient de savoir que l'essai aurait lieu le lendemain, nous étions envahis par des personnalités civiles et militaires qui nous gênaient dans notre travail. On avait planifié les décollages des Vautour à des heures précises après l'explosion. Lorsqu'ils étaient sur le chemin du retour il n'y avait plus aucune circulation autorisée entre le parking et l'extrémité de la piste. Les avions qui avaient traversé le nuage, ne faisaient pas demi-tour en bout de piste. Ils continuaient vers une zone bétonnée où on allait les abandonner pendant une quinzaine de jours avant de commencer à les nettoyer. Les équipages rejoignaient l'escadron en Alouette 2. Ils étaient contrôlés et éventuellement décontaminés. Ils avaient été irradiés pendant la traversée du nuage mais surtout par leur avion pendant toute la durée du vol retour. Des bouteilles d'air comprimé leur permettaient d'être en autonomie respiratoire pendant ce retour. Ils recevaient parfois une dose d'environ 5 rem. À l'époque on ne parlait pas encore de sievert mais cela correspond à 50 millisievert. Ceci est bien au-delà de ce qui est toléré annuellement pour les travailleurs exposés de l'industrie. Je n'ai pas eu d'informations depuis cette époque évoquant pour eux des problèmes particuliers de santé.
Et puis, le tir étant effectué, les personnalités présentes se pressaient de rentrer à Tahiti. C'était un vrai casse-tête de préséance pour déterminer celles qui auraient le privilège de repartir en Mystère 20. Les autres repartaient en DC-6. Un pont aérien ainsi que des bateaux ramenaient le personnel qui avait été évacué de Mururoa.
Pendant ces campagnes de 1973 et 74 je n'ai jamais pu voir le champignon. Nous étions trop loin pour que le bruit soit perceptible et je n'avais pas la possibilité d'être sur des bateaux qui observaient de loin le spectacle.
Autour du lieu de l’essai, à distance de sécurité de nombreux bateaux étrangers se tenaient légalement dans des eaux internationales. Il y avait des Américains, des Anglais, des Néo-Zélandais, des Australiens et même des Russes. Certains, comme nous, tiraient des missiles qui pouvaient traverser le nuage quelques minutes après l'explosion. Il fallait par la suite les récupérer en mer pour obtenir des renseignements précieux.
Il y avait bien sûr des empêcheurs de tourner en rond : ils naviguaient sur le bateau de "Greenpeace". Comme ils essayaient de s'approcher de Mururoa les jours de tir et que pour des raisons de sécurité il était hors de question de les laisser faire, nous avons eu, je ne sais plus si c'est au cours de la campagne 1973 ou de la campagne 1974 des incidents tragi-comiques. Les commandos marine prenaient le bateau en remorque pour l'amener à distance de sécurité. Les premières fois cette remorque était constituée par une corde mais ils la coupaient à coups de hache. Il a fallu alors modifier la nature de cette remorque et utiliser une grosse chaîne. Ils ont tiré un peu plus fort, peut-être un peu trop, et nous ont ramené le bateau.

Tous ses occupants ont été logés dans notre club nautique qui était très propre à leur arrivée mais qui est vite devenu un bouge. Ils vivaient chevelus presque nus et il y avait avec eux 2 femmes, nues aussi, dont l'une était enceinte. Les tahitiens du village d’Otepa qui passaient par là, ont eu pitié et ne comprenant pas la nature de leur nudité ils ont fait pour eux une collecte de vêtements. Au bout d'une quinzaine de jours ils ont été évacués sur Papeete à bord d'un DC-6. Il y avait à bord de cet avion un journaliste qui a vu lors du décollage de grandes auréoles au milieu du lagon. On lu dans la presse, suite à son témoignage, que nous avions pollué ce lagon. Cet ignorant n'avait pas compris qu'il s'agissait de pâtés de corail.
Il y avait également à bord de ce bateau le Gal de la Bollardière. Il avait dans un premier temps été ramené sur Mururoa, puis un DC-6 l’a transféré à Hao. Mais il refusait de descendre de cet avion. On a dû demander à des légionnaires de le descendre de force en le traînant comme un paquet. Comme j'étais au pied de l'échelle un des légionnaires s'est tourné vers moi et m'a dit textuellement
- « Mon colonel, un général ça c'est dégueulasse ».
Il a par la suite été logé dans un petit faré au toit de niaou (chaume local en branches de cocotiers) proche du mien. Il y avait bien sûr en permanence une sentinelle de la Légion devant sa porte. Au bout de quelques jours il a déclenché une infection urinaire. Notre gouvernement devait être terrorisé à l'idée qu'il puisse mourir sur place. On m'a demandé de le mettre dans un DC-8 sans aucune autre charge utile (même pas notre courrier). Il a été ainsi transféré au Val-de-Grâce.
Les Mirage ayant effectué leur mission, on allait les démonter pour les ramener en métropole. Plus rien ne risquait donc de compromettre la campagne. J'ai demandé timidement à effectuer un vol avant leur départ. Le Gal Fabry m’a regardé comme si j’avais sorti une incongruité et n'a pas daigné répondre.
Après le dernier tir de la campagne, l'atoll va s'endormir.
On rentre les Vautour dans des tentes climatisées avec de l’air sec (tentes anhydres). Elles sont à l'intérieur des hangars et ils sont stockés là jusqu'à l'été prochain à l’abri des embruns.
Il ne me reste plus pour voler pendant les mois d'hiver que le Cessna 411. Je peux faire des vols locaux à volonté mais pour des vols à longue distance selon les normes du COTAM il faut 2 pilotes à bord.
Nous avons sur l'atoll un hôpital militaire où, en plus du médecin généraliste, il y a un dentiste et un chirurgien. Nous assurons les soins des habitants de tous les atolls habités dans un rayon de près de 500 km plus les Gambiers. Ces habitants voient passer une ou deux fois par mois une goélette, appartenant à un Chinois, qui leur apporte le sucre, la farine, l'essence et les bouteilles de gaz. Elle repart après leur avoir acheté le coprah. Ces habitants pourraient donc rejoindre notre atoll ou Papeete pour se faire soigner. Mais ils attendent le dernier moment et préfèrent se faire transporter en évacuation sanitaire par un hélicoptère Super-Frelon ou Alouette 3 pour les plus proches. C'est rapide, confortable et surtout gratuit. Parfois je dois prendre une décision difficile lorsque la distance et le mauvais temps rendent cette mission dangereuse pour l'équipage. Je consulte bien sûr la météo mais je n’envoie jamais l'hélicoptère sans l'accord de son équipage.
Le site le plus éloigné de notre atoll, c'est l'archipel des Gambiers à l'extrémité de l'archipel des Tuamotous. C’est à 850 km dans le sud-est, presque 2 fois plus loin que Mururoa. Il y a une piste suffisante pour servir de déroutement à des Vautour. Un jour on me signale par radio qu'il faut ramener d'urgence une petite fille à Hao. Réglementairement je devrais attendre qu'un autre pilote arrive de Papeete pour effectuer cette mission. Cela pouvait faire perdre une dizaine d’heures. Connaissant parfaitement les possibilités de cet appareil, et étant habitué à voler seul, j'effectue la mission tout seul. Je ramène la petite fille dans notre hôpital. Mais en haut lieu, au COTAM, on n'a pas du tout apprécié.
Pendant le premier hiver je n'ai que le Cessna pour voler. Un jour, alors que l’un d’eux sortait de révision, je dois effectuer un vol d'essai. Par principe, je n'amène jamais de passagers pour un tel vol. Heureusement. Je dois comme prévu faire des essais de monomoteur. Lorsque je coupe le moteur droit et que je veux passer l'hélice en drapeau, elle passe plein petit pas et elle s'y bloque. Je suis obligé pour maintenir le cap d'exercer sur le palonnier des pressions dignes d'un P-51. Le moteur droit est un véritable frein et dès que je mets tant soit peu les gaz, il passe en sur-régime. Impossible également de mettre trop de puissance sur le moteur gauche à cause des efforts sur le palonnier. Je suis au-dessus du lagon et je perds de l'altitude. Je garde le train rentré jusqu'au dernier moment et en passant au ras du corail je finis par me poser presque à 45° de la piste. Ouf ! Ce type de panne hydraulique était connu sur cet appareil.
Je dispose également d'une Alouette II et de son pilote. Par négligence, lorsque j'étais au CEAM, j'ai un peu volé sur cet appareil mais je ne me suis pas fait lâcher. J'effectue de nombreux vols avec mon Adc pilote et je deviens capable d'utiliser seul la machine. Notamment j’arrive à réaliser un exercice très difficile qui consiste, en étant en vol stationnaire à 1 m du sol, à effectuer une lente rotation de 360° au-dessus d'un point fixe alors qu'il y a une quinzaine de noeuds de vent. Je sais également effectuer des décollages, des approches et des autorotations. Cela ne plaît également pas au COTAM et lors de la 2ème année ils font enlever le manche de gauche pour que je ne puisse pas continuer.
La campagne 1974 se termine et nous apprenons qu'il n'y aura plus de tirs aériens. La mission de Hao va complètement changer.
Les Vautour sont devenus inutiles puisqu'il n'y aura plus de nuages à traverser. Il y a 2 options : les ramener en métropole où ils sont en fin d'utilisation ou les détruire sur place. C'est la seconde qui est choisie sans doute pour des questions de coût. La même question se pose pour les Neptune.
Les N prenaient des photos mais ne traversaient pas le nuage. C'est pourquoi après avoir été stockés près de la passe (l’unique passe de l’atoll de Hao s’appelle la passe "Kaki"), ils ont été, sauf un, vendus à un ferrailleur japonais. J'ai encore un altimètre et plusieurs gueuses de plomb récupérés à la passe. On lui avait enlevé ses 4 canons de 30 mm et pour le centrage on avait mis 500 kg de gueuses de plomb.
Les B, dont les réacteurs ne sont pas décontaminables sont immergés par 3.000 m de fond entre Hao et Amanou. Tous caissons crevés à coup de pioche, je les ai vu depuis une Alouette II s'enfoncer en tournoyant dans les eaux bleues du pacifique. Ils étaient transportés, ainsi que les morceaux de P2-V7 Neptune, accrochés à une gabarre sur le quai puis largués au large.
Mon retour en métropole n'est prévu qu’au début de l'été 1975. Je n’ai plus d'avion à Hao puisque j'ai dû ramener le Cessna à Papeete. Au cours de ce dernier vol d'ailleurs j'ai été faire un tour sur Bora-Bora avant de revenir me poser à Faaa. Je vais effectuer un certain nombre de missions d'entraînement sur Nord 2501. Je ne serai pas lâché puisque sur un avion de transport cette notion n'existe pas. Je pourrais seulement acquérir la qualification de commandant de bord. Pendant l'hiver, je ferai quelques rotations sur Mururoa et je me poserai même à Fangataufa. Je pourrais également effectuer deux vols en copilote sur DC-6.
Au cours de mon séjour, je me suis posé plusieurs fois à Mururoa et j'ai pu constater que malgré les milliers de cocotiers qui avaient été couchés par les explosions, il restait toujours autant de mouches de moustiques. On se baignait sans problème dans le lagon en évitant seulement d'en déguster les coquillages.
Arrive le moment de quitter l'atoll. Je suis très ému, car au pied du DC-6 dans lequel je vais monter, il y a foule. Il y a bien sûr mes subordonnés mais il y a aussi le maire du village et un grand nombre de tahitiens et de vahinés. Comme c'est la coutume, chacun d’eux me passe un collier de coquillages autour du cou en me faisant une accolade. Il y en a tellement que l'on ne voit plus mes oreilles. Je ne savais pas que je reviendrais une quinzaine d’années plus tard.
Grâce au Col Leroy, je peux prolonger mon séjour d'un mois à Tahiti. Et c'est finalement en DC-8 que je rentre en métropole avec ma famille. J’y profite d'un congé de fin de séjour
Mirages au Zaïre
À la fin de ce congé, où aller ? Je suis sur le point d’être promu colonel car je figure sur le tableau d’avancement. Mais par un processus que j’ai déjà décris, ma nomination ne sera effective que fin décembre. La direction du personnel m’affecte dans une sous-section du 3e Bureau de l’EMAA.
Je suis affecté "3ème bureau-assistance technique en surnombre dans attente occuper poste chef mission militaire coopération au Zaïre". Le mot est lâché, j’irai au Zaïre.
Le président Mobutu venait de décider d'acheter 17 Mirage. Le président Kadhafi venait d'ailleurs d'en acheter 125 ainsi que des pièces de rechange pour plus d'un siècle. Des pilotes Libyens, et Zaïrois, ainsi que des mécaniciens de ces pays étaient entraînés sur la base de Dijon.
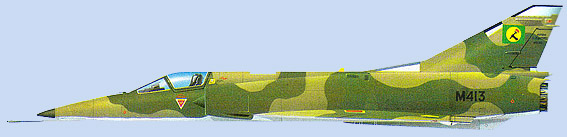
Mirage Zaïrois
Il y avait déjà à Kinshasa, à l'Ambassade de France, un Col de l'Armée de terre qui avait la fonction d'Attaché militaire et qui ne voyait pas d'un bon oeil arriver ce concurrent d'une autre arme. Il y avait aussi un Lcl pilote de l'Armée de l'air.
Le Zaïre, qui n'avait pas encore d'avions d'armes, avait confié sur place l'entraînement de début de ses pilotes à l'Italie. Ils utilisaient des Macchi MB-326. Il avait en outre envoyé en France des jeunes gens triés sur le volet qui devaient commencer à voler sur Fouga Magister. Ces derniers se sont par la suite mutinés : ils n'avaient pas été payés par leur ambassade. Et il s'est avéré que c'est au niveau de cette ambassade que leur argent avait été indûment retenu.
C'est dans ces circonstances que je suis envoyé au Zaïre avec deux autres pilotes. Muni d'un passeport diplomatique accordé par l'Ambassade parisienne du Zaïre, je vais donc passer une quinzaine de jours dans ce pays pour préparer l'installation de nos ressortissants. En effet, il était prévu que les Mirage seraient stationnés au Shaba sur la base de Kamina. Je devais choisir une centaine de mécaniciens de l'Armée de l'air qui seraient volontaires pour assurer sur cette base la maintenance des appareils. Comble de ridicule, nous sommes envoyés en civil : qui trompe qui ? Certainement pas les Américains qui avaient déjà un œil sur le Zaïre. Ce sont des décisions stupides prises par les jeunes énarques qui au Ministère de la défense dominent de tout leur orgueil des vieux généraux qui pourraient être leur père.
La base de Kamina, est située à une trentaine de kilomètres au nord-est de la ville de Kamina à un peu plus de 200 km au nord de Kolwesi. Elle avait toutes les caractéristiques d'une base de type NATO. Elle avait été abandonnée par l'armée belge en 1964. Il était prévu d'y regrouper les installations de maintenance des appareils ainsi que les moyens de subsistance du détachement français. Et tout le matériel de cuisine pour le mess, et celui de couchage était déjà stocké en France. Je me suis, par bonheur, opposé à leur transfert immédiat sur le site.
Nous arrivons donc à Kinshasa où nous sommes remarquablement bien accueillis à la fois à l'Ambassade de France et par le chef d'État-major de l'Armée de l'air zaïroise. Pendant quelques jours que nous passons dans un hôtel luxueux, nous découvrons cette capitale. Il y règne une extrême misère. Dans la principale avenue du centre-ville, bordée d'immeubles modernes, nous constatons que les étals des vitrines sont vides, totalement vides. Impossible de trouver fussent une brosse à dents ou un tube de dentifrice. Peu de voitures particulières. Mais dans la cour de la présidence il y avait des dizaines de luxueuses Mercedes. Nous étions promenés dans l'une d'elles avec la climatisation poussée à fond et nous nous gelions sur les sièges arrière alors qu'à l'extérieur il régnait une atmosphère insupportable de hammam.
Nous sommes conviés à des visites et notamment à celle d'une aciérie située au bord du fleuve Zaïre à une cinquantaine de kilomètres au nord de Kinshasa.
Au cours des voyages d'études que j'avais effectués dans le cadre de l’ESGA, j'avais visité des aciéries à Dunkerque et au Japon. Dans l'autocar qui nous amenait à cette visite, je constatais, avec surprise, que arrivé à une dizaine de kilomètres au sud du site, je ne voyais à l'horizon aucune fumée. Normalement pour faire de l'acier, il faut disposer de charbon et de minerai en grande quantité, et c'est pourquoi presque toutes les aciéries modernes sont situées près d'un port. Ici rien de tel à part la source d'énergie presque inépuisable que constitue le puissant fleuve Zaïre (ex-Congo). Nous traversons de grandes cités ouvrières presque désertes et nous arrivons sur le site.
On nous explique alors, que l'acier est obtenu à partir de fours électriques avec des métaux de récupération. La construction de l'ensemble avait été confiée à des sociétés italiennes. Nous continuons la visite en passant des fours aux longues chaînes de laminoirs. Tout est silencieux, rien ne tourne. À l'extrémité des laminoirs des rouleaux de tôles entreposés. Il semble que les Italiens, après avoir fondu quelques vieilles voitures et sorti quelques kilomètres de tôle se sont faits payer et sont partis. En tout cas ce jour-là tout est arrêté.
Nous sommes souvent à l'Ambassade de France et nous constatons que la préoccupation principale des personnels, consiste à commander hors taxes des objets sur les catalogues de la "Redoute" et de feu la "Manufacture d'armes de Saint-Étienne". Ils nous avaient demandé de leur ramener des objets de première nécessité et notamment des brosses à dent et des fromages.
Nous sommes également reçus à l'État-major de l'Armée de l'air dont le général et le chef d'état-major nous accueillent amicalement. Je me souviens d'une phrase de ce dernier, alors que nous étions attablés à une terrasse et qu'il dégustait une énorme chope de bière. Il me déclarait :
- « Nous avons rejeté tout ce qu‘avaient voulu nous laisser les Belges ».
D'ailleurs ils parlaient tous français et refusaient de prononcer le moindre mot de flamand. Près de quarante ans se sont écoulés depuis ces événements et je ne voudrais pas massacrer le nom du général. Je l'appellerai par la suite le général X.
Il fallait bien en arriver à l'essentiel de notre mission qui consistait à aller apprécier l'état de la base de Kamina. Dans ce grand pays, presque coupé en deux par une zone de forêt tropicale peu habitée et sans voies de communication, l'avion est le moyen de transport obligatoire. Kamina est à environ 1.300 km de la capitale et c'est avec le Mystère 20 personnel du Président que nous nous y rendons. En dehors du Gal X et de son chef d'État-major, nous constatons parmi les passagers la présence d'une personnalité américaine.
Dès l'atterrissage et le retour au parking, nous sommes accueillis par les traditionnels groupes folkloriques. Je suis étonné de voir que le Gal X récompense les danseuses en leur glissant un petit billet dans le soutien-gorge. Nous passons au déjeuner sur la base et chemin faisant, j'ai eu la possibilité de constater que le plein du Mystère 20 était en train de se faire à partir de fûts de 200 litres et d’une pompe à main. Nous passons ensuite à la visite des installations :
- Nous visitons les hangars laissés par les belges 12 ans plus tôt et dans lesquels on devait installer les matériels techniques destinés à la maintenance deuxième échelon des futurs Mirage. On aurait besoin pour cela d'installations électriques en bon état, de prises d'air comprimé etc. hélas, les hangars avaient été pillés il n'y avait plus ni prise de courant ni robinets, ni rien.
- On m'affirme que la soute à carburant ainsi que les pompes sont en bon état. Pourtant j'avais aperçu que l'on faisait le plein du Mystère 20 avec des pompes à main.
- Enfin je demande à voir l'état de la piste. Et là, horreur : elle est couverte de gravillons issus d'un revêtement en très mauvais état. Je fais part de mon étonnement au Gal X et je lui dis qu'il est impossible de faire décoller un Mirage d’une telle piste : le réacteur risque d'avaler des gravillons et d'exploser. Il me répond calmement :
- « Le revêtement de cette piste sera complètement refait dans 15 jours ».
Je recule un peu à l'intérieur du groupe de visiteurs et j'aborde l'ingénieur italien chargé des travaux publics. Il me dit que ces travaux ne seront pas réalisés car le cargo qui contient le bitume destiné à cette réfection est immobilisé dans le port d'Anvers car ils n'ont pas payé la facture.
Je rentre donc à Paris tout en étant destiné à passer deux ans à Kinshasa. J'avais déjà ma villa réservée là-bas et m'occupais des formalités pour y faire venir ma famille et ma voiture.
Mais lorsque je rends compte en haut lieu des constatations effectuées sur place, on a décidé au niveau de l'État-major, et sans doute du constructeur Dassault, que je n'étais pas suffisamment coopératif. Je reste au sein de l'État-major de l'Armée de l'air pour suivre le début de l'opération tandis que, dans mon dos, on désigne un autre colonel à l'échine plus souple qui lui restera deux ans là-bas et y gagnera ses deux étoiles. Mon passeport diplomatique n’aura servi qu’une fois.
Avant d'apprendre cette décision, il est impératif que, vis-à-vis des Zaïrois, je sois un pilote de Mirage. Je vais dans ce but m’entraîner à Dijon et j'effectue en décembre puis en avril 1976 une quinzaine de vols sur Mirage III B. J'y rencontre un pilote zaïrois et quelques pilotes libyens. Comme la météo est souvent exécrable et que nous faisons des approches qui nécessitent vraiment le GCA, je me rends compte que les Libyens n'aiment pas du tout voler par mauvais temps. Je n'ai plus la fougue de la jeunesse et ils finissent quand même par me laisser faire un vol solo le 16 avril.
Les 17 Mirage étaient en préparation chez Dassault et le Président Mobutu les voulait à une date bien précise (peut-être son anniversaire). Comme ils n'étaient pas prêts à cette date, le constructeur a obtenu que l'Armée de l'air lui prête 17 Mirage quitte a faire l'échange par la suite. Ce sont donc 17 Mirage français peints aux cocardes zaïroises chez Dassault qui ont fait le voyage avec des pilotes français. Et au jour choisi, ils ont pu défiler sur Kinshasa.
Bien sûr, je ne suivais cela que depuis Paris, mais j'ai pu obtenir une coupure de journal que je ne peux m'empêcher de mentionner. Le Président Mobutu s'est fait photographier dans le cockpit d'un Mirage et la presse qui affichait la photo en première page le lendemain typographiait en lettres de plusieurs centimètres de haut sa déclaration :
- « Nous sommes le premier peuple d'Afrique noire à être supersonique »
Quelques semaines plus tard l'échange avec les vrais Mirage zaïrois s'est fait progressivement au fur et à mesure de leur sortie d'usine. Lorsque les nôtres sont rentrés en France il a bien fallu remplacer leurs cocardes par des cocardes françaises. J'ai demandé que le constructeur qui était à l'origine de cette mascarade procède à cette substitution. Il a refusé et ce sont des mécaniciens de l'Armée de l'air qui ont repeint les cocardes françaises.
Un autre détail mérite d'être mentionné : la commande des avions était accompagnée par une commande importante de pièces de rechange. Ces dernières ont été livrées sur l'aéroport de Kinshasa en une montagne de caisses. Pour les exploiter et les ranger il fallait avoir formé des techniciens capables de suivre par une gestion informatique le classement et la délivrance de ces pièces. Le Zaïre a envoyé en Belgique deux capitaines qui devaient être formés à cette gestion. Ils s'y sont trouvés tellement bien, qu'ils y ont pris épouses et qu'ils ne sont jamais rentrés au Zaïre.
Étant nommé à un autre poste, je n'ai pas pu suivre la fin de cette aventure mais je sais que les Mirage n'ont pas rejoint Kamina et sont restés sur l'aéroport civil international de Kinshasa. Leur carcasse s'y trouve peut-être encore ?
Enfin un autre fait mérite d'être porté à la connaissance de nos concitoyens : vu l'état de misère et de faillite de l'État zaïrois, je suis presque sûr que cet achat a été financé par la COFACE (COmpagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur) et donc par le contribuable français.
C’est la "France Afrique !".
Les dernières années (dans l’Armée de l’Air)
À la fin de mon congé d'été, j'apprends par un colonel de la DPMAA (Direction du Personnel Militaire de l’Armée de l’Air) que je suis affecté en tant que sous-chef logistique à la 3ème région aérienne à Bordeaux. Je sais pertinemment que je vais terminer ma carrière comme colonel dans 5 ans lorsque je serai atteint par la limite d'âge du personnel navigant qui est de 52 ans. J'ai l'intention de me retirer dans le sud-est à Saint-Raphaël et cette affectation à Bordeaux ne me plaît pas du tout. Je lui dis que je veux voir le général directeur. Il me répond que ce dernier est en congé et ne rentrera pas avant un mois. Je lui réponds : « j'attendrai ».
J'attends pendant un mois puis je vais voir le général Grenet que j'avais connu à Mont-de- Marsan. Je lui explique les raisons de ma réticence concernant cette affectation à Bordeaux et je lui demande si il est possible de me laisser terminer ma carrière à la 4ème région aérienne à Aix-en-Provence. Il m'écoute et me dit :
- « Ce n'est pas possible tout de suite. Rejoins Bordeaux et je te promets que dans un an tu seras affecté à Aix ».
Il a tenu parole.
Pendant cette année à Bordeaux je me fais à nouveau lâcher sur Broussard et je continue à voler sur MS Paris.
Début juillet 1977 je rejoins la 4ème région à Aix-les-Milles. J'y occuperai le poste de CRTAA (Commandement Régional des Transmissions de l’Armée de l’Air). Ce poste correspond mieux à mes compétences.
J'y resterai jusqu'à mon départ à la retraite début de l'été 1981.
Pendant ces 4 ans je continue à voler très souvent sur Broussard et sur MS Paris. Je suis suffisamment confirmé sur Broussard et je suis qualifié pour le largage de parachutistes. En effet après le largage de ces derniers il y a une telle différence de centrage, que l'atterrissage est délicat. Après leur largage, je pique moteur réduit pour aller chercher les suivants. Et là, il y a intérêt à ne pas oublier de fermer complètement les volets de capot si l'on ne veut pas avoir de la condensation dans les cylindres.

Une autre mission me plaît énormément, celle d'aller récompenser les élèves méritants de l'école des pupilles de l'air de Grenoble. Le mercredi matin je vais me poser sur le petit aérodrome du Versoud au milieu de la vallée du Grésivaudan. J'y vais directement sans passer par la vallée du Rhône. Et si une petite couche de stratus masque la vallée, je descends à vue tellement le paysage m’est familier. En gardant à égale distance le massif de Belledonne et celui de la Chartreuse, je suis sûr de mon coup. Il y a sur le parking, 6 élèves qui m'attendent. Je les promène pendant un peu plus d’une demi-heure dans cette belle région en survolant les massifs.
Lorsqu'il y a eu un accident de Broussard sur le terrain d’Ambérieu, le général Labansat m'a désigné comme président de la commission d'enquête. J'ai rejoint ce terrain en vol à vue à basse altitude avec un MS Paris. J'étais secondé par un officier mécanicien et par un médecin. Au bout de 3 jours, il a fallu se rendre à l'évidence : il y n’avait eu aucune défaillance technique dans cet appareil qui a décroché 43 secondes après son décollage. Seule l'ébriété du pilote a été la cause de ces 6 victimes et de 21 orphelins.
En décembre 1977, je décolle en MS Paris pour rejoindre Satolas. C'était à la nuit tombante, nous étions dans la couche par très mauvais temps. Et soudain plus d'indications de vitesse : le "badin" (tube pitot) venait de givrer. J'étais en place gauche, l'adjudant-chef Meier à ma droite m’a regardé et j'ai fait ce qu'il fallait faire de toute urgence : ne rien faire ! L'horizon artificiel fonctionne et si on garde l'attitude de l'appareil ainsi que la puissance des moteurs il ne peut rien se passer. Mais j'avoue que c'est une situation fort désagréable. Et puis nous avons amorcé la descente toujours avec l'horizon artificiel. À basse altitude le badin s'est remis à fonctionner et nous nous sommes posés de nuit à Satolas. Nous avons redécollé de nuit et la météo ne nous a pas permis de rejoindre Aix-les-Milles. Nous avons été déroutés sur Marignane. Quand j'écris ces lignes, je repense à l'accident du Rio-Paris : il fallait ne rien faire et surtout ne pas persister à garder le joystick à fond en arrière.
Pour un des derniers vols avant mon départ en retraite, un autre Broussard de l’escadrille de liaison m’a photographié survolant la Sainte-Victoire. Ils m’ont offert ce poster lors de mon pot de départ. J’ai photographié le poster pour insérer ici cette image.

J'ai la possibilité, étant en activité, d'effectuer un stage "d'initiation aux affaires" à l'école supérieure de commerce de Marseille. J'en profite et c'est ce qui explique mon départ au début de l'été alors que je suis né fin novembre.
Je passe 6 mois très intéressants à l'école supérieure de commerce de Marseille. Il y a de très bons intervenants. Je passe de nombreuses soirées au centre informatique où je commence à me familiariser avec le Basic (ceci bien sûr en dehors des heures de cours).
Au printemps 1982, je suis mis en congé du personnel navigant et je dois prendre une décision importante. J'ai terminé ma maison de Saint-Raphaël mais pendant encore une dizaine d'années, je devrais payer des traites à la banque. Ma retraite ne me permet pas de faire face. Si j'accepte l'un des emplois que l'on m'a laissé envisager pendant mon stage, je devrais payer plus d'impôts sur le revenu. Ce n'est donc pas la solution.
Je décide donc de retourner vivre en Polynésie ou les avantages sont les suivants : retraite multipliée par 1,8 et pas d’IRPP (impôt sur le revenu des personnes physiques). Ce que j'aurais dû donner au percepteur en restant en métropole, je vais pouvoir le donner à ma banque. C'est pour la dernière fois, un DC-8 du COTAM qui me ramène à Faaa.
Étant toujours aussi fanatique de plongée sous-marine, je franchis toutes les étapes du monitorat et je termine par un brevet d’état d'éducateur sportif 2ème degré : spécialité plongée sous-marine. La partie spécifique ne peut être obtenue sur place et je dois revenir en métropole pour la passer au fort carré d’Antibes.
Parmi les moniteurs, il y a ceux qui ont un club et qui ne peuvent le quitter. Il y a ceux qui sont fonctionnaires et qui ne peuvent s’absenter n’importe quand. Quand un groupe de touristes fortunés loue un grand voilier pour aller plonger dans les îles, on vient me chercher car je suis le seul disponible. Je n’ai pas besoin de faire de pub. Bien sûr, je prends une patente mais elle ne coûte en francs pacifiques que l’équivalent de quelques dizaines d’euros. À bord je suis nourri et logé et je ne m’occupe que de la plongée.
Alors que je n’aime pas faire de la voile en Méditerranée car sur cette mer, soit il n'y a pas de vent, soit il y en a beaucoup trop et les changements sont imprévisibles et rapides. Là-bas il y a l’alizé force 2 et l'on peut parcourir des centaines de kilomètres sans toucher au réglage des voiles. En dehors bien sûr des quelques jours ou une tempête tropicale frappe l'archipel. Il faut quand même prendre garde lors de la navigation qui se fait à l'estime de ne pas s'approcher de nuit d'un atoll. Les déferlantes sur le récif sont dangereuses et nous n'avons pas encore de GPS.
Je fréquente, en travaillant bénévolement, le club de Henri Pouliken qui fut un moniteur de sport sur la base de Hao.
En 1990, je suis revenu en Caravelle sur Hao en tant que moniteur de plongée invité par Henri Pouliken (à gauche sur la photo) et le club de plongée de la base. Il restait environ 300 militaires sur la base alors qu'à l'époque des tirs il y en avait plus de 3.000 (CEA compris). La plupart des bâtiments étaient vides et les hangars étaient à l'abandon. Mon ancien bureau sous la tour de contrôle était délabré. Mais devant le bâtiment de l'escale, on avait conservé un Vautour. Ce Vautour est complètement pourri. C'est la peinture qui le tient. Il est sans réacteurs.

Henri Pouliken et Maurice Cavat (Coll. M. Cavat)
Je l'avais piloté 17 ans plus tôt lorsque j’étais chef des Moyens opérationnels de la base de Hao (en regardant Hao sur Google Earth en février 2010, je ne vois plus le Vautour devant l’escale).
En 1992, j'ai plus de 60 ans et je continue stupidement à effectuer des plongées profondes. Bien sûr avec les clients ou les touristes nous nous limitons à une trentaine de mètres. Je les emmène souvent sur l’atoll de Rangiroa. À la sortie d’une des passes, nous pouvons filmer des nuages de requins. Mais avec d'autres moniteurs qui sont tous des jeunes de moins de 25 ans nous effectuons des descentes téméraires à plus de 100 m. Nous appelons cela des plongées à 3 chiffres. Je n'ai pas abordé ce domaine d'un seul coup et à partir de 80 m je progressais de 10 m par an. J'ai fini par faire de nombreuses plongées à 120 m. Et j'en ai même essayé 2 à 130 m.
Tout cela se faisait avec de l'air car nous ne disposions pas des moyens techniques de la Comex pour plonger au mélange. Nous ne disposions pas non plus de tables de plongée, car les tables officielles s'arrêtent à 60 m. J'avais à ma disposition le modèle physiologique d’un professeur suisse et je l'ai utilisé pour calculer, à l'aide d'un micro-ordinateur, les tables confidentielles que nous suivions.
Nous descendions à environ 30 m par minute et le séjour profond était seulement de 4 min puis il y avait environ 3/4 d'heure de palier. Il faut bien sûr utiliser un phare pour recréer les couleurs qui n'existent plus à ces profondeurs. Il serait prétentieux de dire que nous échappions au syndrome "de l'ivresse des profondeurs". Avec de l'entraînement nous arrivions à faire avec.
On ne se voit pas vieillir, surtout quand on vit avec des jeunes. Je commençais à avoir de l'arthrose et un jour je fais un grave accident de décompression alors que le jeune moniteur qui m'accompagnait et qui avait fait les mêmes paliers n'a rien eu. Les symptômes ne se sont manifestés que quelques minutes après la sortie de l'eau. J'ai eu beau me mettre de suite sous oxygène, prendre de l'aspirine et boire beaucoup, c'était trop grave et j'ai dû passer une trentaine d'heures dans un caisson de recompression. Puis je suis resté une quinzaine de jours dans un service de réanimation à l'hôpital militaire. Dans mon malheur, seuls les nerfs sensitifs ont été détruits mais j'ai frôlé le fauteuil roulant.
Après avoir réappris à marcher, je savais que je serais paresthésié à vie. Je continuais à aller sur le bateau des amis mais je me contentais de barboter en surface en les regardant s'enfoncer.
Alors j'ai pris ma décision et j'ai fait comme Ulysse.
À l'issue d'un long voyage je suis revenu, plein d'usage et raison ??, vivre à Saint-Raphaël le reste de mon âge.
Maurice CAVAT
Novembre 2013
(1) J'ai bien connu Pichoff, avec lequel j'ai effectué ma transformation "Chasse" à Cazaux début 1949. À l'issue du stage, nous avons été affectés tous les deux au GC 2/6 "Normandie-Niemen", qui se préparait à partir pour l'Indochine.
À la page "Bain forcé en Mer de Chine" de ce site, j'ai raconté comment Pichoff s'était "ditché" avec son Hellcat au large de la zone viet suite à une panne moteur.
Après l'Indochine, nous avons été affectés dans des unités différentes et nous nous sommes perdus de vue. Toutefois, j'ai su que, lors de la Campagne de Suez sur F-84F, il avait descendu un Meteor NF XIV égyptien le 1er novembre 1956 au-dessus d'Abu Suer.
J'ai renoué avec lui quelques années avant sa disparition, le 19 novembre 2009, alors qu'il s'était retiré dans la région toulousaine où il possédait une librairie.
Ce n'était donc pas le Cne Pichoff qui s'est tué ce jour-là, mais qui ?
C'est peut-être mon ami André Debièvre qui répond à la question :
- « J’étais à Lahr à cette époque, à l’ER 2/33. De la tour de contrôle, où j’assurai une ‘’permanence pilote’’, j’ai assisté à cet accident de F-84F au décollage : grosse fumée blanche s’échappant tout à coup de la tuyère vers 300 ou 400 pieds puis décrochage brutal et crash dans le bois au-delà de la piste. Je crois me souvenir qu’il s’agissait du Cne Tvrdi, dont l’épouse et les enfants, m’a dit plus tard le Colonel Cardot cdt la base, étaient sur le parking de la base au moment de cet accident.»
NOTA : Le Cne Raymond Tvrdy est né le 14 juin 1925 et a fait partie de la Promotion 1946 Antoine de Saint-Exupery de l'École de l'air. Il est "Mort pour la France" le 18 février 1961 (Référence : Bulletin des anciens élèves de l'École de l'air).
Jean HOUBEN
Date de dernière mise à jour : 06/06/2020
Commentaires
-

- 1. Offres de crédits selon votre demande allons de 2000 à 14 000 000 euros , c'est à vous de définir la durée de paiement du prêt en fonction du montant demandé. Prêts personnels dont le taux annuel effectif global (TAEG) est égal 2% pour tous les montants Le 08/02/2026
carret-yvette@outlook.fr -

- 2. Offres de crédits selon votre demande allons de 2000 à 14 000 000 euros , c'est à vous de définir la durée de paiement du prêt en fonction du montant demandé. Prêts personnels dont le taux annuel effectif global (TAEG) est égal 2% pour tous les montants Le 08/02/2026
carret-yvette@outlook.fr -

- 3. Pierre-Charles FOULON Le 15/12/2022
Bonjour
Quel beau récit, très triste d'apprendre le décès de ce pilote. Pour revenir sur le convoyage des Mirage III vers Israël en 62, je suis quasiment sûr que le troisième pilote français n'est autre que mon père le général Pierre Foulon (alors capitaine et officier de marque sur Mirage III C et B à Mont-de-Marsan), hélas décédé lui aussi en 2019. Il nous avait raconté cette histoire bien des années plus tard lorsqu'il n'y avait plus prescription. J'ai pensé fortement à mon père en lisant ces lignes car lui aussi avait été formé aux USA classe 52C (Perrin AFB au Texas sur T6, puis lui aussi à Craig AFB sur Mustang).
Amitiés
P.C Foulon -

- 4. Karlen Le 11/05/2021
Bonjour,
Je viens de terminer la lecture de cette vie passionnante et trépidante de Maurice Cavat. Je suis encore sous le charme de ses propos et de ses témoignages, quelle vie magnifie et si bien remplie.
Artiste peintre autodidacte et spécialisé en aviation, je travaille depuis quelque semaine sur une peinture représentant une vue générale de l'atoll de Hao, (dont la BA 185), survolé par au premier plan un Mirage IVA et au second plan un C-135F. À savoir l'opération Tamouré !
À ce stade il me manque quelques infos photos sur le Mirage IVA qui a largué la bombe (et qui avait remplacé le n° 36 qui s'était malheureusement crashé). Il me manque également des infos sur la base BA 185 elle même. J'ai de nombreuse photos, mais vu que cette base n'a cessé de se développer, je serai intéressé de savoir à quel stade d'évolution elle se trouvait en juillet 1966 (particulièrement du côté portuaire derrière les deux grands hangars situés en face de la tour de contrôle).
Si quelqu'un a des infos sur ces deux sujets ce serait vraiment formidable !
Merci pour ce site passionnant qui regorge de trésors, et merci surtout aux auteurs d'avoir partagé leurs expériences et leurs souvenirs personnels.
Avec mes meilleurs messages
Claude Karlen -

- 5. Sébastien Le 23/02/2021
Bonjour messieurs, malheureusement pour vous je viens de vérifier sur Internet, ce brave Monsieur Maurice Cavat, dont je viens de finir de lire ce passionnant récit, est indiqué décédé le 2 février 2019, après une vie visiblement bien remplie, et admirable de rebondissements. Paix à son âme... -

- 6. Olivier Premmereur Le 10/01/2021
Bonjour, je suis à la recherche d’un oncle du nom de ROUSSELOT (peut-être Michel) qui était basé à Salon-de-Provence et qui se serait écrasé dans les Rocheuses en 1954. Je ne trouve rien sur le Net...
Merci de votre aide -

- 7. Urbain Le 03/11/2020
Bonjour, très touché par votre témoignage je souhaiterais acheter votre livre, comment faire ? Merci. Yvon Urbain (ancien d'Algérie )
Ajouter un commentaire


