Convoyage aventureux d'un Jodel de France à Djibouti
Avril 1964
Il existait un aéro-club à Djibouti et ses responsables achetèrent un Jodel D-112, quadriplace équipé d’un moteur Potez de 100 CV, dont ils me demandèrent d’assurer le convoyage depuis l’usine de Bernay en Normandie jusqu’à notre Côte Française des Somalis. C’était un beau voyage, quelque peu aventureux et le docteur Delanoë, membre de l’aéro-club, se proposa pour m’accompagner. J’aurai ainsi un médecin à bord !

Jodel D-112
Avant que je quitte Djibouti, je suis convoqué chez un Cdt des services de transmission. Il est le représentant local du SDECE (Service de Documentation et de Contre-Espionnage), appelé aujourd’hui DGSE, et me demande une mission particulière. Depuis la guerre du canal de Suez en 1956, nous sommes fâchés avec les Égyptiens et en pleine guerre froide. Bien renseigné par je ne sais qui de mon programme, il m’apprend que durant le bref séjour que j’allais faire au Caire, la flotte soviétique doit stationner à Alexandrie. À cette époque, il n’existait pas de satellites espions et "ON" souhaitait que je survole le port d’Alexandrie pour y photographier tous les bateaux russes présents.
J’accepte, bien entendu, et un Boeing 707 d’Air France m’amène à Paris. Une bonne partie de la nuit de vol se passe au cockpit à discuter avec les pilotes, qui m’accueillent chaleureusement en apprenant que j’ai déjà le brevet de pilote de ligne et que j’attends le premier stage de recrutement. Je ne soupçonne pas que trois ans plus tard, je serai copilote sur ce type d’avion.
J’arrive à Bernay en Normandie où l’avion était construit et il y avait une dizaine d’heures de rodage à faire, que je consacre à des balades en France, qui me permettent de le prendre bien en main, y compris la mécanique du moteur.
Cet avion avait une autonomie de 4 h, que je fais doubler en faisant installer un réservoir de 50 litres d’essence sur le siège arrière, qui me sera indispensable pour certaines étapes. Ce réservoir est fait d’une nourrice de caoutchouc dans une claie de bois, qui débitait par gravité son contenu dans le réservoir principal.

Le parking de Bernay
Il n’était équipé que d’un poste radio à 4 fréquences fixes et c’était bien maigre. Pas d’horizon artificiel, seulement une bille et une aiguille donnant le taux de virage. C’était un avion destiné au vol local à Djibouti où il fait notoirement beau. Pour me diriger, je ne dispose que d’un sommaire compas boule, qui me donne un cap instable avec une maigre précision. Au sol, je fais toutefois vérifier que la rose des vents me donne des indications correctes, correspondant aux diverses directions dans lesquelles je fais orienter le nez de l’avion.
Quittant l’usine, je devais passer par Nice pour y dédouaner l’avion et récupérer mon équipier Delanoë. La météo n’était pas fameuse et je décide de contourner le Massif Central par l’ouest, mais le plafond est encore plus bas que prévu. Je vole très bas et quand cela m’amène à être plus bas que les éventuelles lignes à haute tension et les clochers, je n’ai pas d’autre choix que de monter dans les nuages où je subis d’intenses turbulences.
Mon seul instrument de vol sans visibilité est l’aiguille de mon indicateur de virage, qui s’incline d’autant plus que le taux de virage est important. Cela m’indique que je suis en virage, mais ne donne aucune indication sur l’inclinaison des ailes. Il m’aurait fallu pour cela un horizon artificiel et je n’en ai point. La turbulence fait faire un mouvement d’essuie-glace à mon aiguille et c’est une situation très critique où le crash n’est pas loin par perte de contrôle. Très scabreux ! Tous mes sens en alerte, je m’applique à maintenir une altitude, un cap à peu près fixe avec mon compas boule frétillant dans la turbulence. Je m’efforce de maintenir mon aiguille au milieu, ce qui m’assure que je ne m’engage pas dans un virage en piqué mortel vers le sol.

Tableau de bord du Jodel D-112
Bien des années plus tard, j’ai pu regarder un documentaire sur l’odyssée de Charles Lindbergh, quand il traversa l’Atlantique en 1927. Je fus surpris de constater que pour affronter les éléments très perturbés sur l’Atlantique, il disposait d’instruments identiques à ceux qui se trouvaient dans mon Jodel, c’est-à-dire : un compas, une bille, indiquant si le vol était symétrique et un indicateur de virage, dont l’aiguille s’inclinait si l’avion virait, mais sans indiquer l’inclinaison des ailes (ce n’était pas un horizon artificiel).

Poste de pilotage du « Spirit of St Louis » de Lindbergh
Qu’on s’appelle Charles Lindbergh ou Christian Roger, quand on se trouve dans des nuages turbulents avec une telle instrumentation, je peux vous dire qu’on se sent extrêmement vulnérable et en grand danger. Quand je pense qu’il a vécu de nombreux passages scabreux comme celui que j’étais en train d’essayer de surmonter, je tire un chapeau bien bas à ce précurseur d’avoir réussi à garder des qualités de perception aussi opérationnelles durant les 33 h de son vol.
Pour ce qui concerne mon vol, je suis dans une situation aussi critique que celle de Lindbergh et le danger d’aller au tapis est bien grand. Je suis à 2.000 pieds avec une vague position estimée et que faire ? Je ne veux pas monter plus haut, parce que la couche est certainement très élevée et que je risque de givrer mes ailes, qui ne sont pas protégées.
Dans ces nuages, je ne dispose que d’un dégivrage du Badin (indicateur de vitesse) et du carburateur. Un instant m’effleure l’idée d’aller percer loin en mer et de revenir au ras des vagues vers la côte, mais tenant compte de la relative proximité du terrain de Tours où j’avais passé deux ans comme instructeur, je contacte le contrôle d’approche de la base aérienne et lui expose ma situation. C’est un dimanche, le ciel est vide et le contrôleur radar de permanence n’a pas d’autre avion dans le secteur.
En fouillant sur son radar, il finit par trouver un faible plot, car seul le moteur est métallique sur mon avion et fait écho sur le scope de son radar. Il confirme l’identification en me faisant faire un virage à gauche et me guide vers le terrain pour une percée GCA (Ground Control Approach : guidage radar par le contrôleur en direction et descente).
Je l’informe que je suis en panneau partiel d’instruments, sans horizon artificiel et demande des corrections de caps de faible amplitude, ce qu’il réussit magistralement. Je m’applique à suivre ses instructions avec mon compas boule si sommaire. Dans ces moments de stress très intense, je recueille les fruits du remarquable entraînement que nous avons eu à Salon et Meknès en pratiquant avec assiduité des vols en panneau partiel.
C’était une gageure d’effectuer une arrivée GCA par très mauvais temps avec pour seuls instruments l’indicateur de virage, la bille et un compas boule instable, le tout dans une forte turbulence. Pour réussir la percée vers la piste, il faut suivre des variations de cap de faible amplitude que m’indique le contrôleur radar et assurer avec mon variomètre le taux de descente qu’il me demande, sans l’aide d’un horizon artificiel.
Je déploie tout mon savoir-faire de pilote. Sans mon expérience bien acquise et en réussissant à garder mon sang-froid, mon voyage se serait terminé en percutant le sol. J’ai aussi la chance d’avoir un contrôleur radar chevronné. Il me guide de façon très professionnelle par de petites corrections de cap et de taux de descente et réussit à m’amener en vue de la piste bien illuminée avec un plafond de 250 pieds (75 m).
Je suis trempé de sueur et n’ai plus un poil de sec quand mes roues touchent la piste et vais me garer près de la Tour pour aller remercier mon sauveur. Il m’offre un café qu’il avait dans un thermos et j’attends deux heures, indécis, puis le ciel s’éclaircit et je repars, la MTO prévoyant une amélioration.
Je passe laborieusement au large de Toulouse, mais le plafond retombe dans cette fin d’après-midi et je ne peux franchir le seuil de Naurouze, qui marque le partage des eaux entre l’Atlantique et la Méditerranée. Ce seuil de Naurouze est à une altitude de 186 m et cela donne une idée du plafond de ce jour ! J’ai assez tenté le diable pour cette journée et je fais donc demi-tour pour aller me poser à Toulouse pour y passer la nuit.
Le lendemain, il fait beau et je rallie Nice sans encombre pour dédouaner mon aéronef et je repars avec Delanoë vers Ajaccio. Nous n’avons pas de canot de sauvetage, seulement des Mae West et nous en remettons à notre excellent moteur Potez.
Pour limiter le risque, je monte à 15.000 pieds pour franchir la mer. En cas de panne, cela nous donne du plané et la possibilité d’atteindre peut-être la côte ou la proximité d’un bateau.
Il fait beau maintenant et nous n’aurons plus de problèmes MTO durant notre voyage. Le lendemain nous amène à l’escale de Tunis, puis nous longeons la côte africaine en nous arrêtant à Tripoli et Benghazi. J’avais demandé les autorisations de survol et d’atterrissage et cela se passe sans encombre, mis à part des taxes d’atterrissage dignes d’un Boeing 707 !
Nous longeons la route côtière qui fut si stratégique quand se la disputaient l’Afrika Corps de Rommel et les British de Montgomery. Je la survole, le plus souvent en radada, les roues à 1 m du sol, car il n’y avait pas de ligne électrique ou téléphonique et je m’amuse quand je vois arriver un camion à l’horizon, dont le chauffeur n’en croit pas ses yeux et se met à zigzaguer en se rapprochant. Je le saute au dernier instant. Cela lui fait certainement un souvenir ! Gamin que je suis !
Durant notre trajet à basse altitude en longeant la côte, nous avons la surprise de nous voir doublés à toute allure par un F-100 de l’US Air Force qui avait alors un détachement sur la base de Tripoli.
Après le décollage de Benghazi, nous restons sur la côte pour aller survoler les vestiges de l’antique Cyrène sur laquelle nous tournons quelques minutes pour filmer. C’est majestueux et comme le disait Astérix : « Ils sont forts ces Romains ». Puis nous essayons de trouver l’endroit de la bataille de Bir Hakeim à une centaine de kilomètres à l’Est de Tobrouk, où les Français de Leclerc se couvrirent de gloire, mais aucune trace ne subsiste de la bataille dans ce désert très aride.
Ensuite, c’est Le Caire qui nous attend, précédé d’un passage par Alexandrie pour ma mission photo pour le SDECE, mais alors que nous passons la frontière égyptienne, une brusque et intense odeur d’essence envahit notre cockpit. Dans les turbulences intenses que nous subissons constamment sur le sol surchauffé, le petit tuyau qui relie notre réservoir supplémentaire en caoutchouc au principal vient de se rompre et l’essence coule sur le plancher de l’avion. Heureusement, nous n’avons pas de cigarette allumée ! J’attrape un tournevis et Delanoë perce un trou dans la mince paroi de l’avion, qui permet à l’essence de s’écouler.
Une rapide évaluation me montre que nous n’aurons pas assez d’essence pour aller à Alexandrie et au Caire et je décide de me poser à Mersa-Matrouh, proche de la frontière ouest égyptienne. C’est un vendredi et donc jour de prière et de magasins fermés.
Auprès d’un mécano du coin avec qui je m’explique tant bien que mal en anglais, je me procure une colle cellulosique et essaie de réparer l’appendice de mon réservoir supplémentaire, car j’en ai absolument besoin pour finir le voyage, mais cela ne tient pas car l’essence dissout la colle. En désespoir de cause, je fais un essai avec le chewing-gum que je suis en train de mâcher et constate que la gomme adhère parfaitement au caoutchouc, même en présence d’essence. Toute ma réserve de chewing-gum me sert à faire un emplâtre qui va se révéler efficace, car cela tiendra jusqu’à Djibouti !
Avec le recul, je constate le joyeux optimisme et l’inconscience du danger que donne la jeunesse !
La flotte soviétique m’attend sagement dans la rade d’Alexandrie et mon copilote Delanoë débite deux rouleaux de 24x36, en mitraillant les navires que je survole assidûment à 100 m au-dessus. Nous allons ensuite nous poser au Caire où on me fait garer mon frêle esquif entre des Boeing 707 et des DC8.

Le croiseur lance-missiles russe "Varyag" lors d'une visite à Alexandrie
Nous restons deux jours pour visiter les Pyramides et le Hilton nous accueille pour un repos mérité. Le soir, pour nous changer du Chiche-kebab des escales précédentes, je commande au dessert des crêpes Suzette qui figurent sur la carte du restaurant de l’hôtel et nous voyons arriver un maître d’hôtel très stylé, muni d’un superbe chariot avec tout un nécessaire en argent pour faire flamber les crêpes. Avec des gestes très amples qui attirent l’attention des convives voisins, il fait chauffer son plat et l’arrose du contenu d’une bouteille, censé être du Grand-Marnier. Il met le feu, mais l’allumette s’éteint et il recommence deux fois, sans succès et vérifie sa bouteille. Grande confusion de l’intéressé, quand il s’aperçoit que c’était une bouteille de Porto !
Après deux jours de tourisme, nous revenons au terrain et je vais faire mon plan de vol pour Louxor, mais en arrivant à l’avion, je constate qu’un soldat le garde, baïonnette au canon. Je me félicite de cette délicate attention des autorités, mais le troufion refuse de me laisser approcher et m’indique de sa baïonnette la Tour de Contrôle.
J’y retourne et le préposé m’indique :
- « Ah yes, you have to meet the airport commander at the 4th floor of this building »
J’obtempère et me dis aussitôt que mes passages sur la flotte russe sont la raison de cette attention. En montant l’escalier, j’avise des toilettes où je dépose mes deux rouleaux de films sur le sommet de la chasse d’eau.
Je vais ensuite voir le Commandant d’aérodrome, un civil d’une cinquantaine d’années, qui me reçoit courtoisement et en fait, son souci est que je me suis posé à Mersa-Matrouh alors que je n’avais pas demandé l’autorisation préalable. Je lui en explique la raison et l’invite à venir constater la réparation de fortune faite au chewing-gum. Méfiant ou parce qu’il a envie de se dégourdir les jambes, il m’accompagne à l’avion et vérifie mes dires. Il rigole de mon pansement en chewing-gum sur le réservoir supplémentaire et ordonne à la sentinelle de s’en retourner. Je le raccompagne à la Tour sous le prétexte de terminer mon plan de vol et remonte discrètement chercher mes rouleaux de pellicule.
Et nous nous envolons, allons passer au ras des moustaches du Sphinx et tournons autour des Pyramides en prenant photos et films, puis je file sur le Nil vers Louxor. Je vole au ras du fleuve et pour éviter de me mettre dans des câbles éventuels, je reste à une hauteur inférieure à celle des mâts des felouques. Nous passons ainsi au ras des boutres, dont les équipages et passagers étonnés par cet avion insolite nous font des signes amicaux. Cette séance de rase-mottes est féerique et jouissive.
Je prends de l’altitude en approchant de Louxor et nous prenons de belles photos et des films des temples. Ce n’est qu’une rapide escale technique pour refaire le plein, car j’ai quand même un peu peur que nos galipettes sur les Pyramides et le Nil ne soient pas passées inaperçues. Nous redécollons donc très rapidement avec comme objectif Port Soudan sur le bord de la mer Rouge où nous allons bivouaquer avant la dernière étape vers Djibouti.
Mais après moins d’un quart d’heure de vol, patatras : la lampe rouge de pression d’huile vient de s’illuminer en continu.
J’interromps la montée et diminue aussitôt les gaz. C’est grave, car si c’est effectivement une baisse de pression d’huile, notre moteur va se gripper et s’arrêter. Je reprends le cap du terrain de Louxor et réfléchis. Il faut absolument que je lève le doute entre une panne réelle et une panne d’indicateur de cette pression d’huile Je décide de garder mon altitude de 8.000 pieds en attendant de voir.
Le retour vers Louxor me permet de conforter l’hypothèse optimiste, car le moteur tourne parfaitement rond et au bout d’un quart d’heure, nous sommes revenus à la verticale de Louxor et nous nous concertons. Cela fait maintenant une trentaine de minutes que la lampe rouge est allumée et mon expérience des moteurs à hélice me fait penser que si c’était effectivement une baisse de pression d’huile, le moteur aurait déjà eu des ratés.
Je suis assez au large du point de vue essence et décide donc de tourner encore un quart d’heure à la verticale de Louxor et si cela ronronne, de reprendre le cap de Port Soudan. Je demande l’avis de mon ami Delanoë, qui approuve mon choix. Nous n’avons pas le droit à l’erreur, car entre Louxor et la Mer Rouge s’étend un désert très aride de plus de 800 km, presque 5 h de vol, sans village ni âme qui vive. Pour survivre à un éventuel atterrissage forcé, nous n’avons que quelques oranges et deux bouteilles d’eau et ne pouvons pas compter sur une liaison radio. Je ne tiens pas à vivre la mésaventure de Saint Exupéry en Mauritanie, car il n’y aurait personne pour partir à ma recherche !
Le ronron du moteur est doux à nos oreilles. Nous reprenons le cap vers la mer et remettons de la puissance pour monter à 12.000 pieds, d’une part parce que la température y est moins chaude en ce mois d’avril et pour échapper si possible aux intenses turbulences que nous subissons.

Bernay - Djibouti : 7.090 km et 40 h de vol (Google Earth)
Pour naviguer à vue, je n’avais trouvé qu’une carte au 1/1.000.000 américaine, très peu explicite et ayant peur de me retrouver sur la côte sans voir Port Soudan et sans savoir s’il fallait aller à gauche ou à droite, j’avais programmé une erreur systématique de près de 100 km vers le nord. Ainsi, j’étais sûr qu’il fallait tourner à droite en arrivant sur la côte, pour arriver sur la ville de Port Soudan.
Un autre pilote qui convoyait un précédent avion d’aéro-club avait dû se crasher en panne d’essence le long de la côte, car il était parti du mauvais côté en atteignant la côte sans avoir vu la ville ! Mais en fait, ma carte était relativement précise et avec ma grande expérience de la navigation à vue, je n’eus aucune difficulté à rester sur le trait que j’avais tracé.
Le lendemain, ce fut une étape magnifique, longue de près de 7 h de vol en 1.200 km, en longeant les bords de la Mer Rouge, sous une lumière éblouissante et avec des variations féeriques de couleur de l’eau et des coraux, passant par toutes les nuances du bleu et du vert.
Heureusement, l’emplâtre de chewing-gum de mon réservoir supplémentaire a tenu et permis ce long vol. De toute façon, s’il avait failli, je pouvais me poser à Asmara en Éthiopie pour me ravitailler. La lampe rouge était toujours allumée en continu, mais ne nous effrayait plus.

Nous sommes arrivés !
Sur le terrain de Djibouti nous attendaient tous nos amis, dont mon fils Éric auprès de sa délicieuse maman, heureuse de récupérer sans souci son aventureux mari. Elle attendait un heureux événement pour le mois d’octobre et nous ne savions pas que c’était Isabelle. Le champagne coula à flots et humidifia nos gosiers assoiffés.
On m’assura que les photos de la flotte russe étaient très intéressantes et j’espère que ce fut utile ! Discrètement, on m’informa que je faisais désormais partie des "Honorables correspondants" du SDECE !
Mes mécaniciens de l’escadron, habitués aux 2.800 CV du Skyraider eurent tôt fait de trouver un fil de la fameuse lampe rouge du Jodel, qui s’était débranché et donnait un contact intempestif qui allumait la lampe rouge de pression d’huile, sans doute du fait de la turbulence féroce subie.
Le Jodel F-OCAU fit les beaux jours de l’aéro-club, mais fut crashé quelques années plus tard.
Christian ROGER
Extrait de “Piloter ses rêves” (Éd : Bookelis - 2015)
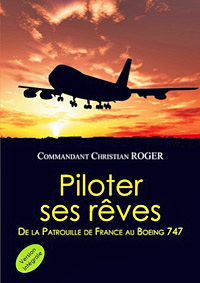
Date de dernière mise à jour : 30/03/2020
Ajouter un commentaire
